Ouïssances de Jean-Luc Lavrille par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
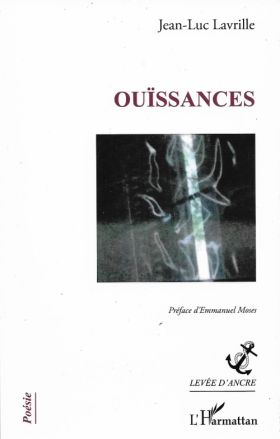
Que Jean-Luc Lavrille soit un poète-tireur, qu’Emmanuel Moses dans sa préface oppose aux poètes-photographes (il captent, alors que pour lui « la langue est une fin en soi »), n’empêche pas (au contraire) son poème d’être cosmologique, économique et même échonomique.
Lavrille n’habite pas confortablement son nom, il le propulse à l’infini, signature ADN creusant le vide interstellaire, d’écho en écho (Alain Frontier parlait d’un « enchaînement ininterrompu de lapsus »). Dans son poème de forme spirale, les reprises s’espacent, imprimant rythme et mouvement. P. 42 : « un mouvement de spirale râles de désespoir instantané ». P. 52 : « truands trouant mimant minant forant creusant sapant les bases et ouvrant ailleurs / vers d’autres multivers ». P. 55 : « apprentissage spirale le même point mais à une place différente une autre temporalité la boucle l’intervalle mis en relief le jeu de l’etc. ». P. 56 : « Un rythme qui rebondit. Apprentissage spirale » P. 73 : « la poésie autoréférentielle à laquelle s’apparente la mienne (…) reste en mouvement une spirale même dans ses pires râles ». Lavrille parle de « strates quantiques de langue en plusieurs états ». Le poème tourbillonnant rappelle aussi la pluie d’atomes de Démocrite, les atomes pouvant être les lettres, de préférence volées ou amoureusement données plutôt qu’échangées, ce qui déjà nous renseigne sur leur portée économique : « le signifiant s’expose à la lettre / dans une lettre d’amour à la langue l’amour de la lettre ». Plus loin : « lettre volatilise moucheronne virevoltante papillonnante tournoyante tourbillonnante ».
Si, dans l’économie d’Eco (Umberto), les livres « parlent entre eux », une « érotique de la langue » (l’amour toujours) est profondément critique en ce qu’elle se méfie « de tous les discours y compris le sien », du « discours basé sur l’unicorne l’univoque », des « mots suzerains » qui « s’useront ». Poésie, c’est « vivre mieux la langue en résistant à la langue commune marchande », par « la ouïssance de la langue qui rend l’oreille active et le flair cynique » car, cher Rabelais, « sens sans jouissance n’est que ruine de langue ». Distinguée, comme chez Barthes, du plaisir (du texte), la jouissance confine à la joie, qui « ne se décrète pas elle s’invente puis s’invite dans une qualité de présence au monde ». Elle est « rejet de l’acceptation et de l’enchaînement au temps », ou « une pause dans cette linéarité temporelle comme une rosace troue la narration des vitraux temps dilaté joie… ! ».
L’ « inouï-dire » de Lavrille nous replonge au cœur du réacteur de mai soixante-ouït’. N’écrit-il pas que notre « période de début de siècle est la grande liquidation de tout le travail théorique des années 60/80 pour beaucoup un refoulement une régression le retour du refoulé religieux » ? En 68, dans Tel Quel Théorie d’ensemble, un texte de Jean-Joseph Goux intitulé « Le sens de l’argent » préfigurait la critique, par Jean-Luc Lavrille, de la « langue commune marchande ». Le sens y jouait « le rôle que l’argent joue dans la circulation des marchandises » telle que l’analyse Marx. La marchandise, écrivait Goux, « n’est pas signe de travail, elle est le travail lui-même dans la seule forme qu’il peut avoir dans un système économique donné (celui par lequel il existe des marchandises) ». À l’opposition valeur d’usage / valeur d’échange chez Marx correspond l’opposition signifiant / signifié chez Goux, le premier dynamitant le second comme l’irruption du travail sur la scène du Capital de Marx dynamitait les fétichismes de la marchandise et de la monnaie. Sur la même ligne, Lavrille écrit : « L’esthétique de la poésie ou le snifant de sa poudre explosant le signifiant pour mieux explorer son signifié dynamisant le son pour dynamiser le sens le senti mental de la signification ».
« Parler le vide », pour Jean-Luc Lavrille qui revisite le mythe de Narcisse, c’est parler le deuil. Son double « serait l’auteur de (son) texte ». Fasciné par l’image d’un Narcisse dont le « regard si noir et si pénétrant semblait réel, comme si l’image regardait celui qui la regardait », Jean-Luc Lavrille rappelle que « selon une version rapportée par Pausanias, c’est pour se consoler de la mort de sa sœur jumelle, qu’il adorait, et qui était faite exactement à son image, que Narcisse passait son temps à se contempler dans l’eau de la source, son propre visage lui rappelant les traits de sa sœur ». Il ajoute : « Ma sœur mourut quand j’avais deux ans ». L’enjeu, doublé d’une menace mortelle, est le même pour Narcisse, pour Ulysse et pour Lavrille : « s’attacher à quel mât pour que s’entende ce chant des syrènes syllabes sans sombrer et se noyer dans cet océan verbal ce chaos de fluide ». Sans s’enfermer dans le cogito : « ni dieu ni cogito ni cogito ni maître ». Car « je suis comme je pense un cogito bien rouge (…) rouge comme l’étal du boucher ». La mise en orbite du nom Lavrille est celle des « mots communs » dont la poésie use (et mésuse, abuse : qu’elle excède) « comme s’ils étaient propres jamais employés », hors des circuits du sens et des échanges marchands. « Le jeu de cette langue autre est donc autre / la vrille sujet infini ». Quichottesque, « don prenant langue / avec l’abîme », l’ « écot que la langue doit payer à la poésie » est exorbitant.