Faire jardin de Pierre Gondran dit Remoux par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
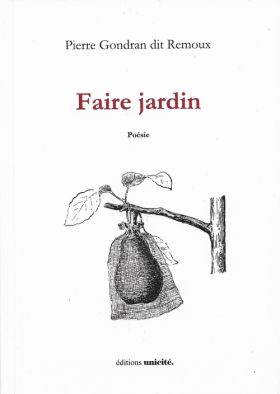
Le deuil d’un père, ou son enseignement à l’aînée de ses filles, à qui le narrateur-poète dit « tu » ? Sans doute les deux : un héritage, entre celui du fabuliste —« Un trésor est caché dedans »—, celui de Candide, « cultiver notre jardin », ou plutôt l’autre jardin, l’altérité du jardin, et celui de Sido, ce père étant aussi exemplaire que la mère de Colette et aussi muet que son père au legs de pages restées blanches.
« Faire jardin » comme faire société, faire nation, mais pas avec des semblables, ces parlêtres. Faire jardin « comme d’autres font leur vie », ou « pour pleurer », ou « de ses ongles noirs », ou « comme tu es née », mais avec le monde muet. Faire corps avec lui : « Corps muet miroir / du / corps muet de l’autre ». En osmose. La « lame rouille pensante » de la bêche appartient au même vecteur que l’outil, la main et la tête, reliés par le geste. En avril, la paume glissait sous les corolles des tulipes, « si délicatement qu’il semblait vouloir les consoler ». Les deux doigts perdus par un voisin qui tondait l’herbe sont plus proches du monde végétal (« ça meurt vite, / ça gigote pas ») que du monde animal, celui des anguilles coupées par le père « en tronçons // gigotant / longtemps » et celui du chien du voisin : quand les chenilles processionnaires du pin ont triplé le volume de sa langue, ce chien est mort et le voisin l’a pleuré « plus que ses deux doigts ».
Osmose entre la main et l’outil : « entre ses mains-outils si peu de caresses », mais tant de décisions en actes, prises par et avec le sécateur, « machine articulée du définitif » ! Tout un enseignement par gestes : celui d’ « écraser les doryphores entre pouce et index » fut transmis par le père à ses filles « encore enfants / dans le carré des pommes de terre / mains poisses de liqueur orangée ». Osmose entre temps de vie végétale et temps de vie humaine. Feuilles, fleurs et fruits sont réputés ne vivre qu’une ou deux saisons, mais les giroflées sont « si vieilles / qu’enfant ton père les arrosait déjà / vieilles du premier jardin de son grand-père ». Et la « tempête immobile » et « silencieuse » de la « grande lavande », qui « souffait déjà lors de tes premiers / regards aux carreaux », est « plus longue encore que ta vie ». Celle du végétal semble moins limitée que la nôtre. Où situer son début ? Sa fin ? Le « prunier greffé » dont « il est dit qu’il a ton âge » a-t-il « celui du porte-greffe myrobolan ? / celui du greffon ? », ou « l’âge du greffage » ? Sans notre intervention, la croissance et l’extension du végétal sont pour lui des moyens de connaître le monde qui l’entoure. La taille maintient les « arbres fruitiers » dans « leur naïveté » : dans une « folle ignorance ».
Le jardinage serait-il un exercice de traduction ? « Tu te dis / "peut-être le jardin était-il le langage de mon père" / janvier mutique / juin volubile », échange de rythmes, de temporalités, de cycles. Métamorphose, jusqu’à « se vivre lierre ». Est-ce lui ou le père qui « de ses mains empêche l’effondrement du mur » ? L’hiver, certains jardins s’effacent, « prennent congé des hommes », enseignent le droit à la paresse. À leur exemple, le père voulait couper le « pin trop constant », et « le remplacer par un érable qui aurait eu l’intelligence du repos silencieux ». Intelligence de l’otium : l’entretien réciproque du père et du jardin peut passer par la non intervention, « s’effacer » jusqu’à « s’enfoncer ». Et « penser — / cette herbe qui vole — comme ne penser à rien », penser « tant de tartes aux deux pommes / croquantes et compotées / (…) / comme ne penser à rien ». Penser, marcher « comme ne marcher à rien ». Vacant, comme en vacances. De même, « au fond du jardin de ton père », la « maison inachevée de parpaings gris », maison « embryonnaire », est « emplie de ronces / de nids de merles / de troglodytes / de fauvettes à tête noire », des « souvenirs que les oiseaux se font », et entourée de remblais, dans l’ « absurde orogenèse de terre d’un jardin ».
Faire ou défaire jardin ? N’en restent que deux rosiers, une bordure d’iris. Il faut brûler le roncier, le matelas maculé. Le sécateur perdu, retrouvé dans les cendres « noir de suie grasse de ronce » mais « lames rougeoyant », figure-t-il une résurrection du père ? Rouge des bourgeons, rouge de Pâques… Le père revient plus sûrement dans « l’odeur de l’essence » de son « zippo à monogramme ». Et dans le goût de la terre, que Colette disait trouver dans le vin. Au potager, le père « goûtait du bout de la langue » la « terre sondée collée à la lame de son couteau », la crachait « ensuite comme on crache vin // il cherchait à jauger l’argile happe-salive / la matière organique au goût de girolle // l’acidité des silicates qui brûlent le bord de la langue // te faisait goûter // riant de ta grimace ». Du rire transmis à Colette par Sido. Toute l’émotion portée par le texte, ces petits dépôts jalonnés d’expressions comme de stolons, tout l’enseignement du père en son jardin, passent par la sensation. Pierre Gondran dit Remoux l’a parfaitement compris, et le donne à lire.