Des objets nous accompagnent (ou l’inverse) de James Sacré par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
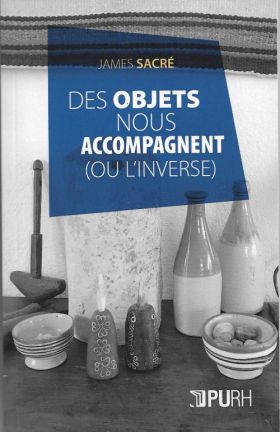
« L’objet, c’est la poétique », mais quel objet ? Pour Braque et Ponge, il est générique, mental, construit. Sacré nous entretient d’objets singuliers. Il constate en postface que l’ « objeu » et l’ « objoie » font passer Ponge d’un « parti pris des choses » initial à un « parti pris des mots ». Lui « demeure sans parti pris », parmi des « objets particuliers » dont la familiarité et l’étrangeté « se révèlent l’une à l’autre ». Le poème, « nouvel objet de mots », dira « peu / De l’objet choisi », tout au plus montrera-t-il « le désir qu’on a eu » de l’écrire en sa compagnie, faite d’ « observation », de « savoir » et de « souvenirs ». Le plus souvent poterie ou tissu, l’objet peut devenir tesson ou guenille, ce qui l’apparente au poème qui, lui-même, via éditeurs, rencontres, critiques, associations, n’existe que par « tout un tissu essentiel pour résister au silence quasi général autour des poètes dans les médias et la presse ».
L’enfant qui pétrissait la boue « en bord d’un chemin » quand il gardait les vaches pétrit aujourd’hui un poème, et peut tourner autour d’un mot comme posé sur le tour d’un potier. « On tourne, comme on dit, autour du pot ». Le mot « guenille » aurait pu devenir un titre. Tapis navajos ou poteries marocaines enroulent « le monde qu’on a vécu comme en charpie autour de soi ; une guenille ? ». Une aquarelle qui a perdu la fraîcheur donnée quand elle fut reçue « ressemble à de la guenille ». Les objets gardés ou cassés rendent les poèmes « à leur état de guenille mal vécue », de « guenille de mots, faudrait devenir enfant pour pouvoir s’en déguiser », de « guenille plus que déchirée ». Des vieux carnets encombrés de mots sont « un vieux paletot qu’on ne prendrait pas pour aller voir des amis », une « guenille qu’on essuyait mal avec ». Ils sont rangés « dans une boîte imaginaire sur laquelle sont inscrits les mots "ma guenille" ». Même « tessons et débris », les « objets du "réel" » sont-ils « de l’anti-guenille qui fait rêver, / Qui tient vivant ? » Du moins « ma guenille » a « ce mérite / Qu’elle ne prétend pas écrire », serait « plutôt torchon de papier / Pour mal essuyer / Des salissures de ce qu’on a vécu ». Ses « misères de pas savoir dire » continuent « ce qui fut un mal vivre ».
Misères, ces manières, ces tours de main ? Les langues sont faites de tournures, de « poteries sonores », qui ne sonnent pas en vendéen comme en marocain ou en anglais. Ce sont « musiques données par les mains du monde », saveurs offertes au lecteur. « Un grenier qu’on n’y mettrait jamais de grain », « Matin de bonne heure et pas chaud qu’il faisait », « Maman qu’a mouru, son battou mal tenu », « C’est comme de mettre au four un peu d’eau de la fontaine », « Et si me voilà pas parti », « Chez Maxime qu’on disait », « Les souvenirs sont cors de chasse qu’a dit Guillaume ». Le battou maternel , « outil de travail au lavoir », bricolé par le père, ressemble aux « bricolages d’écriture, comme par exemple quand une tournure patoisante s’encastre mal dans la grammaire apprise à l’école ».
Tour de main, « ce geste de tasser des laines sur un métier à tisser ». Entre lieux et temps, les objets font la navette. C’est « Un outil de berger marocain / Que j’imagine bien / Dans la main d’un paysan vendéen ». C’est ce qui brille dans les yeux des chiens, clin d’œil à « la patine à reflets clairs / D’un marteau marocain ». Ce sont des clous martelés « jetés là / Dans le silence du temps passé, dans l’aujourd’hui qui me les donne ». C’est, entre des « pétroglyphes d’avant l’histoire » et des figures de verre des Hopis, le « visage de temps silencieux », « l’énigme des temps ». Ou, entre maïs hopi et celui de l’enfance, entre poème et monde, « Poussière d’espérance et de savoirs dans l’incompréhensible infini ». Ce sont objets qu’on ne fabrique plus, depuis que le plastique a remplacé la faïence : « l’à peine sourire d’un passé qui s’éteint ». Ce sont « mes vingt ans » en des « plats creux andalous » où je « découvrais / Le goût de l’orange amère, mais celui de la vie / Comme une merveille ». C’est « emmêlement du passé avec l’aujourd’hui », trébuchement proustien de la réminiscence. Mais les souvenirs sont « des sortes d’objets / Sans matière ni forme qui pourrait être leur vraie forme », dont on « ne saisit rien / Sinon des mots le bruit d’une écriture / L’idée d’un objet qu’on a perdu, une fumée ».
Le potier tourne la terre autour d’un vide. Et « Chacun son mot vie, souvent / Qu’un petit verre de vide / Pour à la fin trinquer avec on ne sait pas ». Ou bouteilles, « Chacune remplie d’un sable qui vient / D’un endroit plus ou moins désertique / Aux États-Unis d’Amérique ». Ou « flacons à khôl » qui fait briller les yeux de « jeunes gars », un « jour de mariage à Zaggota ». Mais le khôlier est « dépareillé », « l’ancienne fête est finie / Mon poème aussi ». S’il n’a pas forme de bouteille, de verre, de khôlier, d’encrier, de carafe, qui l’ont accompagné, il s’est mis à leur école. La poétique, c’est un objet : « Une sorte de panier solide et agréablement léger. // On aimerait que se présente ainsi, ouvert, / Le vide (où rêver) d’un livre de poèmes ».