Le reflux lyrique de Françoise Clédat par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
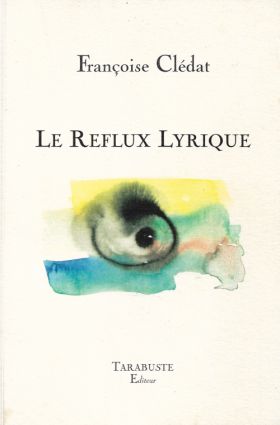
Bois flotté, par quel « reflux » l’offrande lyrique de Françoise Clédat est-elle portée ? Celui du cancer (sa rémission), ou celui de la vie (l’imminence de sa disparition) ? Comme Les parentés inhumaines, Le reflux lyrique s’aventure aux confins, « avec et grâce à » Orlan, par « une extension de la notion de performance aux mutations involontaires du corps —vieillissement et morbidité— jusqu’au lâcher prise terminal ». La découverte des cellules HeLa modifiant ses « perceptions du statut du corps vivant et du corps mort », Orlan a fait œuvre du « matériau produit tant par la machine-corps que par les machines et techniques nécessaires à son imagerie ». De même, Charlotte Jarvis « à propos de son installation Et in Arcadia Ego entend « lutter contre le cancer, la mort et l’immortalité à l’aide de la science ». Et Françoise Clédat : « Quand j’écris pour écrire le cancer je me sépare du cancer ». Une « réalité augmentée » génère « une catégorie littéraire mutante », qu’Orlan « définit comme un nouvel autoportrait », où le cancer condense « le théâtral et le monstrueux dévolu aux chimères, aux hybridations ». La « mortalité heureuse » (titre de la première partie) est une « fiction ». Suivront : « Passage du don », « Le reflux lyrique », « Avec et grâce à ». Eros et Thanatos, par référence à Freud, Au-delà du principe du plaisir, est le titre d’une performance d’Adrien van Melle, qui écrit : « C’est à ces sentiments contradictoires et entre-connectés que je me confronte ».
En même temps qu’Orlan, Pierre Huyghe explorait en 2016 à Tokyo le rapport art/science et les cellules HeLa dans son œuvre Living Cancer Variator —(Variation de cancer vivant, traduction DeepL) ». Les variations de Françoise Clédat, en un « point non final » où la rémission l’amène à « (se) croire immortelle », rencontrent sur son écran des « choristes de tous âges promis à une disparition plus ou moins proche à cet instant absolument l’ignorant », chacun « jeté dans la perfection présente d’un chant qui le hisse hors du temps », dans « l’insouciance d’un rapport au temps entièrement aspiré dans le surgissement de sa nouveauté ». Cet ouïr comme ouverture à l’autre (ici « le présent d’une musique vieille de plusieurs siècles ») trouve sa traduction dans le jouir, « nom et verbe à la fois, non arrêté mais ouvert, à l’instar de ce qui —bouche, vagin, anus— à l’autre corps, à l’autre sexe s’ouvre », et s’oublie comme « la rivière quand elle atteint la mer ». De même, « le temps de la création est un temps où la mort n’existe pas ». Où « distance, fusion et détresse coexistent, extatiques ». Où « toute création dans le temps de son écriture efface le sentiment du temps ». Où « toute création est une fiction d’immortalité ». Le moment « du sexe et du texte » est « l’enfantement rejoué ». Plus tard, si « mon amour » pouvait « au-delà de ma durée porter ma fille / Ce serait la mer ».
L’expérience amoureuse et l’expérience maternelle croisent « l’expérience livresque / des étrangetés », qui « m’élargit aux langues de leur rencontre ». Déjà, l’enfance, par un lien plus profond que sa visibilité, incorporait le paysage. Aujourd’hui encore, « je voudrais (…) / Adhérer / à la présence de chaque et du moindre être-là / (…) pour qu’entre doigts ouverts cela circule / qu’ils ressentent le passage / mais ne le retiennent pas ». Pour « ressentir entre moi et moi / le passage du don ». Pour que « vieillir ne soit pas / Exploration solipsiste », mais « Adhésion sans pourquoi / À l’immédiateté du don ». Pour que la « violente lente de la vieillesse », « taireur », oubli, sanglot, jouir, « À toute forme mêle / Son rire de géante ».
Quand « l’expérience de vivre / —son courant enserré par la pétrification des parois— / toujours plus s’intériorise » // —ne pouvant élargir l’exigüité / la creuse », elle jette voyelles et consonnes, « sons comme cailloux jetés / En ce creux du jouir où / L’ignorance palpite ». Les mots du Christ « Lamma Sabachtani » sont rapprochés de ceux d’Axelle Jah Njiké : « Dieu est une femme qui jouit », et du « cri de la cancéreuse quand sa vie par sa vulve la quitte ». Lâcher prise ? Plutôt « Jetée se jeter dans l’abandon / rejoindre l’absolu / par l’absolu de l’abandon ». Franchir la frontière, la « mémoire d’extrême bord / sans au-delà / que perte ou néant ». L’exposition Du Vent Au Vent d’Helen Mirra offre en un film de 11 minutes la représentation d’un voyage par « de simples lignes parallèles tracées au pinceau directement sur la pellicule par lavis d’aquarelle que le déroulement filmique restitue en scintillations vertes et bleues rayant verticales l’écran ». L’intuition vient à Françoise Clédat qu’elle a « devant les yeux la préfiguration hypnotique, pour ne pas dire extatique, de ce (qu’elle aura) derrière ». La « Vision du meunier / Icare qui crie dans un ciel de craie (Martin Rueff) devient un son inséparable d’une odeur, « premier et dernier son rayant la pellicule du silence ». Par « l’ouïe de la narine » (Baudelaire n’a-t-il pas écrit « Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir » ?), l’air « s’insuffle / je le respire / je/il me prend/perd ». L’air, le réel. Prigent : « De ce réel, la langue ne dit rien, sinon qu’il est —et force à parler ». Le vent, la mer. Flux, reflux. Et nous, bois flottés.