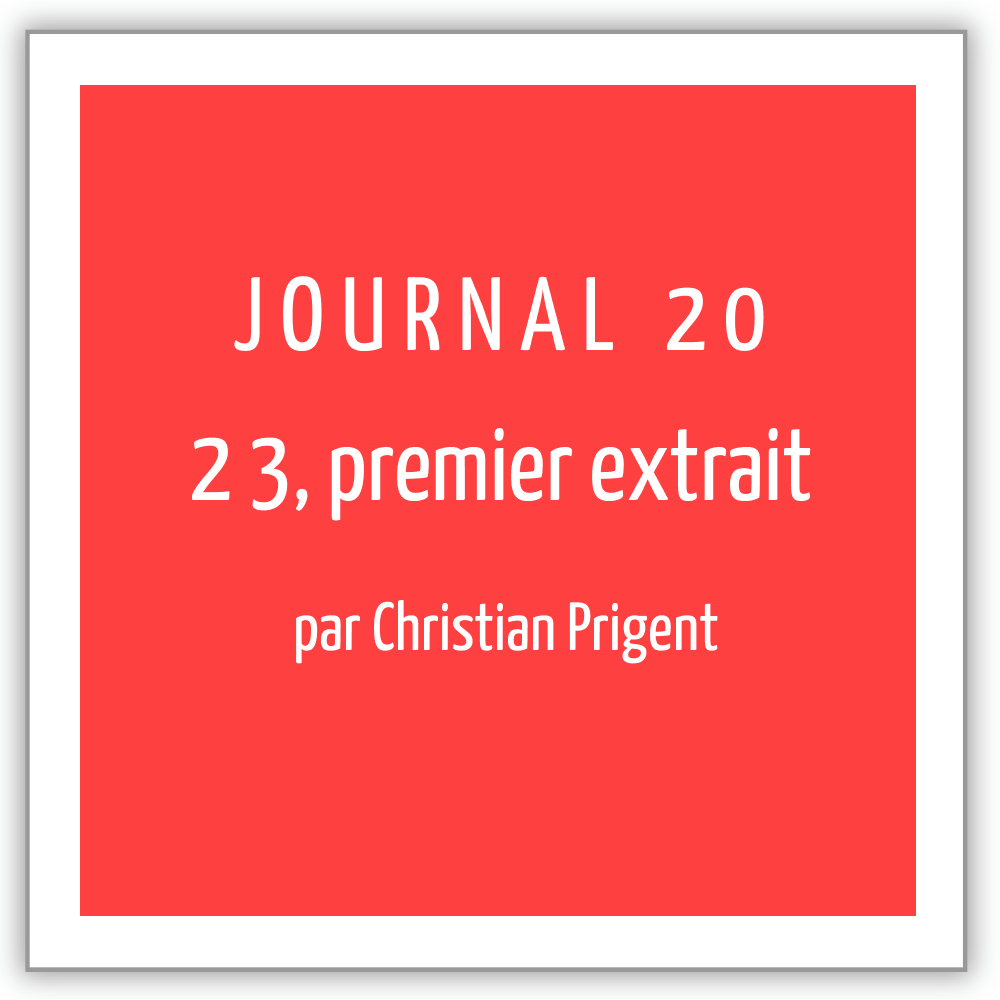J O U R N A L 2 0 2 3, premier extrait par Christian Prigent
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
10/01 [bêtise]
À propos de tics amusants qu’il prête à César Birotteau, Balzac écrit de ce dernier qu’il « se rapprochait ainsi des hommes en payant sa quote part de ridicule ».
Qui se déprécie n’est pas forcément modeste : ce n’est pas l’humilité qui y pousse.
Mais plutôt, primo une illusion de lucidité sur les ridicules qui affleurent dans les conduites des hommes et les propos qu’au jour le jour ils tiennent ; deuzio la sensation vaniteuse de n’être pas trop, du fait de quelque exceptionnelle puissance (intellectuelle, artistique ou autre), partie prenante des ridicules du commun ; tertio le dépit de ne pas trop savoir comment communiquer avec autrui dans la pensée faible, l’ignorance, la jovialité forcée.
On assiste chaque jour à sa propre sottise (qui le dénie c’est à cause de cette sottise elle-même). L’intelligence, éblouie de ses petits succès, est par cette sottise « toujours sodomisée de près » (Artaud) : il suffit pour cela du moindre pas de côté hors des compétences ; ou de trop de croyance en l’importance desdites.
Donner à voir ses travers avec une jubilation sur-jouée expose au ridicule. Mais s’exposer (au) ridicule, consciencieusement, n’a rien d’un masochisme pénitent. C’est une façon (a minima — mais sûre) de se rapprocher des hommes, une chance de participer à leur commerce : une ruse, en somme, la plus pragmatique des tactiques de survie.
*
15/01 [à mes amours : idylle au sprint]
Sc. 1
éclair de culotte au stop
sur selle entre les bielles
Sc. 2
ces bielles au lit charnel hop
lovées sans vélo ni selle
Sc. 3
la suite est à pinces
au clos où la mince
étoffe au fil pend
oubliée : sale temps
*
22/01 [cinoche]
Impression, souvent, de n’aimer le cinéma que pour, avec lui, retomber en enfance.
Le cinoche, en somme : aventures, costumes, exotisme du « grand désert, où luit la Liberté ravie » — dans l’absence heureusement ahurie de distance critique, tout au besoin infantile d’y croire.
Je note cela après le magnifiquement lyrique Capitaines sans peur de Raoul Walsh : l’océan au ras du goulot de l’écran, abordages pirates sur trapèzes de plus grand chapiteau du monde, canonnades et cocotiers. Starring Gregory Peck en captain corsaire et Virginia Mayo, fermière à joues de pomme d’api déguisée sans qu’on y croie mais on y croit quand même en infante d’Espagne.
Puis le Cléopâtre de Mankiewicz, carrément. Qui en met plein la vue. N’autorise à ses images aucune mesquinerie, aucune passion bassement monnayée, aucun espace étriqué, aucun bon sens économique, aucune vraisemblance boutiquière. D’un bout à l’autre de ses quatre heures luxueuses de couleurs, de trompettes et d’action, le film étaie d’un miracle dramatique renouvelé la plus imbécilement savoureuse des croyances, la plus enfantine (donc la plus polymorphiquement perverse) : moi Jane Cléo, toi Antoine Tarzan : pour de vrai ? pour de faux ? va savoir ! et qui s’en soucie ? — quelle jouissance, de se vautrer sans minauder dans le péplum brillamment éclairé, survitaminé de kitsch !
D’autant plus qu’on se sait au bout du compte non dupe, qu’on jouit des indices qui fissurent de distance maligne la croûte lisse de la fiction. Voici la grande parade de Cléopâtre dans Rome. Voilée de violet comme les yeux de Liz, elle est juchée sur son char entouré d’essaims d’esclaves bronzés à l’huile, d’éléphants harnachés par tonnes, de nubiennes à plumes d’autruche, de chevaux multicolores, tout Broadway est là en culottes minces. Stop du cortège devant César. Zoom sur Cléo : elle lance une œillade complice, pas loin de l’égrillard. Jules est hors champ. C’est à moi, à toi, à nous qu’Élisabeth d’Égypte adresse ce clin d’œil : amis du cinéma, coucou !
NB : ça ne peut se regarder à la TV. Ce n’est pas qu’une question d’écran trop petit. Ça concerne le hors-champ. Cléopâtre en ouvre un exponentiel, qui déborde de partout le visible sur l’écran : hors-champ temporel (l’Histoire : Antoine et Octave), hors champ spatial (la mer d’Actium, le désert nilotique, Rome vue comme d’avion, etc.). La boite TV, devant moi, plus petite que moi, meuble parmi les autres, ne permet pas le hors-champ imaginaire parce que le hors-champ réel est là : les vies en vrai s’affairent autour, on leur paie d’un œil le tribut qu’elles réclament même si l’autre œil louche sur la fiction. Sans compter qu’avant le film et après lui autre chose (des « programmes ») fut (qui dure, subliminal) et sera (piaffe déjà d’être).
*
12/02 [résurrection]
500 pages P.O.L en noir et rouge comme une manif anar à Barcelone vers 1936 : La Clef des langues est la « résurrection de la chair » de Novarina.
Elle me rappelle, mais comme son revers carnavalesque, celle que peignit Signorelli vers 1500 à Orvieto : les corps pierreux, gris de fatigue, la peau sur les os, revenant à travers la terre vers une autre vie avide de se ré-inventer par la couleur.
J’y entends aussi Agrippa d’Aubigné faire tourner à l’envers le film du temps : « Comme un nageur venant du profond de son plonge, / Tous sortent de la mort comme l'on sort d'un songe. »
Dans le livre de Valère, les personnages remontent par vagues des fonds de l’enfer de l’œuvre. Il sortent des coulisses de la bibliothèque et reviennent de versos plus ou moins lointains, à la fois tout neufs et poudreux de la poussière des anciennes narrations, lestés de souvenirs de décors de drames. Ils traversent le sol, la page — et s’impriment sur de nouveaux rectos. Ils sont grimaçants comme des épouvantails, noirs comme les marottes d’un moyen-âge macabre ou rouges d’hilarité comme des palotins jarryques.
Celui qui les a nommées ou dessinées manifeste en tirant les ficelles de ces marionnettes sa violente résistance à la mort. Non bien sûr qu’il s’imagine échapper à celle qui ne peut pas ne pas être au bout du chemin. Mais parce qu’il sait qu’on peut combattre et confondre la longue et lente mort qui, chacun à peine né et tout au long de son temps humain, soumet à sa puissance les vies qui ne lui opposeraient pas au jour le jour celle de leur propre réinvention — ou « art ».
*
13/02 [état flaque]
Je relis le paragraphe novarinophile d'hier.
S’opposer, combattre, oui…
La plupart du temps on ferraille peu : on vit soumis, sans rien ré-inventer. C’est-à-dire qu’on traîne en pyjama, qu’on somnole les yeux ouverts, qu’on jonche dans sa flaque parmi des feuilles toujours plus automnales que printanières, qu’on mijote dans un jus d'indifférence croissante aux affaires du monde — malade de rien d'autre pourtant que d’une plein-l'culite générale qui ne peut se diagnostiquer autrement que de cette façon décidément vulgaire.
On, c’est moi — qui abuserait s’il disait je.
Au moins on peut du coup rire de ce soi moche.
Décrire cette mocheté en à peine pire donne l'occasion de ce rire : profitons.
*
15/02 [le (bon) sens]
Rengaine : ce textualisme intello, ces poésies tordues, on n’y comprend rien — donc ça ne veut rien dire.
C’est une variante du « je ne vous comprends pas, donc vous êtes idiot », où Barthes voyait le tic des polémistes réactionnaires.
Ce n’est pas de sens qu’a soif ce type de lecteur mais de significations sans reste in-signifiant.
Il suppose que le poème veut dire. C’est qu’il pense la même chose du monde : qu’il peut dans la parole humaine se résoudre en significations parce qu’une parole originelle (auctoriale) l’a voulu tel ; et que son sens réside dans cette résolution en significations formulables : en une théologie, par exemple.
C’est une métaphysique — la plus banale de toutes.
Le sens du monde, il ne s’agirait donc que de le retrouver. Le plus immédiatement possible : avec le moins possible de médiatisation (de densité verbale). Idéalement, même : sans parole, sans langue.
Cette fois, c’est une mystique.
Comme la quasi totalité de ceux qu’énervent les difficultés de la poésie sont métaphysiciens et mystiques seulement sans le savoir, leur croyance n’est que la conversion en idéalisme du pragma de leur attente banale : il faut que ça dise, que ça coïncide avec les phénomènes (le réel, l’étant, le monde — comme on veut) tels qu’on a déjà mis dessus des significations, qu’on puisse ainsi partager la conviction qu’il y a des significations déposées dans les choses, que ces significations sont toujours-déjà là et qu’un poème n’est finalement rien d’autre qu’une forme sympa de retrouvailles avec elles : avec le bon vieux sens.
Ça rassure.
Le « bon vieux sens », ça s’appelle aussi le bon sens. C’est le réseau des clichés : non le monde, mais la légende du monde.
Là se tisse l’aliénation liée à toute pratique servile de la langue : l’acquiescement charmé à l’idéologie qui d’époque en époque constitue le sens exclusivement praticable et l’impose comme façon normale et légale de se représenter les choses.
*
16/02 [pas d’idoles !]
Faire sous soi ce genre de sens, c’est l’affaire des orateurs politiques, des dispensateurs de savoir positif, des propagateurs de dogmes, des légendeurs d’exploits planétaires ou des raconteurs de petits faits (vrais ou imaginaires). Ils ne manquent pas : on est par leur logorrhée chaque jour écrasé.
Faire poésie, c’est plutôt résister à cela. En le déformant. Pas seulement pour déformer le formé (mettre en cause par quelques bizarres manipulations verbales les façons « normales » de former des significations). Mais pour déformer jusqu’à la prétention à former un sens qui ne vacillerait pas sur lui-même. Former des formes qui portent en elles une puissance à ce point perverse qu’elle soit capable d’empêcher que la formation du sens (toujours imminente dès que c’est avec des mots qu’on travaille) se fixe en significations stables.
C’est pourquoi il faut que les formes (prosodiques, entre autres) soient denses, serrées, solides : elles sont le ring où les significations formées se détruisent — il faut qu’elles tiennent le coup.
Les significations sont des pierres taillées dressées le long de nos chemins de pensée : des idoles. Faire poète : œuvrer à les abattre en soi, sans cesse, en riant du rire de qui travaille à délier les sym-boles.