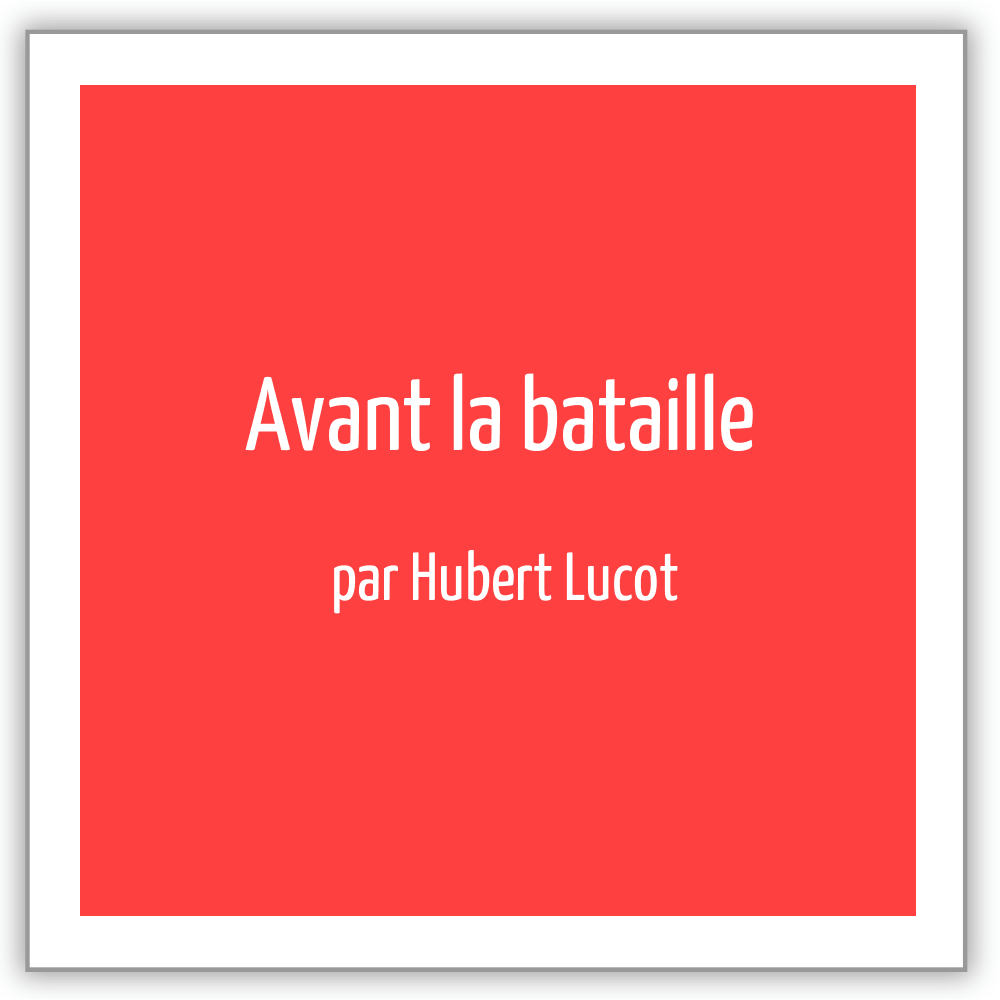Avant la bataille par Hubert Lucot
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Dans l’hôpital des Quinze-Vingts, mon opération constitua un moment d’autant plus agréable qu’on devança les temps prévus : départ à 9 h 15, ce 25 mars 2010, dans les annexes du BLOC OPÉRATOIRE, lequel se révélera une simple chambre ; arrivée dans le bloc avant 10 heures. Quel bonheur d’avoir confiance… le docteur Liem Trinh me parle en ami sur fond de jazz chanté me rappelant l’interview écrite que je dois donner à une revue spécialisée. L’acte opératoire occulte tout sauf l’INTÉRIEUR de l’œil droit dont Trinh remplace le cristallin. Couleurs — bleu, blanc, rouge adoucis — beaucoup plus pauvres et sans extension, mouvements moindres que dans l’œil gauche le 16 juin 2008. Une pyramide blanche de quelques centimètres de large occupe un trou central dont la paroi mêle le rouge et le bleu.
Glissé contre un mur de la salle de repos, je rejoins d’autres alités sur roulettes, l’image « fosse commune » m’amuse. Le temps passe vite ; de même, dans ma chambre hospitalière retrouvée contenant uniquement mon fauteuil et celui du voisin parti au bloc. Dès le petit déjeuner ingéré avec un beau désir, je prends la plume, ma vision de près semble peu diminuée. Leurre ; explication : je sais deviner mes mots dans les fantômes gris.
Au bout d’une heure, je me dirige vers la sortie. Répétée sur les murs, une affiche nous demande de dire « NON à la DMLA ! » Dans le long texte en petits caractères, mon œil gauche lit : « Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge. » L’extension de la tache jaune constitue l’une des morts partielles de notre population vivant trop longtemps ; la plus fameuse est l’alzheimer. Autre signe du temps, le publicitaire postmoderne fait des astuces sur « perdu de vue ».
J’ai claqué derrière moi la porte, A.M. survient : « Comment ça s’est passé ? – À merveille, mais là-bas (aux Quinze-Vingts) ils n’aiment pas beaucoup la DMLA. »
mercredi 31 mars
Contrôlant ma vue six jours après l’opération, Dr Trinh m’interrogea sur la santé de ma compagne et inventa une nouvelle alliance A.M.-H.L. Grave sans nulle pose, il énonce le long temps d’une lutte commune dont je me dis qu’elle n’a pas encore commencé : les experts se concentrent avant de donner le départ d’une aventure thérapique dont nul ne sait l’issue. Dr Trinh n’avance que du vrai : dépistage difficile, le foie et l’intestin cachant le pancréas, délicatesse et brutalité de la chimiothérapie, car on exclut la chirurgie. La grande concentration de son visage aux traits fins sur l’objet à trois faces (le mal, la malade, moi) ne représente pas la douleur. Deux yeux et une voix aimable dessinent l’avenir proche de celui qui devra savoir aider sa compagne. Nous sommes dans l’abstrait… pas vraiment… je soupçonne la réalité des nausées, des fatigues, du moral détestable. Dr Trinh inchangé — maintenant de profil, alors qu’il avait examiné mon œil de face — est la première image de mon combat.
Je devais — autre forme de nécessité — faire de l’humour, j’ai glissé : « J’espère que je ne serai pas ridicule » ; réponse lucophile : « Vous ne serez pas ridicule, monsieur Lucot », j’explique que selon Henri Michaux l’empereur de Chine donnait une unique recommandation à l’ambassadeur qu’il envoyait au bout du monde : « Ne sois pas ridicule ! »
Déplorant que le traitement ne commence pas encore, je formule : « Les experts nous donnent des vacances avant le travail, un répit telle une rémission. » Je rapproche la calme cohérence du visage et de la voix de Trinh, liés à un avenir dur, et le petit avenir doux que laissent au couple A.M.-H.L. des experts préparant la guerre.
Vient un rapide concept : « guerre d’Indochine », mes 18 ans ; cet été 2009, Liem Trinh médecin humanitaire au Vietnam pendant ses vacances. Vient une traduction : Liem = honnêteté en vietnamien.
samedi 10 avril
Le calme précède dies irae ? À 13 h, A.M. H.L. sommes partis dans notre quartier, par beau soleil, vers la terrasse idéale pour notre déjeuner. J’eus l’idée du parc de Bercy sans automobiles, le bus rapide nous amena sur le parvis du Novotel. Douceur, salade, grillade. Puis-je écrire « bonheur du non-dit » ? A.M. me regardant avec amour dans cet espace libre — et sur fond d’arbres élancés, j’imagine, qui contemple la façade de l’hôtel — comme elle m’avait étreint il y a quelques jours, étreint le signe et le témoin de sa vie, vécue (50 ans) et qu’elle vit (instant), signe épais, charnu, constant, je ressens sa pression, le sens de celle-ci, mais je ne sais plus où, je sais que je l’ai écrite… Je la retrouverai : il y a 9 jours, dans la cuisine.
Vaincre la mort comme firent les Anciens, il me semble que je pourrais expliquer ce miracle à des êtres instruits et sensibles, expliquer que la résignation matérialiste relève de l’art, plus vrai que la religion ; ainsi, s’arrêter de boire est un coup à prendre, une technique pour rendre inconsciente l’interdiction que la conscience juge salutaire, pour la faire migrer au fond de soi, là où il y a goût, souffle, foie, liqueurs, humeurs, pour l’ingérer comme un grand verre de whisky. Ma rêverie antique parmi les arbres que je sais dans mon dos rejoint la clarté de la Renaissance que je connus à 14 ans, l’adolescent Michel de Montaigne parlait couramment latin et passablement le grec, je rejoins la lumière de Marseille, les toits rouges vus de l’appartement apical des tantes d'AM cloîtrées, le monde méditerranéen par lequel j’existe depuis l’adolescence.
15 h 13 La terrasse du Novotel est proche — lointaine dans le temps : au repas succède la sieste —, le parc de Bercy nous offre un beau temps variable : ciel bleu… des nuages.
Je suis allongé sur un banc sous les feuilles rondes (pétales) d’arbres hauts, me félicitant de voir comme jamais je ne vis depuis l’enfance, sans les lunettes qui atténuent la vivacité des formes et des couleurs, à 75 ans j’ai avancé d’un pas vers la crudité du réel. Ma tête repose sur le ventre d’A.M. assise, ventre où je vins et qui porta, ventre où aujourd’hui siège le mal dans un recoin. Comme j’écris « porta », A.M. saute de l’autobus 65 en marche dans une robe bleu ciel avec des talons hauts ; traversant le boulevard Magenta, nous monterons dans le bel immeuble de Monîme et Jacques Chemla, A.M. sauteuse avait oublié qu’elle était enceinte de sept mois (très belle journée de décembre 1959, l’heure midi).
La main gantée de la Parisienne — ou de la jeune fille allant déjeuner avec son oncle à Cassis printanier et dominical — repose sur ma poitrine. Bonheur de la campagne, si profondément connue depuis le tout début, c’est la surface de mon épiderme. Ce samedi 10 avril, à 15 h 19, éclate contre moi une onomatopée redoublée — « Galai-Galai » ? — à la tessiture solaire : le gosier-oiseau d’un bambin (non pas d’un nourrisson) ouvre un siècle de vie quand le mien se referme, j’ai souvent affirmé que la perfection de cette boucle me console de ma mortalité. Le siècle blanc — à vivre — du petit égosillé me stimule, notre homme connaîtra le XXIIe siècle, mais l’incertitude planétaire m’abat. Je redoute la mutilation future de la race humaine comme de moi-même m’enfonçant plus encore dans la vieillesse.
dimanche 11 avril
Renversant d’est en ouest notre pratique de Paris arboré, nous sommes allés déjeuner dans le chalet qui accueille sur l’île du lac du Bois de Boulogne le voyageur sautant d’un bateau plat. Le balcon étroit nous expose au soleil qui se répercute sur la paroi vitrée de la grande salle. Le temps est variable, nous ressentons du froid… Heureuse émotion quand le soleil revient sur le lac et sur sa rive continentale ; de l’autre côté du bras d’eau porteur d’une seule barque (non : deux barques), il frappe enfants, pulls, du rouge, le petit vélo, des couples, jeunes, vieux. Je me représente globalement les 20 ans, le xvie arrondissement ACTIF de Jean-Edern ; un film franchouillard contemporain des tout débuts de Godard narre l’arrivée à Paris d’un jeune provincial séduisant. Dans la fiction cinématographique au blanc lumineux — le noir serait d’un smoking ou d’une voiture de sport basse —, le jeune homme qui lance sa carrière tel Alain Delon, c’est moi d’une façon originale : l’aventure littéraire sera noueuse et coupée des salons.
lundi 12 avril, 10 h
Hier, entrée des AUTRES, auxquels on DIT. Nous étions dans le Bois de Boulogne, dans les beaux quartiers que fend l’historique autobus 63, Zina appela. Il fallait la rappeler, j’ai dit trois mots sur ma « cataracte » et j’ai monté l’appareil à A.M. allongée dans sa mezzanine. A.M. sut introduire le sujet, elle pointa des cellules malignes sans prononcer cancer, je voyais le bas de la fenêtre sur lequel opérait Michaël, l’ami de Cédric ; ce jour-là, cinq jours auparavant, comme je rentrais de promenade, A.M. tendant un outil à Michaël, tous deux accroupis, m’avait dit distinctement pancréas et signifié cancer mais sans employer ce mot. Hier encore, à Cédric retrouvé seul dans la cuisine : « Tu sais qu’Anne-Marie est très malade ? » Lui : « Quoi ? » Je lui apprends en douceur mais clairement, surpris que Michaël ne lui ait rien dit.
mardi 13 avril
Je dois porter à la Sécurité sociale un document officiel émanant du médecin traitant. De la plume d’un homme que je connais bien, le docteur Marc Teyssier, je lis pour la première fois cancer : « cancer pancréatique », puis : « chimiothérapie et antalgie ». On écrit « cancer » comme « tube d’aspirine », je n’ai pas le réflexe stupide d’attribuer cruauté à notre médecin — qui, lors de la remise du papier, me répéta une parole fondamentale d’A.M. à lui seul : « Je veux bien mourir, je ne veux pas souffrir. »
A.M. H.L. partons pour l’hôpital Saint-Antoine vers 13 h, nous nous arrêterons pour déjeuner dans un véritable restaurant italien, Via Antonio, dix mètres avant l’hôpital dont il porte le nom sous une forme chantante. À l’arrêt du 86, boulevard Henri IV, par un temps variable qui ne me déplaît, je me répète le VERDICT du bon Teyssier ouvert affable costaud parleur, mon esprit bute contre la sécheresse administrative des mots répercutant un diagnostic laissé à des experts, à leurs machines, et prévoyant mécaniquement une douleur dont je n’ai l’idée… L’autobus tarde, je revois le lac du Bois de Boulogne en 1958, peu avant l’arrivée d’A.M. depuis Marseille. Le bout du lac, la large terrasse élégante sont une image sans existence réelle dont les acteurs ont disparu, souvent dans de grossières métamorphoses. Le lac 1958 et la comédie humaine mûrie en un demi-siècle sont des illusions, comme dirait la pensée classique — voire la pensée picaresque.
À 15 h 15, l’entretien avec la cancérologue de l’hôpital Saint-Antoine s’acheva. Cancérologue ? Oncologue ! Service de cancérologie ? D’oncologie. On a tué le mot cancer. Le protocole de la chimiothérapie nous fut exposé avec clarté, « je » me suis enfoncé dans le noir quand la dame — charmante — annonça l’accroissement de la douleur.