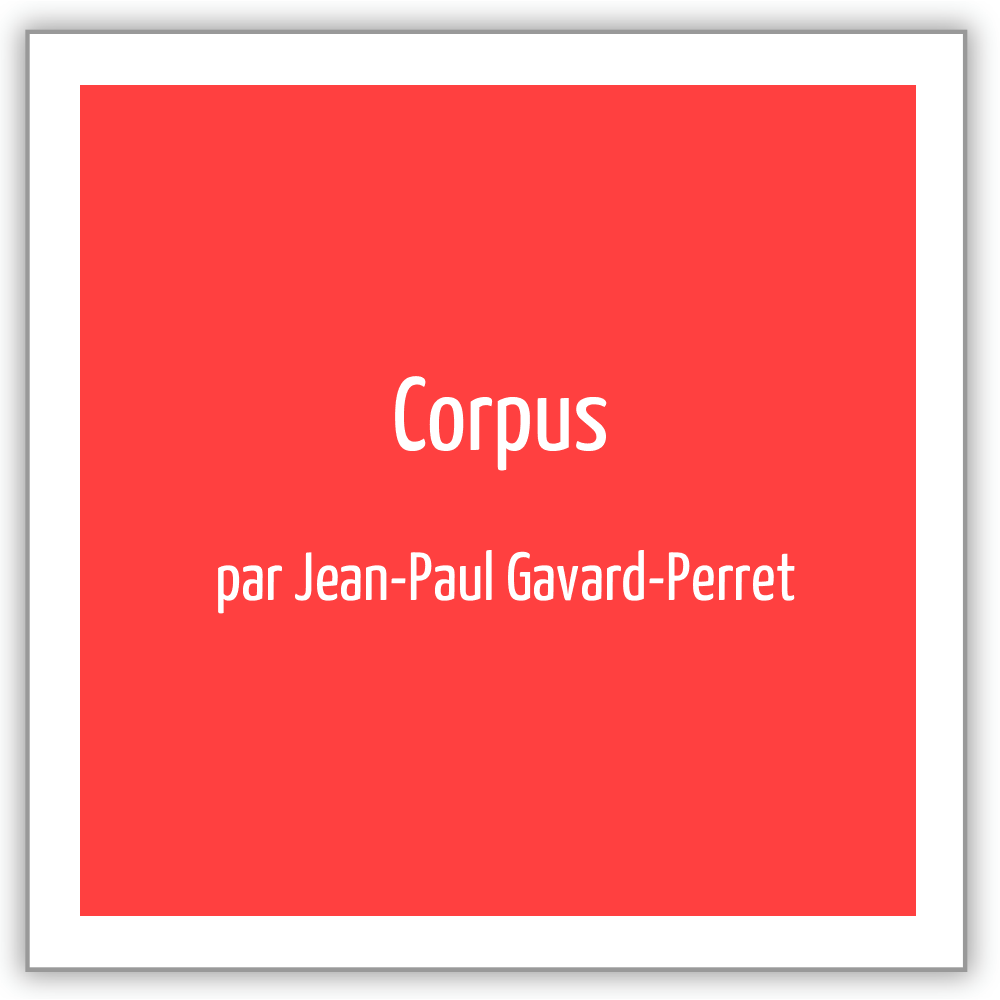Corpus par Jean-Paul Gavard-Perret
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Mon corps n’a pas de corps. Pas de corps dehors. Visage sans visage et bouche sans lèvres. Pas de mots ni dehors ni dedans. Pas de ventres, pas de faim. Pas de sexe non plus. Il dérive invisible à l'autre, à soi, sans ici ou là-bas. Qu’une trace creusée dans le drap ou sur un chemin précaire. Gavé depuis l’enfance de centimètres-cubes d’huile de foie et des chiffons. Sa mécanique macère dans la première mais il craint que ses poulies bloquent par les seconds. Mon parfum sent le chien dans ses pluches de peau. Mon regard n’a plus droit à une vision de loin. Grain se moud. Il y a dedans dit-on du sperme en compote. Il y a aussi du gras en croûte, du sang de bouc, du nitrate en chenilles, des ceps et des crêpes à la farine d’épeautre. Les ont pétries de drôles d’apôtres. Ciel s’obstine. Bas et lourd. Mon corps est sans frontière, sans demeure précise. Exit porte et fenêtre. Sous l’invisible demeure un innommable. Y résonne une voix d’ivrogne. Ses mots pèsent comme une prière. Devenant chant il ne reste que des si bémol et des fats dièses. Leur regard traverse dans la lumière du soir les ombres appesanties. Bientôt c’est le désert. Je n’ai pas de corps. Pas de même, ni d’autre. Perdues les jambes. Perdus les pieds sur terre. Il y a personne. Tout le temps est dehors. Yeux tombent, oreilles se ferment. Rien n'arrive. Ni personne. Suis Pierre ou Paul ou autre Pierre ou re-Paul. La terre est nue à l’insomniaque rêveur. Et dès la première heure du jour jusqu’à la dernière de celui d’après. Suis là dans mon pays natal. Je ramasse mes gestes. Ce n’est pas la douleur. Il faut encore marcher et passer la frontière. Suis donc là sans y être. Le dégel est précaire. Très vite le froid revient. J’attends de me perdre avant que la langue défaite retourne à sa poussière. Il n’y aura de pensée sinon une pensée morte. Je n’ai plus de corps. Son intimité s’expose pourtant comme infini infiniment proche.