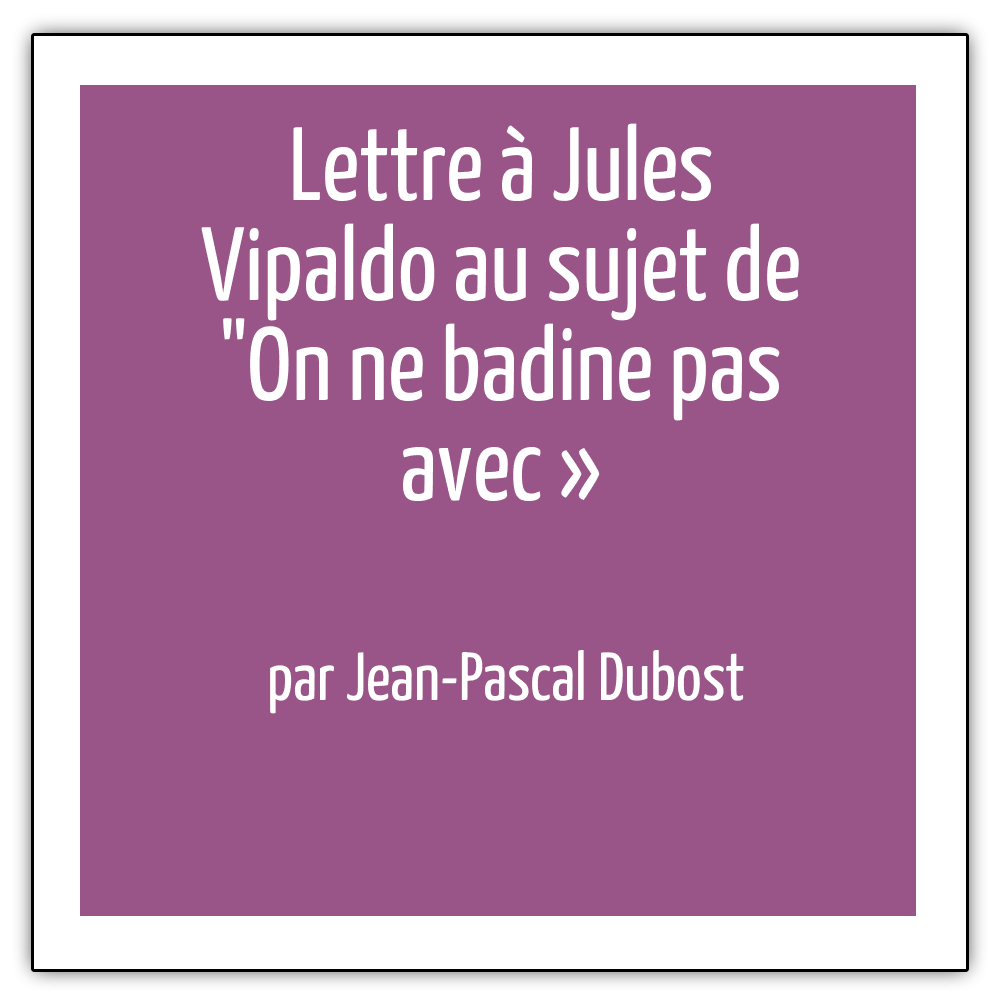Lettre à Jules Vipaldo au sujet de « on ne badine pas avec » par Jean-Pascal Dubost
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Paimpont, le 25 février 2025
Cher Jules,
Oserais-je avancer qu’importe peu l’apparent objet de tes livres étant donné que leur véritable objet est la langue et plus particulièrement la langue du poème et qu’importe itou peu si présentement l’arithmétique est celui de On ne badine pas avec puisqu’il t’offre avant tout le prétexte à l’élaboration d’un éloge du plaisir du texte ou de ce que j’appellerais le plaisir texsuel ?
L’arithmétique, objet bien peu poétique a priori1 ; au langage abscons. A priori : parce que, en réalité, tout peut faire poème, il n’est pas d’objets (ni de mots) plus poétiques que d’autres.
Le titre laisse planer le soupçon de parodie ; le laisser en suspens après la préposition « avec » invitant le lecteur à compléter. Mais ce titre est trompeur, car l’œuvre d’Alfred de Musset n’est pas l’hypotexte de ton livre. La parodie est ailleurs. Sa cible est la poésie. Si tu es dans la veine du comique verbal, est intéressant de regarder le jeu sur les différents registres du comique (genre fichtrement difficile à définir), entre bouffonnerie, carnavalesque et burlesque.
Bouffonnerie : parce que tu opères avec une extravagance outrée de la langue, sinon du langage (celui de l’arithmétique), déboîtant à l’envi par exemple des calembours placés en exposant ou en indice, usant aussi de maints autres signes de ce langage pointu. Le genre bouffon a pour objet le rire, de provoquer rire à tout prix, tout comme le bouffon du roi n’avait que cette seule fonction. Les calembours défilent à vitesse folle et au gré de ta fantaisie : jeux graphiques, jeux lexico-sémantiques, détournements citationnels, potacheri(r)es de toutes sortes et sans vergogne, le tout dans la simple gratuité de faire de bons mots, d’enjoyeuser la langue française un peu à l’étroit dans son corset. Tu invites le lecteur à assister (et à lire) (la lecture animant les acteurs : c’est-à-dire les mots), à assister à un théâtre verbal ; un théâtre bouffon de mots et de phrases. Le style est bassement comique ; mais bassement parce que situé en-dessous de la ceinture (le langage sexuel étant omniprésent). La langue est découverte et expérimentations, jubilation de la trouvaille, jusqu’à la saturation parfois.
Très proche dans la veine comique : le carnavalesque, en ce sens où en recourant aux jeux de mots les plus potaches et les plus familiers, tu fais entrer la culture populaire par le verbe (le vulgaire, le trivial) dans un genre qualifié comme étant noble (la Poésie). Carnavalesque parce que les mots s’agitent graphiquement sur la page, sont libérés de leurs contraintes, renversent certaines valeurs (religieuses, poétiques…) Poésie plus typographique que visuelle. De ce fait, la poésie devient une fête populaire faisant danser les mots de Saint Luc et de Saint Noc, danser le sexe sur la place poétique. Les mots du sexe sont exhibés par provocation, jusque parfois le blasphème, la provocation impie.
Et dans le bouffon et le carnavalesque (ou avec) : le burlesque. On le sait, l’histoire littéraire n’a pas toujours flatté le burlesque ; Boileau ne le ménagea pas, « Le style le moins noble a pourtant sa noblesse./Au mépris du bon sens, le burlesque effronté/Trompa les yeux d’abord, plut par sa nouveauté », ni Sainte-Beuve, « Et le burlesque, autre fléau, le burlesque, cette lèpre des années de la Fronde et qui y survivait », ni Brunetière, qui considérait le travestissement burlesque comme le « néant de la pensée »2. Les critiques lui reprochaient son manque d’esprit de sérieux, d’être un genre bas et vulgaire, artificiel de par son comique de langage, purement ludique et vide de signification, on n’en jettera pas plus. Historiquement, le burlesque provoque le rire en faisant contraster la « bassesse » du langage avec la dignité des personnages, et dans ton cas, avec la dignité de la poésie, ou du moins, celle à laquelle l’ont élevée les pisse-froid de la cause poétique. En langue outrée tu fais descendre la Muse de ses hauteurs parnassiennes, sur laquelle l’esprit de sérieux pèse encore de tout son poids (ne serait-ce que cette sacro-sainte « inspiration » qui plombe encore les esprits). Si Lautréamont écrivait que « la poésie doit être faite par tous », Jean-Pierre Verheggen Grand Moqueur devant l’éternité répondait quant à lui que « la poésie sera faite partouze et non parents »3, et toi, partant du postulat catholique que le rire serait le propre du diable, tu surenchéris en affirmant que le démon est partout et partouze. Alors, on ne badine pas avec quoi ? On ne badinerait pas avec l’humour, écris-tu narquoisement. Diantre non, on ne badine pas avec la poésie ! La poésie pèse ou pète, écris-tu, ajoutant qu’« il ne faut pas poéter plus haut que son CULte ! », rappelant que : « [le coup du pet jamais/n’abolira/son bazar…»
Si l’argument que le mot « écrire » contient « rire » est un argument sans fondement raisonnable pour justifier qu’écrire c’est rire, c’est bien parce qu’il est sans fondement que tu l’entretiens. Tu possèdes le « savoir-faire-rire ». Grâce au rire, la langue s’exprime à gorge déployée et déploie toutes ses facultés, sans restriction.
Tu es le descendant littéraire direct du Maurice Roche de Compact et d’Opéra bouffe et du Jean-Pierre Verheggen d’Entre zut et zen et d’Opéré bouffe, ce sont tes pères (et pairs) bouffes, nul besoin de procéder à des recherches de parenté, ça crève les yeux du lecteur. Peu, très peu de poètes de notre temps ont le rire pour fondement (si je puis dire) de leur œuvre.
Je me souviens bien de ce qu’écrivait Roland Barthes à propos du roman Cobra de Severo Sarduy : « c’est la gageure d’une jubilation continue, le moment où par son excès le plaisir verbal suffoque et bascule dans la jouissance »4. Ton livre est une jubilation continue.
P.S. : En raison de la complexité graphique d’On ne badine pas avec et en raison des contraintes liées au site, nous n’avons pu reproduire les citations incluses dans cette « Lettre ».
1 Ni le pin douglas : du même auteur, Pour qui sonne le douglas, éditions Dernier Télégramme, 2023
2 Nicolas Boileau, Art Poétique, 1674 ; Charles-Augustin Sainte-Beuve, Port-Royal T3, 1848 ; Ferdinand Brunetière, « La maladie du burlesque », in Revue des Deux Mondes, 1906
3Jean-Pierre Verheggen, Du même auteur chez le même éditeur, Gallimard, 2004
4 Roland Barthes, Le plaisir du texte, Le Seuil, 1973