Dante Alighieri, Une vie nouvelle, traduction d’Emmanuel Tugny par Florica Courriol
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
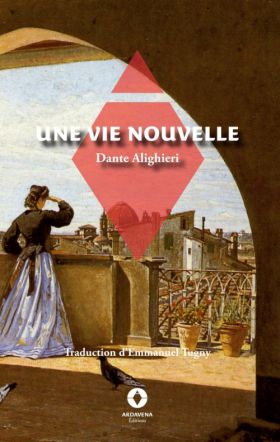
Nous avons ces jours-ci comme une impression que la poésie, si discrète d’ordinaire (avec la connotation de peu populaire), ose envahir l’espace public de plus en plus. Il est vrai qu’en tant qu’admiratrice de la poésie roumaine j’ai pu assister à de nombreuses manifestations dédiées à l’universel Eminescu, le Poète emblématique des Roumains, né un 15 janvier…il y a 175 ans !
La poésie a donc des chances de survivre par-delà le temps (vous pouvez lire cela comme une assertion ou comme une question) ; un exemple qui me vient encore à l’esprit c’est la retraduction d’un grand classique italien (je devrais dire universel car il appartient à la littérature du monde), Dante aux éditions Ardavena.
Éditeur indépendant, Ardavena publie, avec le courage et l’enthousiasme lucide des amateurs de bonne littérature, des textes rares dans six collections dont l’ambition est – pour ne citer que la première - de se dédier aux « œuvres plaçant en leur cœur aventures de forme et de fond ». Et pas mal de poésie ! Pour preuve la retraduction de Vita Nova/Une vie nouvelle de Dante Alighieri par Emmanuel Tugny. L’avertissement en page de garde (Traduction-interprétation d’E.T.) est développé dans le très court avant-propos du traducteur : « On pourrait dire, pour ne pas ajouter à tout ce qu’au sujet de l’acte de traduction l’on a pu opportunément écrire avant moi, que l’entreprise que je mène ici vise, sans fard, bien effrontément, à offrir au lecteur, non point quelque chose qui fût « de Dante », ce que je tiens évidemment pour impossible, mais quelque chose qui fût « du Dante ». En ceci, bien sûr, les pages un peu intrépides qui suivent n’innovent pas : elles revendiquent. »
Ce qui tenait à cœur à celui qui ose une « traduction-interprétation » était de ne plus perpétuer la réception de Dante comme l’auteur d’une œuvre frappée au coin de l’homogénéité d’une « esthétique », vision qui lui semble « un fourvoiement lié à la sempiternelle confusion d’essence classique entre belle œuvre et œuvre régulière ». Pour Emmanuel Tugny, Dante est plutôt un « rhapsode », un « mélangeur » ou un « mélangiste », et la beauté conçue par le célèbre Italien est plutôt « convulsive ».
En s’engageant à donner une version personnelle de cet ouvrage qu’il considère comme très immature et égotique et cependant intensément conçu et follement "voyant", le traducteur d’ Une Vie nouvelle, publié à l’été 2024, souhaitait pénétrer au cœur de l’esthétique « marquetée de Dante, ancrée dans le Moyen-âge de l'omniprésence du mystère du créé, la Renaissance de la foi en un ordre intelligible du monde et qui n'est ni vassale du sensible ni vassale de l'entendement ».
Précisons par ailleurs qu’Emmanuel Tugny n’en est pas à son premier coup d’essai de traduction d’auteurs italiens, il s’est déjà attaqué à Leopardi, Manzoni, Pirandello, da Ponte, Goldoni, toujours, ajoutera-t-il en privé « pour éviter d’entrer chez Le Tasse et de me « condamner » à des années de travail sur sa Jérusalem délivrée ».
Dante il le connaissait (en français) par la version de Jacqueline Risset si remarquable, avoua-t-il, qu’il n’osait pas « s’y colleter ». Mais un jour, incidemment, il a eu à lire un tercet du Paradis qu’un ami s’échinait à rendre, alors il a « commis l’imprudence de lui damer le pion. J’étais perdu ! » nous confie le traducteur non sans malice. Sa démarche est claire : « Je me suis fixé trois tâches, chemin faisant : la première consistait à rendre le rythme singulier de l’endécasyllabe en optant pour le décasyllabe français qui est son strict équivalent (en évitant alexandrin héroïsant, octosyllabe « chansonnisant » et prose paresseuse), la deuxième à demeurer fidèle à une certaine veine « folk », « blues », « popu » ou « populiste » (au sens de l’Histoire littéraire) du texte de Dante, la troisième à ne rien ôter au mystère chavirant des espaces métaphysiques qui peuplent ce texte où se mêlent et s’allient la physique la plus charnelle et l’abstraction la plus pure. »
Prêtons l’oreille donc aux nouveaux vers de cette « Vie nouvelle » dont je ne citerais, pour la mise en bouche, que ceux-ci : L’on voulut que nous demeurassions seuls/Amour et moi, pleurant sur son linceul./ Béatrice a gagné le ciel immense,/Où l’ange vit dans la paix de l’essence.