Soline de Laveleye, Par les baleines par Lydie Cavelier
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
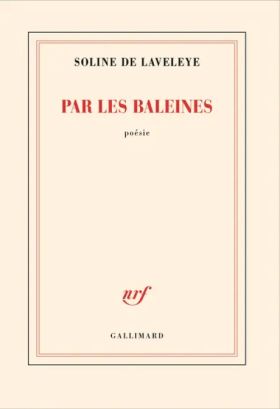
Le dispositif poétique se compose de quatre parties distribuées deux à deux autour d’un noyau central intitulé « Ronde » (I. Où l’on va de l’enfance à la mer ; II. Où la mer reflue avant de remonter ; III. Où l’on cherche ses rives ; IV. Où le large s’invite), chacune ménageant un principe d’alternance entre vers et prose. Dans ces titres métaphoriques, l’oscillation entre flux et reflux traduit l’ambition et aussi la difficulté de se faire un corps, pleinement ouvert au monde, pour qu’y convergent tout appel ou flux vital, qu’il soit élémentaire, naturel ou insufflé par des élans sensuels et amoureux. Car c'est bien à partir de ce corps, souvent emprunté, investi, mais toujours « incontenable » et ardent, qu’il s’agit de renouer les perspectives d’une vie de femme.
I. Au cœur de la Catalogne, une enfance bat à l’appel du grand large, un corps cherche à se déplier en désirs, en échappées. Puis, le cœur mord à tous les fils, donne libre cours à tous les paysages mais, tendu vers la mer infinie des idéaux, des rêves et des partages, quelque chose pourtant se défile : la « mélancolie » (28) et les unions décevantes assiègent, jusqu'au vertige. À l’embrasement de Mumbai (« hors le temps hors l’espace / je n’aurai plus de corps je n’aurai plus de nom », 35), au « dédoublement » amoureux ou aux débordements sensuels, succède un brusque repli organique : « j’ai trébuché en mère » (37). Alors, ce corps que l’ « [o]n emprunterait bien aux oiseaux » (épigraphe) se déchire, à cause des injonctions sociales notamment, comme le figurent les deux-points, béants au-dessus d’une page privée de mots : « j’étais fille aux comètes on a dit tu es femme : » (38).
II. Le reflux maritime va de pair avec l’horizon étréci, amer aussi, de la vie d’une mère. Dans la « pelote » (45) des taches réitérées, le « corps encastré » (47) pèse lourd, de « rage » (45) autant que d’élans et de désirs rentrés. Il y a tant de « bêtes » à « apprivoiser » dans un « ventre labouré », et le labeur consiste notamment à remonter le sang des « refus » (49), à désobstruer le cœur, le rendre à nouveau perméable pour dessiner sur la paume des mains d’autres lignes de vie. C'est ce à quoi l’écriture s’attelle : les vers infiltrent la prose en une sorcellerie poétique propre à embrasser tous les influx nourriciers. À travers le « corps / des oiseaux de voyage » (55) le raccord au monde prend forme, de nature : toutes « voix mêlées / m’ont recousu le tour » (56).
Au cœur du recueil, le « sens de la ronde » (61) met en jeu quelque chose comme une « forme maîtresse » (Montaigne), une armature intérieure : « Être femme n’est rien : / c'est un corps volatil » (59). D’où ce tour de force qui consiste à mettre en regard toutes les « histoires » d’« envols », de « grâces » et de « chutes » (60) et, par le biais de cette « ivresse » (65), à investir le noyau des choses, à percer toute ossature connue pour mieux déployer un monde à vivre, un corps chiasmatique, contenu autant que contenant. De fait, « ça commence où, ce corps ? Et où ça s’arrête ? » (69).
III. De « retour » au « pays », la Catalogne, « le corps n’est pas », rien « ne tient […] au corps » (80) : ce « jardin » d’enfance, « plié » (83) autour de la mort, il faut le réinvestir de manière à laisser rayonner d’autres « lignes de vie » (92). Entre « rives » et rivage d’incertitude, il est nécessaire de remonter le cours de la vie avant d’initier son redéploiement : « Est-ce le souvenir, alors, qui remue dans la gorge ? […] Des lueurs se fraient un chemin dans le corps. Ça remonte, en ondes successives » (93).
IV. In fine, le corps s’étoffe, enroulant ses « élans » (99) dans les « voix » d’hier comme d’aujourd’hui. Le souffle des échappées traverse « dans le ventre » (116) où pleins « mondes reviennent » (101) se replier-se déplier. Dedans et dehors bat le grand large qui fait corps, qui s’écarquille la « charpente », les « baleines » (104) : cette « grande respiration » (116) vient esquisser, en vers et prose, les perspectives « où convergent nos contours et le monde » (103).