Dominique Pagnier, L’Heure de rentrer par Bertrand Degott
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
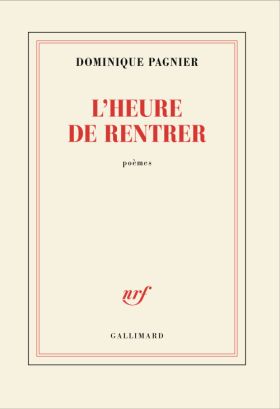
L’œuvre que Dominique Pagnier bâtit depuis plus de quarante ans — avec une cohérence qui n’a d’égale que sa modestie — s’impose à chaque nouvelle publication comme une œuvre exigeante, pour elle-même comme pour son lectorat. Mais elle fait également partie de celles, fort rares, qui rémunèrent à proportion des efforts pour y entrer. Aussi déroutant dans le récit que peut l’être un Nerval, Pagnier a, en poésie, l’évidence visionnaire d’un Follain. L’Heure de rentrer est une chronique des ébranlements du premier xxe siècle, avec pour épicentre le nord de Troyes, berceau des enfances du narrateur-poète.
66 poèmes se trouvent ici répartis en 6 scansions, dont quatre en prose. « L’Âge d’airain », la plus longue avec ses 24 poèmes, met en vedette le quotidien de la bourgeoisie de province, traversé par d’inquiétants ferrailleurs qui, s’ils évoquent le film de Sautet, font partie des autobiographèmes présents dès Faubourg des visionnaires (1990). Les deux scansions suivantes sont des galeries de portraits. « Wanderjahre », qui puise aux années de formation à l’est, ajoute aux premières amoureuses des figures essentielles, parmi lesquelles le poète allemand Peter Lober et l’Autrichienne Esther Stern qui, déjà croisée dans Le Quadrille français (2021), donne ici son nom à un poème. Dans « La Fille-Dieu, sa physiologie en quelques exemples tirés de sa vie quotidienne », le poète ravive un genre en vogue à l’époque romantique à l’occasion de sept études de mœurs consacrées à des vies de renoncement ; que lui-même réside à Troyes rue des Filles-Dieu n’est pas étranger à son intérêt pour leur modèle commun. Le souvenir des deux guerres (parmi d’autres encore, historiques ou bibliques), qui sous-tend tout le recueil, empreint tout particulièrement « L’Acier victorieux », au fil de 12 saynètes que la tragédie collective n’assombrit que pour mieux les exhausser.
Ces 50 poèmes en prose (c’est aussi le chiffre du Spleen de Paris), qui comptent entre deux et six paragraphes, n’excèdent jamais le cadre de la page : avec chacun son titre qui lui assure complétude et indépendance, ils s’irisent et chatoient comme des bulles baroques. Ce sont, grâce à l’imparfait dominant, des descriptions et des portraits qu’à leur terme fait exploser un micro-récit ou un commentaire. Ainsi du « Scandale des piastres » (9), où une bonne regarde son enfant mort-né : « “Mort, il ressemble plus encore à son père !” se dit-elle en se rappelant la façon curieuse dont, tel petit matin, on l’a bousculée dans un fossé alors qu’elle était grise. » Ainsi de « La Mouillure » (19), dont un commentaire métapoétique scelle la cohésion, en liant forme et sens :
« Dis-moi si la France était plus grande au temps des ferrailleurs ! » Telle question que posait la fillette à l’aïeule, tout à vider de ses doigts ocellés de sang un gibier à plume chassable, faisait rougeoyer davantage le soir dominical.
La lampe à l’abat-jour de fer émaillé éclairait de son cône bienveillant l’haruspice et le cahier d’histoire attendant la réponse.
S’émerveillait, à l’entresol au-dessus, la mère, une écervelée, d’une réclame pour un collier fait de vrais morceaux de lune et vendu quelques francs légers.
Fillette, aïeule et cahier, rougeoyer, émaillé, ferrailleur, émerveillait avaient en commun un son mouillé qui faisait rêver d’ailleurs.
Sans cesse la prose de Pagnier nous frotte comme ici à la chair des mots. Dans des paragraphes où l’on entend quelquefois des rimes riches — cadastres-piastres, psychopompe-pompe, charpentes-soupentes… — certaines phrases sonnent comme des vers de la meilleure facture : « On dirait que le lilas sent pour la dernière fois », par exemple, serait un distique élégiaque ou un 8-6. De « La Cousine » (47) également, le dernier alinéa aurait pu, dans un autre contexte, devenir ou rester un quatrain de décasyllabes : « À sa sœur qui la nuit part faire équipe, un enfant au lit demande où elle va. Sa réponse est qu’à l’usine on fabrique des soirs plus beaux qu’un poète en rêva ». L’attachement de Pagnier aux formes métriques nous vaut les deux dernières parties, « Le Tiroir secret » et « Bachiana », où se trouvent 6 sonnets. Les vers, des 10-syllabes pour la plupart auxquels la scansion 5-5 donne le caractère coruscant du tara-tantara, paraphrasent les Psaumes et les cantates de Bach.
« Il est une impasse en province parce qu’on n’a pas pu finir la rue. Mais, au-delà du mur du fond, le Ciel continue à fabriquer en silence un escalier où poser les pieds… » ; « La Consolation du ferrailleur » (24) nous apprend ensuite qu’un ange, pour venir au chevet d’un ferrailleur moribond, emprunte cette espèce d’échelle de Jacob. Saisi aux dimensions du recueil, ce qui se passe sur la terre n’est jamais séparé du ciel, de ses spectacles et de ses mouvements : « Les cartes à jouer sur la toile cirée ; au-dessus, les constellations de l’été… » ; « La Némésis avec glaive et balance a oublié ses maisons d’arrêt dans des cantons brumeux à faits divers. Au-dessus se fait un ciel dont la couleur trompeuse pourrait être émouvante s’il n’était celui du massacre des Innocents. » Les correspondances verticales expliquent que ces poèmes soient si souvent traversés d’anges et de personnages bibliques. C’est de Follain que Pagnier tient son art du collage et de la juxtaposition, cette aisance à passer d’une scène à l’autre, d’une période à une autre en suivant le destin d’un même personnage, en lui donnant des précédents historiques ou mythologiques. La condensation inhérente au genre du poème en prose est ici pleinement sollicitée.
Si ces pièces nous communiquent si bien le sentiment d’existence, peut-être est-ce aussi par l’attention qu’elles témoignent à l’infime, à ce que Jean Onimus appelait — à propos de Follain justement — « les profondeurs de l’insignifiant » : fourrures confiées à la naphtaline, bocaux bouchés à la paraffine, « col Claudine », « parfum appelé Mouchoir de Monsieur », encaustique qu’on chauffe « sur un réchaud Primus datant de la guerre », bromure administré dans les casernes… À plusieurs reprises l’on cherche dans cette attention au détail ce que Pagnier nous y révèle de sa manière. Sans doute son poème s’apparente-t-il en effet à une « Devinette d’Épinal » (28), de ces petites images éditées dès la fin du xixe siècle où il faut rechercher un objet ou un personnage caché. Sans doute aussi ne pouvons-nous le lire que « Par sympathie » (66), au sens où l’on parle d’encre sympathique. J’avais naguère comparé à des stéréogrammes les poèmes de son dernier recueil, Aberrations chromatiques (2018) : sans le révélateur ni la concentration nécessaire à déjouer le trompe-l’œil, l’image ou la cohérence du poème nous reste inaccessible.
Quelques mots sur ce beau titre pour finir. L’expression « l’heure de rentrer » clôt ironiquement « Le Palais-Royal est un beau quartier » (61). Certes, elle y désigne l’heure où une mère demande à sa fille de regagner le foyer mais comment pourrait-elle prévoir, en ce jour de mai où celle-ci a joué à la balle avec deux communiants, qu’ils seront quelques années plus tard ses bourreaux ? L’heure de rentrer est donc aussi la dernière heure, sinon la fin des temps et le Jugement dernier. L’Heure de rentrer est un recueil crépusculaire, où l’humour et les périphrases n’atténuent qu’en partie la violence des passions, la souffrance et la cruauté du monde. Mais quand viendra pour nous l’heure de rentrer, Pagnier nous le prophétise, nous serons sauvés par la beauté, par l’amour et la compassion. Nous serons sauvés parce que nous aurons su sourire, tendre une main — et nous émouvoir à l’occasion d’un chef-d’œuvre.