Alexis Pelletier, Là où ça veille par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
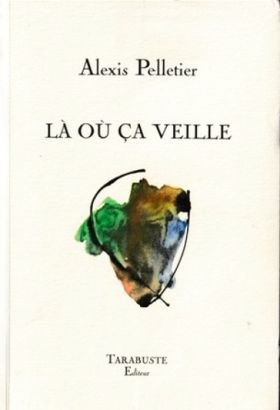
« le rêve d’un écrit sans fin toujours repris »
Qu’écrire quand un proche meurt ? Peut-on échapper à la littérature ? Qu’il s’agisse ou non de l’aimée (« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé »), aucun mot ne peut exprimer ce qui est vécu comme la perte. Littérature encore les vers de consolation quand la fille de l’ami a disparu (« Ta douleur Du Perier, sera donc éternelle (…) »). Le livre d’Alexis Pelletier appartient à cet ensemble singulier de poèmes et proses autour de la mort de l’aimé(e), ici la mère. L’écriture commence presque trente années après le décès, fondée sur des souvenirs, et ce qui fut ne peut réapparaître que par approximations successives et retours si un détail, vrai ou inventé, semble préciser le cours de l’événement. La force du livre tient à cette tentative répétée d’une reconstruction du passé, admise pour finir comme impossible, fiction (le mot est employé) qui questionne autant l’auteur et sa vie que la disparition, et également la relation à l’écriture.
Des trois ensembles du livre, le premier (le plus développé) cherche à reconstruire la scène des derniers moments de vie de la mère, cette circonstance particulière que le narrateur n’a pas vécue, « Je n’ai pas /vu l’instant sans nom le moment/ le passage où/ la vie va jusqu’au bout de la vie et s’en va ». Passage invisible même pour qui est présent — moment dont le caractère indicible a été si justement restitué par Bossuet dans une oraison funèbre, « Madame se meurt, Madame est morte »*. Ensuite avec l’éloignement dans le temps, d’autres souvenirs changent la saisie du passé, d’où dans la dernière partie d’autres réflexions sur le deuil, la relation à la mort et à l’amour. L’unité du livre tient à la place centrale du décès de la mère, à la présence continue du je-narrateur et au fait que la perception de l’espace intérieur se modifie : dans les premiers vers vient au jour « un souvenir / dans une lumière / assez sombre » et cette opacité, régulièrement répétée, dure longtemps, il faut l’achèvement du parcours de l’écriture pour que s’impose « un souvenir dans une lumière assez vive » — c’est le dernier vers. Parallèlement à l’unité des contenus est affirmée une unité formelle ; le livre débute sans majuscule et aucune n’apparaîtra en dehors des citations : la division en trois ensembles n’empêche pas alors le lecteur de penser que le récit avait peut-être déjà commencé auparavant ; l’avant-dernier vers suggère qu’il peut se poursuivre, mais autrement : « je ferme les yeux je te vois je tiens ta main », le "te" renvoyant ici à la femme aimée.
Alexis Pelletier indique qu’il a écrit plusieurs versions pour progressivement s’éloigner de la fiction. Des décennies après le décès de la mère, les souvenirs à la base du récit ne sont plus du tout assurés, rien ne peut aller contre le temps qui a déformé des moments difficiles à vivre, où le narrateur a été immédiatement préoccupé par le passage de la vie à la mort de la mère. Les années ont passé avant le temps de l’écriture et ce réel non vécu, comme d’autres éléments parmi ceux qui l’ont suivi, sont alors inatteignables, confus ou perdus. Comment sortir de cet « étrange combat entre l’oubli et la mémoire » ? seule l’écriture, reprise, peut faire revenir des souvenirs. Cependant tout ce qui est autour de la disparition demeure dans « des lumières assez sombres », alors qu’au cours de la soirée à l’Opéra à laquelle, adolescent, il avait invité sa mère, « les lumières de l’orchestre n’étaient pas sombres » — l’opposition sombre/clair accompagne l’évocation de ce qui a été en bonne partie enfoui dans la mémoire et le retour du souvenir des jours où la mort était éloignée, impossible à imaginer.
La relation à la mère, complexe, a connu des plages heureuses, notamment celles de l’enfance d’où surgissent par exemple les mots entendus au réveil, « tu as trop dormi c’est l’heure », et la vision de la fierté maternelle appréciant le choix de ses achats de livres (Verlaine en poche, pages choisies de Rimbaud en classique Larousse). Le narrateur se souvient aussi des rencontres par la musique, même décevantes. Adolescent, pour inviter sa mère à l’Opéra, il avait passé la fin de la nuit devant Garnier pour prendre des places bon marché dès l’ouverture ; pourtant, au-delà de la joie commune, ce qui demeure de cette soirée, c’est le « désaccord profond » à propos des deux cantatrices dans Jenufa, opéra de Janácek, lui très sensible au contenu et rejetant le sacrifice des femmes, elle d’abord attachée aux voix. Dans les derniers temps de la maladie, une demande a bouleversé le narrateur, « s’il te plaît mon chéri il faut me suicider » : c’était là « un dépassement de la douleur qui fait face /à la mort par l’amour ». Relation vécue mais non exprimée parce qu’absence d’échange entre la mère et le fils. Pourquoi alors écrire ce qui, par la force des choses, ne peut être en partie qu’une « fiction » — « élégie », « tombeau », « récit », « roman » ? « c’est /peut-être que la vie passe dans l’écriture/la nudité de l’amour dans la mort/rien ne/s’épuise/sauf si le désir de mots n’est qu’une/illusion un fantasme ».
Les retours sur les souvenirs, sur ce qui n’a pas été vécu, parfois le début d’analyse de ce vécu (« je m’aperçois que le deuil de Maman renvoie / à une angoisse fondatrice »), les doutes mêmes à propos de ce qui est raconté, donnent une vraie force au livre. Tout cela n’empêche pas que ce n’est pas un document, mais qu’il appartient à la littérature, à un "genre", l’autobiographie. Le lecteur qui n’aurait rien lu de l’auteur apprend d’ailleurs qu’il croyait naïvement que des études de lettres l’aideraient à devenir écrivain et, surtout, qu’il a beaucoup lu — beaucoup de noms, de renvois à des ouvrages, par exemple à Une phrase pour ma mère (de Christian Prigent), aussi qu’il maîtrise le jeu avec la langue (retravaillant l’homophonie morphine/mort fine ou en construisant une : mère morte/mer morte/amère mort). Littérature, oui, et c’est pour cela qu’il déborde complètement ce qui pourrait n’être que la relation d’un deuil.
* Bossuet, "Oraison funèbre de Henriette Anne d’Angleterre, duchesse d’Orléans" (dans Recueil des Oraisons funèbres…, Grégoire Dupuis, 1691)