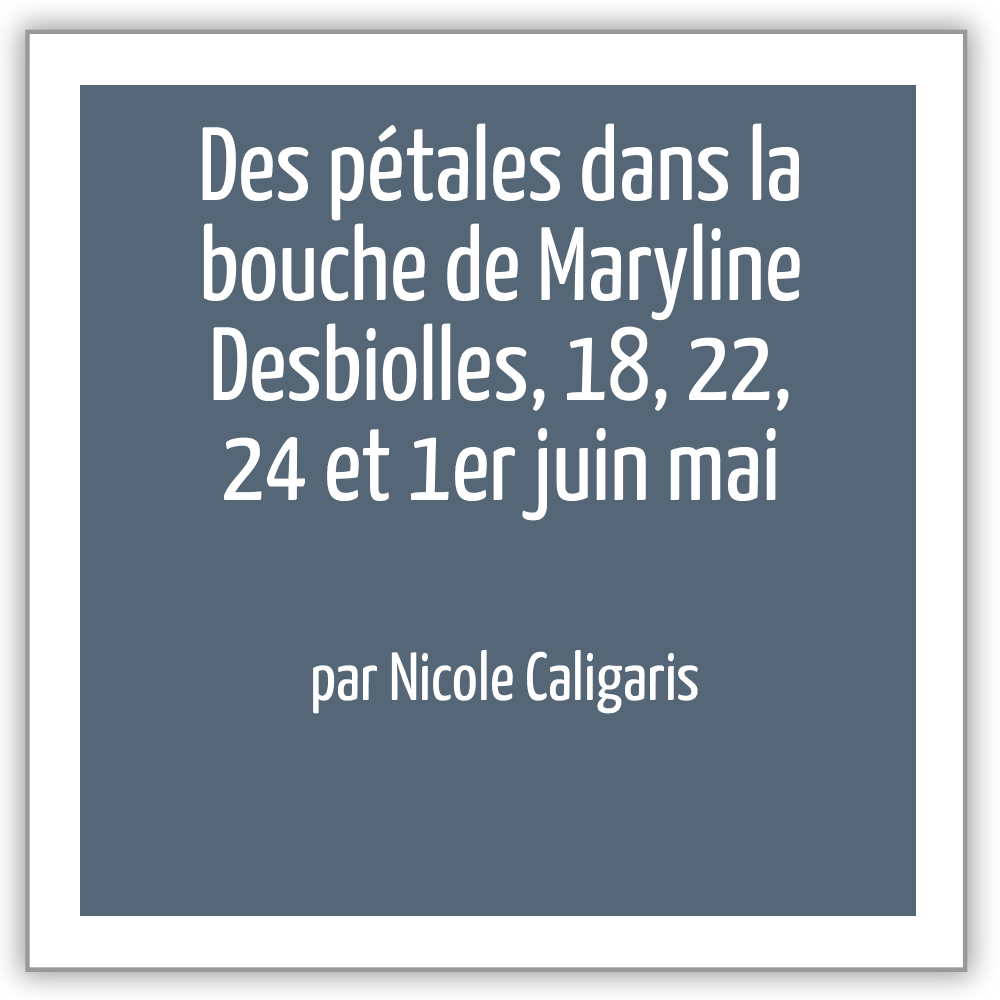Des pétales dans la bouche de Maryline Desbiolles, 18, 22, 24 et 1er juin mai par Nicole Caligaris
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
opéra pour une voix et ensemble instrumental, en un prologue et cinq tableaux.
Musique : Laurent Cuniot,
texte : Maryline Desbiolles, Seuil, 2011
créé le 18 mai à la Maison de la musique de Nanterre
mise en scène : Philippe Mercier,
création lumières : Laurent Schneegans,
avec Sylvia Vadimova, mezzo-soprano
TM+ ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui,
Laurent Cuniot direction
Argument donné au programme : « Un opéra pour une voix. Celle d'une femme à la recherche, justement de sa voix perdue. Femme aux multiples résonnances qui est elle et toutes les femme, revenant sur ses pas pour rompre le silence et renouer avec son chant intime. »
18 mai 2011
Remarques en marge du programme
La musique, c'est rare, joue de façon subtile et étroite avec le texte, met en relief la musicalité du texte qui est interne, non pas jouée à la surface, mais que la composition vient "saisir" comme l'exprime le leitmotiv du texte.
Le prologue à l'alto solo (Geneviève Strosser), magnifique, donne une ouverture immédiatement poignante.
Très belle chanteuse, elle joue, elle bouge librement, et surtout, sa joie sensible de changer de registre et même de répertoire, de passer du lyrique complexe et puissant à la chanson traditionnelle italienne.
22 mai 2011
Retour sur ma perception du spectacle
La musique, c'est rare, joue de façon subtile et étroite avec le texte, met en relief la musicalité du texte qui est interne, non pas jouée à la surface, mais que la composition vient "saisir" comme l'exprime le leitmotiv du texte. La musique fait ce que dit le texte, elle vient chercher, elle va saisir la voix du texte. Le texte ne singe pas la musique, ne s'attache pas à la surface sonore de la langue, comme je l'entends souvent dans des œuvres destinées à la scène, c'est un texte narratif et il faut entendre sa musicalité profonde, ce qu'accorde aux auditeurs la composition musicale de Laurent Cuniot.
Le prologue à l'alto solo (Geneviève Strosser), magnifique, donne une ouverture immédiatement poignante, fait connaître l'émotion du chant sans la voix, avec le timbre de cet instrument tout proche de la voix humaine, d'une voix de mezzo, féminine et basse, nous écoutons le chant d'une voix absente.
Très belle chanteuse qui a donné une superbe représentation, un personnage émouvant, changeant mille fois de couleur, elle joue, elle bouge librement, et surtout, je perçois sa joie sensible de changer de caractère et d'énergie, de registre, de répertoire même, passant du lyrique complexe et puissant à la chanson traditionnelle italienne, se nourrissant d'un duo léger flûte et clarinette, au petit air Nino Rota, d'un tambour aux évocations plus lointaines, japonaise, coréenne, soutien de l'énergie du chant.
24 mai 2011
Mon souvenir du spectacle se compose
La musique, c'est rare, joue de façon subtile et étroite avec le texte, met en relief la musicalité du texte qui est interne, non pas jouée à la surface, mais que la composition vient "saisir" comme l'exprime le leitmotiv du texte. La musique fait ce que dit le texte, elle vient chercher, elle va saisir la voix du texte. Le texte ne singe pas la musique, ne s'attache pas à la surface sonore de la langue, comme je l'entends souvent dans des œuvres destinées à la scène, c'est un texte narratif et il faut entendre sa musicalité profonde, ce qu'accorde aux auditeurs la composition musicale de Laurent Cuniot.
Il me reste l'impression que le livret lui-même est une composition, que le récit est un tissu mouvant entre la scène et le rêve, entre la situation réaliste d'une femme qui attend un amoureux qui tarde à la joindre, qui fait douter de son amour, et la rêverie de cette femme, l'espace scénique qu'elle ouvre à l'intérieur d'elle-même, où se produisent des départs, des branches du récit, fleuries, des branches du prunier qui est aussi la promesse et le leitmotiv du texte. Et c'est ce mouvement d'appréhension, de germination et d'éclosion que va saisir et donner la musique.
Le prologue à l'alto solo (Geneviève Strosser), magnifique, donne une ouverture immédiatement poignante, fait connaître l'émotion du chant sans la voix, avec le timbre de cet instrument tout proche de la voix humaine, d'une voix de mezzo, féminine et basse, nous écoutons le chant d'une voix absente.Il me semble que la voix de la chanteuse fait irruption, dans une énergie chaotique, en pleine agitation, dans un halètement, sur une ligne brisée entre chant et parole, dans un parlé-chanté, un presque chant que des suspensions coupent. J'ai le sentiment que l'opéra commence en pleine tension, à un point de tension, même, que le chant ne trouve pas son souffle.
Très belle chanteuse qui a donné une superbe représentation, un personnage émouvant, changeant mille fois de couleur, elle joue, elle bouge librement, et surtout, je perçois sa joie sensible de changer de caractère et d'énergie, de registre, de répertoire même, passant du lyrique complexe et puissant à la chanson traditionnelle italienne, se nourrissant d'un duo léger flûte et clarinette, au petit air Nino Rota, d'un tambour aux évocations plus lointaines, japonaise, coréenne, soutien de l'énergie du chant.
Je suis émue par l'expression du corps de Sylvia Vadimova, elle donne à voir cette solitude absolue de femme que son chant, que la musique qu'elle forme, depuis son corps simplement, expose, dans sa vulnérabilité la plus grande ; elle offre le risque de cette vulnérabilité, elle le fait ressentir puissamment sans apparaître fragile, au contraire, dans le paradoxe d'une énergie magnifique qui porte le spectacle et le dédie au chant, aux possibilités de la voix humaine, à ses amplitudes troublantes, particulièrement dans ses basses superbement plastiques.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à La Voix humaine, de Jean Cocteau et Francis Poulenc. J'ai l'impression que les Pétales sont comme une réconciliation de La Voix humaine. J'y retrouve cette oscillation musicale entre la voix théâtrale et la voix lyrique. La Voix humaine raconte une rupture, fait entrer l'auditeur dans la solitude poignante et le lien douloureux d'une femme au téléphone avec l'amant qui la laisse pour partir en voyage avec une autre. De La Voix humaine, Les Pétales réussissent à garder la tension dénudée de son mélo. J'imagine Les Pétales comme la réconciliation de cette femme, non pas avec l'amant mais avec elle-même et sa force vive, sa voix. La femme fait le voyage, dans Les Pétales. Un voyage vers le baiser. C'est sa bouche qui l'accomplit, ce voyage, dans la métamorphose de l'aspiration en chant, vers l'amour même.
Peut-être que la réconciliation se noue dans le seul duo de l'œuvre, entre chanteuse et tambour, au moment où la voix rejoint sa palpitation, son battement intime. Son battement, que le toucher léger du musicien glisse entre perception et songe.
1 juin
C'est une autre histoire,
à la lecture du livret.
Le texte, composé en cinq mouvements, commence, sans prologue, dans un emportement, un à corps perdu, une évocation d'enfance, de conte, la fureur d'un cavalier, le corps de la cavalière en croupe comme démantelé, désintégré, intégré à celui du cavalier. Je révise ma perception du récit, je vois, dans la succession des mouvements du texte, se produire des rappels, des convocations d'états d'enfance. J'y rencontre un double motif que je n'avais pas assez entendu dans l'opéra, celui de la chute et de la cavité : la bouche, la fosse. Et un très intéressant mouvement d'infini : deux courbes inverses se croisent et se joignent pour se donner l'une à l'autre l'élan. Le texte semble raconter une poursuite : celle d'une femme, tantôt « je », tantôt « tu », tantôt « vous », tantôt « nous », une femme qui n'est plus la synthèse de tous ses états, qui n'est plus une identité, qui songe à se hâter pour rattraper sa voix en allée, sa voix au-devant d'elle, au-delà de son souffle, sa voix déjà rendue, au bout : « c'est votre mort qui vous prend votre voix. » Mais je lis aussi la renverse de ce mouvement de poursuite, la fugue, dont l'ouverture est l'un des récits d'enfance, une fugue minuscule. Dans le souvenir de cette fugue se trouve le point vif, la vie même, secrète, intensité inaliénable, bonheur. C'est ce mouvement de fugue qui conduit l'échappée vers le baiser, le renouveau de la palpitation. Une branche vive suffit pour que fleurisse le prunier sec. Je lis autrement la phrase qui fait basculer dans le voyage : « C'est votre mort qui vous prend votre voix », je lis la mort comme la sécheresse, écrasement, paralysie, l'inenfance de la vie, je lis que c'est cette intensité d'enfance dont se trouve abandonnée la femme défaite de sa voix, et que cette enfance se trouve au-devant, là-bas, vers quoi elle se hâte pour, non pas exactement la rattraper mais s'en laisser ressaisir.
Qui sait si le baiser final ne précède pas le début du texte, le cavalier, le cheval, l'emportement qui est un rapt, les corps confus ?
Musique : Laurent Cuniot,
texte : Maryline Desbiolles, Seuil, 2011
créé le 18 mai à la Maison de la musique de Nanterre
mise en scène : Philippe Mercier,
création lumières : Laurent Schneegans,
avec Sylvia Vadimova, mezzo-soprano
TM+ ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui,
Laurent Cuniot direction
Argument donné au programme : « Un opéra pour une voix. Celle d'une femme à la recherche, justement de sa voix perdue. Femme aux multiples résonnances qui est elle et toutes les femme, revenant sur ses pas pour rompre le silence et renouer avec son chant intime. »
18 mai 2011
Remarques en marge du programme
La musique, c'est rare, joue de façon subtile et étroite avec le texte, met en relief la musicalité du texte qui est interne, non pas jouée à la surface, mais que la composition vient "saisir" comme l'exprime le leitmotiv du texte.
Le prologue à l'alto solo (Geneviève Strosser), magnifique, donne une ouverture immédiatement poignante.
Très belle chanteuse, elle joue, elle bouge librement, et surtout, sa joie sensible de changer de registre et même de répertoire, de passer du lyrique complexe et puissant à la chanson traditionnelle italienne.
22 mai 2011
Retour sur ma perception du spectacle
La musique, c'est rare, joue de façon subtile et étroite avec le texte, met en relief la musicalité du texte qui est interne, non pas jouée à la surface, mais que la composition vient "saisir" comme l'exprime le leitmotiv du texte. La musique fait ce que dit le texte, elle vient chercher, elle va saisir la voix du texte. Le texte ne singe pas la musique, ne s'attache pas à la surface sonore de la langue, comme je l'entends souvent dans des œuvres destinées à la scène, c'est un texte narratif et il faut entendre sa musicalité profonde, ce qu'accorde aux auditeurs la composition musicale de Laurent Cuniot.
Le prologue à l'alto solo (Geneviève Strosser), magnifique, donne une ouverture immédiatement poignante, fait connaître l'émotion du chant sans la voix, avec le timbre de cet instrument tout proche de la voix humaine, d'une voix de mezzo, féminine et basse, nous écoutons le chant d'une voix absente.
Très belle chanteuse qui a donné une superbe représentation, un personnage émouvant, changeant mille fois de couleur, elle joue, elle bouge librement, et surtout, je perçois sa joie sensible de changer de caractère et d'énergie, de registre, de répertoire même, passant du lyrique complexe et puissant à la chanson traditionnelle italienne, se nourrissant d'un duo léger flûte et clarinette, au petit air Nino Rota, d'un tambour aux évocations plus lointaines, japonaise, coréenne, soutien de l'énergie du chant.
24 mai 2011
Mon souvenir du spectacle se compose
La musique, c'est rare, joue de façon subtile et étroite avec le texte, met en relief la musicalité du texte qui est interne, non pas jouée à la surface, mais que la composition vient "saisir" comme l'exprime le leitmotiv du texte. La musique fait ce que dit le texte, elle vient chercher, elle va saisir la voix du texte. Le texte ne singe pas la musique, ne s'attache pas à la surface sonore de la langue, comme je l'entends souvent dans des œuvres destinées à la scène, c'est un texte narratif et il faut entendre sa musicalité profonde, ce qu'accorde aux auditeurs la composition musicale de Laurent Cuniot.
Il me reste l'impression que le livret lui-même est une composition, que le récit est un tissu mouvant entre la scène et le rêve, entre la situation réaliste d'une femme qui attend un amoureux qui tarde à la joindre, qui fait douter de son amour, et la rêverie de cette femme, l'espace scénique qu'elle ouvre à l'intérieur d'elle-même, où se produisent des départs, des branches du récit, fleuries, des branches du prunier qui est aussi la promesse et le leitmotiv du texte. Et c'est ce mouvement d'appréhension, de germination et d'éclosion que va saisir et donner la musique.
Le prologue à l'alto solo (Geneviève Strosser), magnifique, donne une ouverture immédiatement poignante, fait connaître l'émotion du chant sans la voix, avec le timbre de cet instrument tout proche de la voix humaine, d'une voix de mezzo, féminine et basse, nous écoutons le chant d'une voix absente.Il me semble que la voix de la chanteuse fait irruption, dans une énergie chaotique, en pleine agitation, dans un halètement, sur une ligne brisée entre chant et parole, dans un parlé-chanté, un presque chant que des suspensions coupent. J'ai le sentiment que l'opéra commence en pleine tension, à un point de tension, même, que le chant ne trouve pas son souffle.
Très belle chanteuse qui a donné une superbe représentation, un personnage émouvant, changeant mille fois de couleur, elle joue, elle bouge librement, et surtout, je perçois sa joie sensible de changer de caractère et d'énergie, de registre, de répertoire même, passant du lyrique complexe et puissant à la chanson traditionnelle italienne, se nourrissant d'un duo léger flûte et clarinette, au petit air Nino Rota, d'un tambour aux évocations plus lointaines, japonaise, coréenne, soutien de l'énergie du chant.
Je suis émue par l'expression du corps de Sylvia Vadimova, elle donne à voir cette solitude absolue de femme que son chant, que la musique qu'elle forme, depuis son corps simplement, expose, dans sa vulnérabilité la plus grande ; elle offre le risque de cette vulnérabilité, elle le fait ressentir puissamment sans apparaître fragile, au contraire, dans le paradoxe d'une énergie magnifique qui porte le spectacle et le dédie au chant, aux possibilités de la voix humaine, à ses amplitudes troublantes, particulièrement dans ses basses superbement plastiques.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à La Voix humaine, de Jean Cocteau et Francis Poulenc. J'ai l'impression que les Pétales sont comme une réconciliation de La Voix humaine. J'y retrouve cette oscillation musicale entre la voix théâtrale et la voix lyrique. La Voix humaine raconte une rupture, fait entrer l'auditeur dans la solitude poignante et le lien douloureux d'une femme au téléphone avec l'amant qui la laisse pour partir en voyage avec une autre. De La Voix humaine, Les Pétales réussissent à garder la tension dénudée de son mélo. J'imagine Les Pétales comme la réconciliation de cette femme, non pas avec l'amant mais avec elle-même et sa force vive, sa voix. La femme fait le voyage, dans Les Pétales. Un voyage vers le baiser. C'est sa bouche qui l'accomplit, ce voyage, dans la métamorphose de l'aspiration en chant, vers l'amour même.
Peut-être que la réconciliation se noue dans le seul duo de l'œuvre, entre chanteuse et tambour, au moment où la voix rejoint sa palpitation, son battement intime. Son battement, que le toucher léger du musicien glisse entre perception et songe.
1 juin
C'est une autre histoire,
à la lecture du livret.
Le texte, composé en cinq mouvements, commence, sans prologue, dans un emportement, un à corps perdu, une évocation d'enfance, de conte, la fureur d'un cavalier, le corps de la cavalière en croupe comme démantelé, désintégré, intégré à celui du cavalier. Je révise ma perception du récit, je vois, dans la succession des mouvements du texte, se produire des rappels, des convocations d'états d'enfance. J'y rencontre un double motif que je n'avais pas assez entendu dans l'opéra, celui de la chute et de la cavité : la bouche, la fosse. Et un très intéressant mouvement d'infini : deux courbes inverses se croisent et se joignent pour se donner l'une à l'autre l'élan. Le texte semble raconter une poursuite : celle d'une femme, tantôt « je », tantôt « tu », tantôt « vous », tantôt « nous », une femme qui n'est plus la synthèse de tous ses états, qui n'est plus une identité, qui songe à se hâter pour rattraper sa voix en allée, sa voix au-devant d'elle, au-delà de son souffle, sa voix déjà rendue, au bout : « c'est votre mort qui vous prend votre voix. » Mais je lis aussi la renverse de ce mouvement de poursuite, la fugue, dont l'ouverture est l'un des récits d'enfance, une fugue minuscule. Dans le souvenir de cette fugue se trouve le point vif, la vie même, secrète, intensité inaliénable, bonheur. C'est ce mouvement de fugue qui conduit l'échappée vers le baiser, le renouveau de la palpitation. Une branche vive suffit pour que fleurisse le prunier sec. Je lis autrement la phrase qui fait basculer dans le voyage : « C'est votre mort qui vous prend votre voix », je lis la mort comme la sécheresse, écrasement, paralysie, l'inenfance de la vie, je lis que c'est cette intensité d'enfance dont se trouve abandonnée la femme défaite de sa voix, et que cette enfance se trouve au-devant, là-bas, vers quoi elle se hâte pour, non pas exactement la rattraper mais s'en laisser ressaisir.
Qui sait si le baiser final ne précède pas le début du texte, le cavalier, le cheval, l'emportement qui est un rapt, les corps confus ?