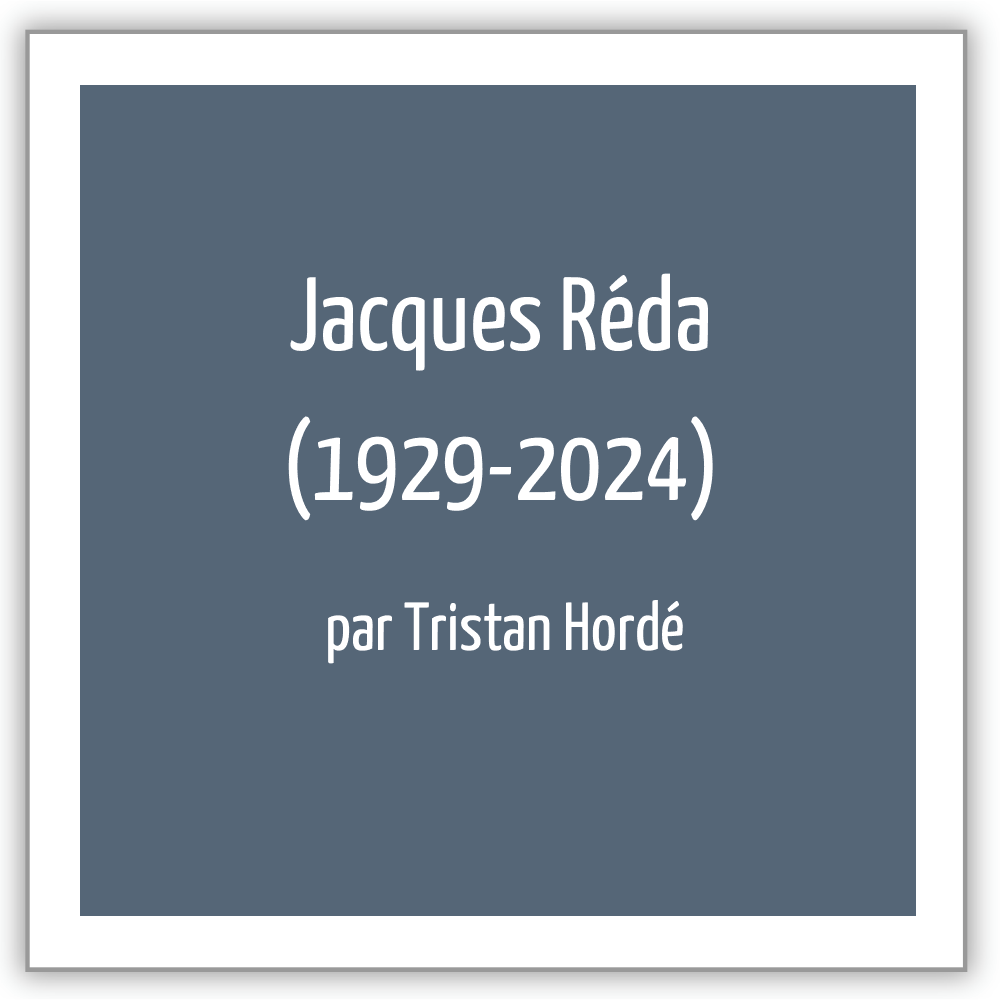Jacques Réda (1929-2024) par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Rencontres et lectures
Une grande pièce et sur un semblant d’estrade une batterie presque complète, sur des étagères un nombre impressionnant de soldats de plomb apparemment rangés par régiments — « Je m’exerce un peu, je ne suis pas Art Blakey. Les soldats de plomb… ; vous êtes sorti de l’enfance, vous ? »
C’était à la fin des années 1980, dans le quinzième arrondissement, et l’entretien dura des heures, à propos de Paris, du vers, du jazz (Réda était chroniqueur dans Jazz Magazine depuis les années 1960), de la campagne, du vin, des avantages du solex en ville, de Charles Albert Cingria, de la poésie contemporaine (il dirigeait La NRF), des anciennes lignes de chemin de fer, de ses premières publications (introuvables, mais présentes à la Bibliothèque nationale). De tout. Toujours sérieux mais avec humour. Défense argumentée du vers français dont il connaissait parfaitement l’histoire. Impossible d’oublier l’énergie de Jacques Réda, son refus aussi d’être vu comme un « poète » — il avait alors publié une vingtaine de livres —, son extrême modestie, son écoute toujours attentive et le souci de répondre aux questions qui avaient dû lui être souvent posées.
Quelques rares rencontres ensuite, les dernières dans le vingtième où il s’était installé, et près de la place Saint-Sulpice, où le consumérisme triomphant a instauré un marché et « voué un mois comme à la Vierge Marie », ce qu’il fustige dans Mes sept familles. Restent les livres, toujours relus, nombreux quand on a écrit pendant un peu plus de soixante-dix ans. On l’y retrouve, entier, même si parfois masqué. Relectures.
Le préambule de Mes sept familles (fario, 2022), à propos de ses « ascendants littéraires » (p. 7) :
(…) tout ce que j’ai lu depuis que j’ai appris à lire et à écrire, et qui était souvent sans rapport avec la littérature (absente du milieu où je vivais), a aussitôt suscité chez moi un réflexe d’imitation qui m’a longtemps laissé douter d’avoir, littérairement, une singularité quelconque — si j’en ai une, et il ne m’appartient pas d’en décider.
Un "auto-portrait", celui qui ouvre Les ruines de Paris (Gallimard, 1978, p. 14) :
Je rentre. Il y a des œufs, du fromage, du vin, beaucoup de disques où, grâce à des boutons, on peut mettre en valeur la partie de la contrebasse. Ainsi je continue d’avancer, pizzicato. Est-ce que je suis gai ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que j’avance vers une énigme, une signification ? Je ne cherche pas trop à comprendre. Je ne suis plus que la vibration de ces cordes fondamentales tendues comme l’espérance, pleines comme l’amour.
Toujours dans Les ruines de Paris (p. 153) :
Une fois de plus c’est au coin de ce buffet de gare que je vais pleurer. Au moins les gens du quai d’en face peuvent croire que j’éternue. Et je pleure de tout mon corps devant cette solitude, même si quand même après des mois j’allais retrouver quelqu’un. C’était un autre soir, en octobre. Impossible de m’en empêcher mais ça ne durera pas. Je me demande ce qui dure.
Réda a régulièrement écrit à propos du vers, du sien, plus généralement de son statut aujourd’hui. Une partie importante de ses réflexions dans Celle qui vient à pas légers (Fata Morgana, 1999) sont reprises et développées dans un long entretien : Alexandre Prieux & Jacques Réda, Entretien avec Monsieur Texte (fario, 2020). Quelques extraits :
J’ai écrit en vers réguliers, en vers libres, en versets et en prose, et je n’ai rien inventé, pas même, contrairement à ce que croient certains spécialistes de la poésie française qui ne la connaissent pas très bien, le vers de quatorze syllabes, ni le vers mâché. (p. 106)
Il faut comprendre que [les] formes fixes, que le vers-libriste regarde comme des obstacles intolérables à la liberté de son inspiration, sont, dans la langue, un équivalent des exercices de solfège qui n’ont pas de valeur poétique en eux-mêmes, mais qui permettent à cette inspiration de se manifester à plein, et non derrière le rideau de fumée des coupes arbitraires et des images dont l’abondance est le produit d’un système devenu lui-même producteur à bon compte d’anti-clichés inanes. (p. 110)
Etc. Qu’est-ce que la poésie peut exprimer de la « réalité » ? Le vers compté est certes un artifice mais il favorise notre contact avec ce fond insaisissable de la réalité qu’est le rythme, donc l’approche d’« une saisie éternisée de l’instant ». Comme le fait le swing : Réda traduit le titre de Charlie Parker, It’s the time par « maintenant est toujours le seul moment qui compte ». Seule manière d’accepter cette « vie incompréhensible », comme il l’écrit dans Les ruines de Paris (p. 144). Quelle autre issue ?
Peut-être que si je réussissais enfin à tout décrire, à l’instant même où le moindre brin d’herbe ou de fil de fer paraît, je comprendrais quel rôle ambulant je tiens moi dans ce rythme, dans cet ordre dont s’exerce la poigne extatique partout — des mouvements de cinq gamins en train de shooter une balle, à ce gui noir dans les peupliers établi comme une partition. (pp. 146-147).
Mais il faudrait toujours recommencer… C’est pourquoi Jacques Réda a publié en 2023 Leçons de l’Arbre et du Vent (Gallimard).