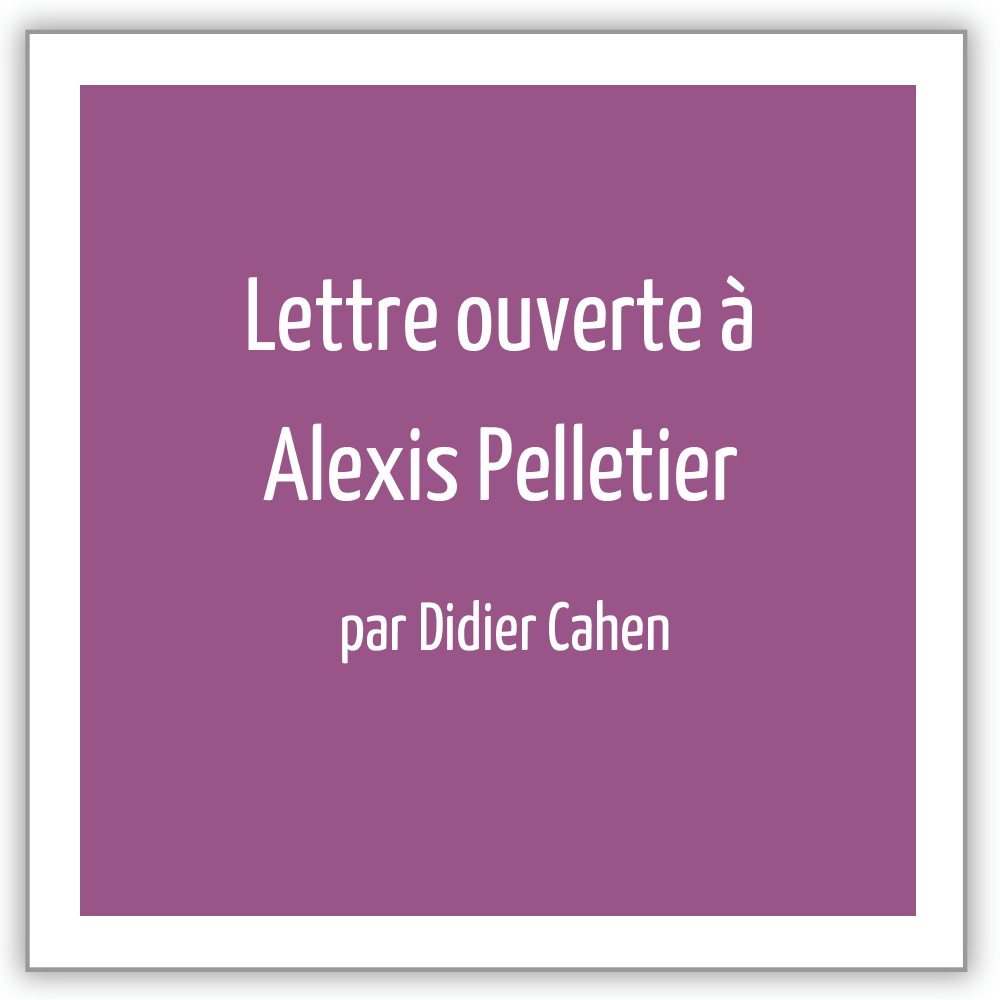Lettre ouverte à Alexis Pelletier par Didier Cahen
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Ah, comment te dire, cher Alexis ? Quel livre... Mlash a changé de voix et prend une nouvelle consistance. « Il faut que tu me suives » : on tremble d’abord, puis on se plie très facilement à « l’ordre » du titre ; proposition, en vérité mais j’aime le semblant ou simulacre d’autorité, d’autodérision assumée qu’il contient ou/et révèle. Voici un livre que j’aurais aimé écrire. Je m’y retrouve à chaque coin de page même si bien, sûr, ton livre est singulier, poème, poème du monde, poème d’amour, traité (intraitable) de poétique contemporaine et autobiographie - mieux vaut parler probablement d’anthologie ou d’archéologie personnelle. Mais, évidemment, le présent, « le présent du présent », va bien au-delà de cette remarque rapide. Que dire de la justesse du ton et sur toute la durée, pas le plus commode mais beau et vrai signe d’authenticité ; quelle mise à nue d’une pudeur impeccable ! Que dire de la simplicité (apparente) de ton texte qui permet de mieux faire résonner ses mille remarques, trouvailles, réflexions, sensations, émotions (inséparables du reste), annotations (en tordant le cou, mais sans sévérité, à une supposée « sagesse millénaire » - très belles variations, par exemple, sur le rien) , propositions, constats, aveux, sans oublier tes doutes et tes incertitudes, tout aussi bien, fort heureusement, tes certitudes qui disent le fruit de l’expérience... ; bref, les mille et unes notes d’un livret infiniment ouvert. Tu connais, bien sûr, cette remarque si juste d’André du Bouchet : « je ne pense pas je note », pour dire avec la distance nécessaire ce qui se passe quand on est face au monde, aux événements - à l’événement - du monde. J’ai beaucoup copié, recopié et te volerai sûrement quelques-uns de tes mots ou de tes phrases, qui disent tout aussi bien les vérités de l’aventure, la plasticité de l’expérience, la réalité du geste poétique ici et maintenant : oui à ce « coudre ensemble (133)», oui à la place du « et » (208)... et oui encore à cette « tentative de faire entrer dans le poème quelque chose du monde (160) », en l’écrivant avec le doigté nécessaire et , surtout, surtout, sans faire de manières... Juste en formant, en informant des mots et phrases qui tiennent, qui prennent très simplement, tout simplement ; il faudrait réfléchir à la nature et au rythme de ta phrase pour commencer à dire des petites choses un peu sensées à propos de ton écriture. Si tu le veux bien, je me contenterai de cette petite formule : poème toucher et « poème, ralentir » (170). Tout est affaire de rythme et d’arythmie, dis-tu, mêlant le quotidien avec les emballements du cœur... Mais j’oublie trop ici (c’est très injuste !) la part d’intimité partagée dont je ne sais trop comment on peut parler. Ton texte est d’une grande richesse mais en même temps pacifié, lumineux, d’une belle et nécessaire douceur : « avec aussi le plaisir de voir/le réveil ou l’endormissement du monde/de sentir le vent/d’entendre la mer et l’amour encore/et de ne pas savoir de quoi/se compose le temps/si ce n’est cette chose qui entraîne/le présent du présent/le plaisir de marcher dans la nuit/jusqu’au jour ... » ; très proche d’une certaine forme de tendresse, ce « petit bruit de la langue » ; lyrique, mais d’un lyrisme hautement tempéré, musical, musique écrite et donc jamais sonorisée, seulement vocalisée, donc très précisément poétique. Le poème coule de source et parle avec un très subtile dosage de gravité et de fragilité assumées, porté par son inspiration comme on disait naguère ; c’est comme ça qu’il ex-pose toute la belle précision de la voix et du geste : « il fait jour dans ce poème (...) toujours dans l’obscurité/mais avec la lumière en elle/ ou l’inverse l’obscurité/dans la lumière ». On te suit, je te suis. Bravo et merci ; ton livre est infiniment précieux en ces « dürftiger Zeit »