Olivier Barbarant, Partitas pour un violon seul par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
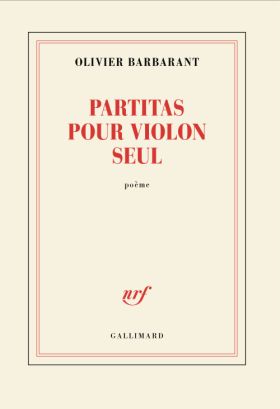
Le livre réunit six ensembles, dont plusieurs déjà publiés dans des revues, sous le signe de la musique dès le titre, "partita" impliquant aussi l’idée de variations. Un des groupements de poèmes évoque avec "chaconne" ("Chaconne pour une planète") une danse à trois temps née au XVIIe siècle ; un autre est plus explicite, "Musiques sur quelques départs". Enfin la conclusion du premier texte en exergue consacré à l’emploi par Bach du violon pourrait résumer ce qu’ambitionne Olivier Barbarant dans le recueil, « [à propos du violon chez Bach, instrument double, harmonique et symphonique] Cette dimension porteuse d’opacité, de relief et d’une sorte d’au-delà de lui-même. Cet équilibre aussi d’un cante jondo [chant profond] ne sortira rien qui se contente d’être lisse et beau, mais âpre et réel et vrai ».
"Enfantines" ouvre le livre avec une quadruple référence dans le premier poème : le titre, « Qui je fus », est emprunté à Michaux1, le port dans l’adolescence du triangle rose2 est une allusion transparente à l’homosexualité, des noms d’écrivains, un d’une femme politique, sont ceux des modèles à égaler (« devenir Hugo, Gide, Verlaine, ou Louise Michel) », est cité Glenn Gould avec son « jeu très lent construit au bord du gouffre » dans son interprétation des Variations Goldberg de Bach. On peut lire là une manière de programme. Comme Michaux dans Qui je fus Olivier Barbarant s’appuie souvent ensuite sur des éléments biographiques : amours homosexuelles, rappel du lien à Aragon à propos de qui il a publié plusieurs livres (ici, le titre du second ensemble est l’incipit d’un chapitre d’Aurélien), souvenirs de l’enfance, etc. Le dernier groupe de poèmes se présente comme un bilan (« Quelle étrange vie à la fin / (…)/ Aura été la tienne »), avec à nouveau la présence de Paris, des proches qui portent des prénoms issus d’Aurélien, l’amour au centre de sa vie, les disparitions (« Vivre était donc apprendre à perdre ») et un sentiment de solitude, « Sans doute la plupart ignorent / Que j’ai su si bien les aimer ».
Le recueil est dominé par deux motifs complémentaires : la fin accélérée du monde et la manière dont l’individu peut vivre ce désastre. « Toute la terre est périssable », ce qu’annonce le rappel elliptique de destructions récentes, « Des tours jumelles. Des cathédrales / Une centrale […] ». Ce qui est détaillé, c’est la disparition future des œuvres d’art, « Il ne restera rien de nos musiques mortes », ni de Matisse, Chardin ou Caravage. Mais rien non plus du "nous", des humains comme individus : devenus un « troupeau docile ». Cet avenir n’est pas l’Apocalypse de la religion, seulement une conséquence des actions humaines qui aboutiront au néant, au rien, à « l’ultime chaos ». S’il est à faire une prière — tout à fait inutile cependant — elle ne s’adresse pas à un dieu absent mais aux humains, « Ayons pitié de nous / Ayons pitié de nous ». On note le choix du 12-syllabes ou du décasyllabe, vers "nobles", pour chaque fois conclure des annonces de destruction (« Mais qui entend vraiment la cloche d’incendie », « Pas de grand écran pour notre agonie »). Ce tableau sombre, désespéré, préfigure le sort de l’humanité et il n’est pas difficile de penser qu’il ne s’agit pas d’une fiction, tant se manifeste en effet une indifférence générale, pas seulement celle des gouvernants, devant l’extinction d’espèces animales ou les changements du régime des eaux. Que faire quand tous les signes d’une catastrophe s’accumulent.
La réponse d’Olivier Barbarant n’est pas un sauve-qui-peut, plutôt le choix de retenir ce qui reste pour, chacun, vivre au mieux le présent : « dans cet enfer promis / Passent quelquefois des abeilles » (souligné par moi), au béton opposer la glycine et au rien « un autre infini » constitué par la lumière, le vent, les fleurs, les oiseaux, les regards, les échanges, « Un accord entre deux pensées ». Partir du fait que « L’essentiel n’existe qu’à peine » implique que tout ce qui éloigne du désastre est fragile, que l’on ne saisira que des « buées », des « balbutiements », des « instants », des « miettes », « une poudre »,
Pour toute force l’éphémère
la vraie vie parie sur le givre
qu’on regarde aux fenêtres fondre
On se proposera de lire, de regarder, d’écouter, d’écrire peut-être, sachant que toutes les œuvres humaines disparaîtront, comme disparaissent les lieux que l’on a connus et appréciés, et l’on comprendra que l’amour dans tous les sens du mot appartient à la « vraie vie »,
L’art et l’amour ouvrent l’amande
du monde enfin déshabillé
dont ne tombent que les mensonges
L’amour des corps, homosexuel ou non, sauve donc du gouffre par la beauté des corps ou la grâce de l’étreinte, même quand elle a lieu au fond d’un garage. C’est le fait d’être deux qui donne un sens à sa propre existence, ce que reprend Olivier Barbarant sous différentes formes, « L’important n’est pas de savoir qui l’on est / mais ce que d’un corps l’on offre à la vie ».
Les poèmes d’Olivier Barbarant ne cherchent pas à innover en abandonnant toute règle : pas de tentative de faire naître le sens par l’illisible ou en prétendant fonder une autre langue. Comme d’autres contemporains (Ristat ou Paulin, par exemple), il utilise le vers libre compté (surtout l’hexa- et l’octosyllabe), ne néglige pas les images (« une farine de visages », « la neige du sourire », etc., l’anaphore ou l’énumération qui arrête un instant la variété du réel. Il s’agit toujours de saisir ce qui ne dure pas, de dire et redire que ce « monde menacé » peut encore être « l’écho d’être deux ».
1 Henri Michaux, Qui je fus, "Une Œuvre un Portrait", Gallimard, 1927.
2 Le triangle rose était le symbole porté par les homosexuels masculins dans l’univers concentrationnaire nazi ; les lesbiennes portaient le triangle noir, symbole désignant les asociaux..