François Rannou, Le Masque d’Anubis par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
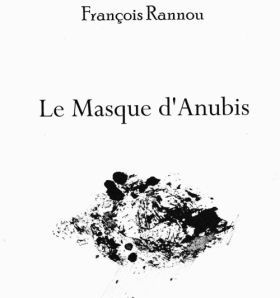
Le titre engage une lecture du livre. Le masque à tête de chien noir ou de chacal, représentation du dieu Anubis, était dans l’Égypte ancienne porté par les prêtres quand ils embaumaient un cadavre pour l’empêcher de se corrompre ; Anubis avait le pouvoir de faire passer le mort dans une autre vie, pouvoir délégué aux embaumeurs. La mort est bien présente dans les poèmes mais la vie naissante ou renaissante l’est également, toutes deux posées comme toujours imprévisibles, ce qu’énoncent les premiers vers d’un poème cité d’Emily Dickinson :
Nous ne savions pas que nous allions vivre —
Ni quand — nous allions mourir —
C’est dans la vie de tous les jours, dans ce monde où le travail occupe une grande partie du temps à vivre qu’est ressentie la brutalité d’une disparition, qu’est éprouvée fortement la venue d’une naissance. Le caractère énigmatique de cette balance mort/naissance est mise en relief par le renvoi à un lointain religieux qui prétendait maîtriser « l’éclat du désastre » et « le commencement du temps ».
Le narrateur a échappé à la mort à la suite d’un AVC et il connaît alors l’examen qui aboutit à une image précise du cerveau ; homme du livre, il compare immédiatement le résultat à un texte qui exigera une lecture, « je suis le livre qui s’imprime / pour des yeux experts. Les "images" fournies par la machine rendent compte de ce qui n’est pas visible, semblable à des « mots obscurs », comme s’il s’agissait de hiéroglyphes que traduit le travail patient de spécialistes, et il est alors proposé une « édition nouvelle inconnue » de la personne. Le parallélisme entre l’époque de Khéops et le présent apparaît encore à propos d’un patient à l’hôpital ; depuis le début du XXIe siècle, les savants ont déchiffré les notes concernant la construction de la grande pyramide, et sont analogues celles du « cahier de transmission » qui suit l’évolution de la maladie.
Quoi que l’on relève au fil des jours, « l’agonie » survient sans que les proches puissent la prévoir. C’est ce passage du vif au mort qui est interrogé ; dans le silence de la chambre est « guetté le moindre signe » ; c’est lorsque l’on entend à nouveau le trafic de la rue, qui ne s’était pas interrompu, que l’on comprend : « elle a disparu ». Énigme que rien ne peut résoudre et François Rannou use de comparaisons pour en faire percevoir le caractère, par exemple avec une allusion au regard de La jeune fille à la perle de Vermeer impossible à déchiffrer. Ou constater que, la tombe ouverte étant vide, le mort a retrouvé la vie — au moins si l’on croit à la divinité du Christ. Ou encore « retenir l’enfance par les bords dentelés d’une photographie ». Par les mots, oublier la disparition à 84 ans d’une proche et ne se souvenir que de la fillette qu’elle a été « à l’autre bout du temps ».
Cet autre bout du temps revient sans cesse dans Le Masque d’Anubis. La fillette au pensionnat traverse le dortoir pour longuement regarder par la fenêtre le parc, soit le dehors, les arbres, le vivant. Un autre personnage « de sa / fenêtre (…) voit les premières fleurs aux branches ». Le narrateur, lui, s’approche de la fenêtre pour chasser ce qui l’emprisonnait et voir son « vrai visage ». Pourtant, si l’on peut constater le mouvement de la vie à la mort, rien ne semble donner une clé pour le comprendre ; un poème titré "Méditation" met en scène un homme qui « pisse contre le tronc d’un prunier » ; il est donc ancré dans la nature et tout dans ses pensées, mais « aucune langue connue ne peut / traduire son désir d’origine ».
Même si les renvois aux mythologies sont réguliers, aucune religion ne donnera une réponse satisfaisante — que l’on se tourne vers l’Égypte, vers Asclépios (foudroyé pour avoir ressuscité un mort) ou la résurrection christique. Il reste à refuser d’abord d’être assujetti au monde de l’enfermement et vivre les changements, qui se répètent toujours dans le même ordre, des éléments naturels : le « temps nôtre » est celui de l’orage qui éclate, de la pluie, puis des nuages. Gage de continuité qui satisfait toute attente, « la pluie tombe / n’est plus une espérance / vaine me dit-elle ». C’est cette continuité qui ouvre la voie vers l’Autre, vers la « nouvelle aimée » — « l’Opale » — et vers l’écriture. L’absence de toute réponse suscite la mélancolie, le doute dans ces vers de tenue classique, mais la fin du livre suggère un nouveau départ qui annule toute question :
(…) la nouvelle aimée selon mon rêve inaugure
cette nuit me rejoint laisse glisser sa robe safran
n’est-ce pas là d’une audace inouïe la seule vraie décision ?