Marie Joqueviel. Devenir nuit par Michaël Bishop
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
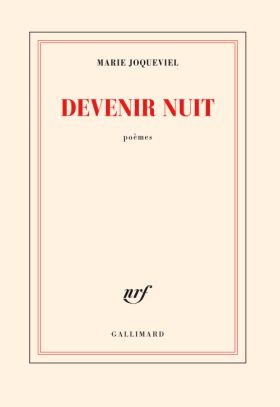
Recueil poétique d’une grande délicatesse et d’une longue nécessité intimement vécue, Devenir nuit est un acte et un lieu de solitude et de subtile et urgente méditation. S’y élabore, au sein d’espaces blancs richement parlants, le fuyant et frêle récit qui persiste à décliner les bribes et continuités des inquiets fuscelli (21), ces ténues brindilles, qui constituent la complexe arborescence de la vie intérieure, d’une présence, d’un être-dans-le-monde où la mort et les rêves semblent en chambouler, et presque impossibiliser, la dimension rationalisable, le sens; le mystère du corps, de l’incarnation, de la matérialité de notre étance s’avérant tout aussi opaque que celui de la conscience, l’expérience de l’esprit qui cherche à en traquer les mouvements, les impulsions, les valeurs.
Quête d’un ‘impossible’ dont ne cessent de parler nos grand.e.s poètes et philosophes et, lit-on, ‘à quoi nous avons voué nos vies / pour ne pas pleurer/ne pas démériter d’être’ (12). Ceci une ‘résistance’, dirait Jean-Luc Nancy, une ‘réponse’, ajouterait Jean-Paul Michel, à et ‘devant’ ce défi ontologique, l’extraordinaire ‘nuit’ de notre présence, tantôt aveuglante, tantôt offrant quelques précieuses lueurs, au cœur des grands ‘vents’ de ce qui est et que sans cesse le poème ‘convoque’ (10-12). ‘Devenir nuit’ permet de plonger dans la face secrète de notre étance, en vivre, savourer, les profondes altérités que susurre une langue silencieuse, autre, un sans-signifiés que remplace un pressenti, un vécu étrangement homologue mais distinct, ses surgissants ‘visages’ psychiquement étreignables, caressables (23). Le sommeil, les rêves qui s’y déplient, donnent l’expérience non d’un savoir, mais plutôt de l’infinie spaciosité d’une vie allant de l’enfance jusqu’à la mort, expérience quelque part harmonisée, champ ontique où entendre un ‘chant qui ne se sait pas’ (31), une parole ne sachant pas ce qu’elle fonde et constitue.
Au cœur de l’auto-auscultation qu’opèrent toutes les petites suites de Devenir nuit, Le corps des disparus avec, en miroir, Le corps des vivants, reste celle qui pénètre peut-être le plus profondément dans cette expérience si tensionnelle, si finement jumelée de l’absence et de la présence, de la ‘déchirure’ (39) et de la ‘réparation’ (41), de la nuit et de la ‘lumière’ (80, 83), de la ‘rumeur’ à peine dicible et du ‘désir’ (59-60). Deux ‘récitatifs’, lit-on (27, 51), complémentaires, fatalement inachevables, allant-dans-le-sens d’un sens, qui se dérobe, refuse de se réduire à l’inscription des termes d’un ‘vouloir-dire min[ant] la rumeur’ (60), se retrouvant ainsi incessamment devant l’énigme – qui est pourtant simultanément splendeur, beauté, ‘gloire’ et ‘joie’ même (40-39) – de ce que Marie Joqueviel nomme parfois, simplement, comme dans la Chandogya Upanishad, cela (41, 79). Le poème, cette trace tâtonnante, incertaine, d’un ‘infini invisible [que dépose la voix intérieure] au creux des paumes’ (82), puise sa force dans le sentiment d’‘un corps antérieur à tes mots’, spectral, ‘non-négociable’ car rêve, pur désir de convergence, d’étreinte de ‘l’impossible’ à la fois à ‘admettre’ et à ‘ne pas trahir’ (61). Répons, car une petite musique, offrande pour offrande, fragile car acte et site d’un ‘peut-être’ (60), d’une étance sentie mais intouchable, le toujours essentiel geste poétique devient ce non-lieu curieux, paradoxal, jamais rationalisable, jamais situable, d’un ‘très-vivant en toi / qui ne t’appartient pas’ (62). Ce qu’il accomplit manque de nom sûr, plongé dans un ‘silence’ qui l’enveloppe ou ‘des phrases que nous ne savions pas – étrangères’ (67), frôlant le sauvage comme la plénitude au cœur même de ce qui – ce serait l’aliénation même – peut sembler définitivement ‘déchirer’, ‘découdre’, ‘désespérer’ (87); mais non, car, confirme, contre-déclarant, Marie Joqueviel, et faisant écho à de grandes voix, Yves Bonnefoy, Jean-Paul Michel, d’autres encore, ‘consentir à se perdre en soi […] / consentir tout court’ (63) coïnciderait avec ce besoin de ‘répondre au désastre’, comme nous disent les derniers mots du recueil, ‘à hauteur d’étoiles / en faisant de la déchirure un lieu où vivre // – et de notre désarroi le commencement de la tendresse’ (88). Celle-ci, cette tendresse, le monde et chacun.e de ses habitant.e.s en ont grandement besoin. Si ces poèmes, ‘jou[ant] de la contrebasse’ (88), graves et hypocoristiques, n’offrent que leurs délicats fuscelli, reste que, visant haut et vrai, ils refusent tout deuil, toute faiblesse, tout acquiescement.