Gérard Vincent, L’incandescence par Michaël Bishop
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
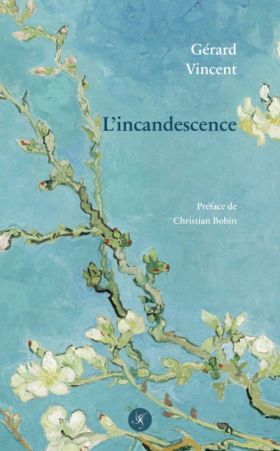
Histoire vraie d’un accès de folie, de colère et de violente impatience surgie d’un absolutisme éthico-spirituel, celle de Gérard Vincent finira par trouver un équilibre et une délicate sérénité intérieure grâce à la fois aux soins de ceux et celles qui l’aiment et une aptitude enfin apprise à s'assumer qu’encourage tout un programme de lectures poétiques et philosophiques. Christian Bobin, qui a eu la générosité d’offrir une préface à cette chronique qu’entreprendra Vincent ‘après huit mois de mort vivante’, juge celui-ci comme ‘all[ant] sur cette terre avec une âme d’hirondelle, parfois tutoyant le bleu du ciel et parfois filant au ras de l’herbe noire, toujours allant, toujours volant, toujours cherchant’ (9). Quelque chose d’‘intouchable’, de ‘pur’ et même de ‘joy[eux]’ se révélerait, déclare Bobin, au cœur de L’incandescence, au cœur de ce qui a été vu et vécu, perdu et cherché, médité, écrit, au cœur de la totalité d’une expérience du désastre, de la terreur, de la panique où l’œil de celui qui souffre – Esaïe est cité en épigraphe par Vincent au tout début de son récit : ‘la terreur seule vous donnera l’intelligence’ (13) – persistera à se braquer sur la partie psychique la plus haute, la plus auto-affirmative de ce qu’il est face à tout ce qui est.
On est toujours tenté d’examiner les éléments formels, structuraux des textes d’un écrivain et surtout d’un écrivain qui puise profondément et souvent dans le travail des poètes. Mais ce qui intéresse Gérard Vincent, les lisant, c’est manifestement leur énergie, les vicissitudes de leur vécu, la façon de négocier, éthiquement, spirituellement, les diverses et intenses expériences, défis ou exaltations, impossibles ou persistances, de ce vécu. Le choix d’une prose fragmentée car élaborée au fil des jours, orchestrée selon les urgences du moment, caressée par des citations, poèmes ou proses de tout un éventail de penseurs et poètes – Hölderlin, Rimbaud, Derrida, Nerval, Artaud, Baudelaire, Breton, Bonnefoy, Kafka, Breton, Hopkins, Noël, Rilke, Pascal, Bataille, etc. – et je n’oublierai pas les poèmes de Vincent lui-même – une analyse de tous ces facteurs, tout en restant inséparable du sens même de la ‘chronique’ qui suivra les deux courtes narrations, Épreuve du feu, I et II, qui contextualisent celle-ci, risquerait de nous éloigner de l’intime, unique et immédiate auto-auscultation que L’incandescence constitue.
L’incandescence est une notion double, paradoxale, poussant vers des horizons lointains l’un de l’autre et difficilement conciliables, délicatement mais enfin, pour Vincent, accordables. Car feu il y a, incessamment. Celui, ici, tout d’abord, d’un désir de sainteté, un feu brûlant de ferveur, incompatible avec tout raisonnement, tout échange d’ergoteur, un extrémisme, même si illuminé, idéalisant, croyant pouvoir régner sur toute réserve ou tout cynisme, toute injustice polémique perçue en tant que telle. Face à ce qui frustre, non conforme à cette intensité visionnaire, une explosion, et l’épreuve d’une détresse, d’une souffrance, d’un désarroi psychique qui met en question tout ce qui est, tout ce que Vincent se croyait être. ‘La folie, écrit Michaux, que cite Vincent, est un département de la foi’ (47). Mais en même temps, et Vincent le comprend lentement, le ‘chaos’ que sème ce feu, s’avérera ‘initiatique’ (33), dans son cas au moins. Un feu et une folie qui vont purifier, pousser à tout réévaluer, mesurer, voir selon une nouvelle optique, transformatrice. Un feu, ainsi, qui exigera que l’on reconnaisse la haute pertinence de tout ce que l’on est, traverse, éprouve (177-8). Qui poussera à chercher ce que Vincent nomme ‘ton centre : le foyer de la lumière, des paradoxes et de la réversibilité’. Et il ajoutera, des années après, vers la fin de sa chronique : ‘foyer : lieu de la Présence, des consumations, de accueils, des acquiescements, de la compassion’ (180). Et je note ici que Gérard Vincent n’insiste nullement sur l’esthétique de l’acte d’écrire, les petites vertus de la forme, et que cela correspond à son sentiment que ‘« se faire entier Parole » c’est courir le risque de [l’]excarnation’ (55), ce qu’il souligne ailleurs en voyant l’orgueil de celui qui ‘s’enferme dans des mots’ comme un amour de la mort même (171), une espèce de dépossession de soi, abstractive, théorisante, là où il faudrait au contraire se rendre disponible à tout ce qui est, est ‘corps vivant’ (55).
Acquiescer, nous l’avons déjà vu, voici le premier pas vers la face secrète de l’incandescence. Consentir, dirait Yves Bonnefoy; aimer sans présomption, aller de l’avant, errer tout en ‘travaillant {inlassablement] dans le sens d’un avènement’ (84), assumer cette ‘redoutable [liberté]’qui s’offre, le moi ‘mû par l’inatteignable’ (180), toujours paradoxalement. ‘Le chemin est la vie’, dit Vincent ailleurs, devient le site mouvant d’une multiplicité-com-plex-ité à vivre, nous orientant selon nos capacités à ‘redonner un sens nouveau au travail d’incarnation’ (60). La vie un travail de gratitude, de redécouverte du ‘cœur, ce grand inconnu de notre temps’ (130). Un travail de conciliation du ‘fond’ et du ‘sommet’ (149), de ‘célébration, par-delà l’épreuve et le doute, [de] cette incandescente ouverture de l’ici’ (117).
Loin d’un encouragement à reprendre le chemin de ce ‘religieux’ qui, avec ses dogmes, ses certitudes, ses rites et fixités doctrinaires, l’aurait plongé dans la crise existentielle, spirituelle que Vincent vit et examine, L’incandescence finit par devenir l’acte et le lieu d’une ‘v[ision] au-deçà et au-delà de [sa] propre dissociation’ (174), un témoignage vécu de ce que Gérard Vincent considère comme étant cette ‘profondeur invisible du visible’ (171) qui baigne toute vie et qui invite tous les jours à la méditer généreusement tout en la vivant avec un sentiment de sa valeur, de son orientation. En cherchant à ‘comprendre que la vie est séjour et que ce séjour a un sens’ (98).
Un beau livre, authentique, riche dans la méditation de nos possibles, peut-être de nos devoirs, de nos responsabilités envers nous-mêmes.