Jacques Lèbre, Sonnets de la tristesse par Bertrand Degott
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
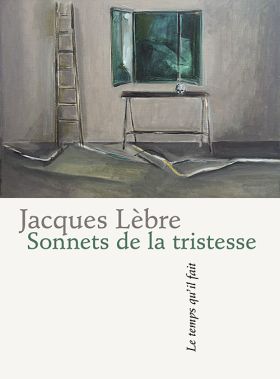
Après une dizaine d’ouvrages publiés notamment par l’Atelier la Feugraie, La Dogana ou L’Escampette, c’est ici la première publication de Jacques Lèbre aux éditions du Temps qu’il fait. Il sera question essentiellement des Sonnets de la tristesse, les deux autres parties du recueil ayant déjà paru respectivement en 2013 et en 1998.
« Faire rimer vieillesse avec tristesse » ?
En 41 tableaux qu’il nomme sonnets, l’auteur condense huit années de visites faites à sa mère hébergée en maison de retraite. D’abord, elle l’attend : « le portable sonnait » (52) ; à la fin, même sa visite l’étonne : elle n’attend plus que la mort. De cette défaite, Lèbre se fait l’âpre analyste (ou le prophète en nous regardant bien) ; quoiqu’il n’en méconnaisse ni l’horreur ni la grandeur, c’est la tristesse qu’il en retient, sans pour autant « rimer vieillesse avec tristesse » (50). Âpre jusqu’à la cruauté, l’analyste brandit de terribles images pour parler de ce monde où « il faut répéter » (48), des vieux comme d’un disque rayé, hors d’usage (39, 44, 45, 55).
Comparer, animaliser, chosifier
On est frappé notamment par la métaphore récurrente du « parc à vieillards » : « Je vais bientôt retourner dans le parc à vieillards. / Je n’aurai pas la joie de l’enfant qui va au zoo » (31). Mais comment le sujet lyrique peut-il répondre à ce qu’il éprouve intimement comme une privation de joie et de beauté ? Tout en s’exclamant « Quelle tristesse ! », il assimile les résidents de l’EHPAD à « des vaches dans un pré » (27). De même les regroupements de fauteuils qu’il doit traverser dans la maison de retraite lui inspirent-ils l’image d’« un troupeau de vaches / lors d’une randonnée au beau milieu de l’été » (36). Pourtant, l’animalisation requiert que le comparé ait un corps si ce n’est une conscience, et le poète constate à quel point l’un et l’autre avec le grand âge sont fragiles. C’est pourquoi toujours la même situation le conduit à se comparer sans souci du cliché à « un éléphant dans un magasin de porcelaine » (38). De même lui évoque-t-elle une marche en terrain miné, qui chosifie les vieillards de manière plus originale :
Vous vous demandez si vous ne passez pas
au milieu d’un champ de mines prêtes
à exploser au moindre contact si vous sortez
du chemin qui passe entre les fauteuils. (32)
Ces vers achèvent un poème où, après avoir comparé leur corps vieilli à du bois mort, qui « peut casser / au moindre gel, au moindre coup de vent », il se demande s’il n’en va pas autant de leur âme — surtout, dit-il ensuite, lorsqu’elle « tombe peu à peu en déshérence » (33).
Répondre à la violence, chercher la joie
Ce recueil ne se contente donc pas de simplement décrire. Il répond aussi — et peut-être d’abord — à un projet spirituel et moral. À ce titre, l’on sait gré à Lèbre de n’en pas verrouiller l’interprétation par une préface mais de laisser à ses lecteurs et lectrices le soin d’identifier les jours qui laissent filtrer ses intentions :
Je ne sais pas s’il y a une part de vérité dans ce que j’écris,
mais si j’écris, sans doute est-ce pour répondre à un choc,
faire ressentir, peut-être, ce qui ressemble à une violence. (40)
On se demande alors, pris du même souci de vérité, à quoi correspondent ce choc et cette violence ? Faut-il y voir l’indignation d’un fils face à l’« abandon » où est sa mère, mais dont lui-même se sait en partie responsable (29) ? Ou bien seraient-ils dus au mouvement de recul d’un sujet confronté à l’imminence de la mort, comme paraît le suggérer l’allégorie suivante ?
On reste encore sur le bord, on plongera plus tard,
car l’on dirait bien des poissons dans un étang,
certains, bouche ouverte pour aspirer encore un peu d’air
avant l’asphyxie finale qui a chaque instant les guette. (28)
Or l’asphyxie serait l’absence de parole et, par deux fois, Lèbre nous laisse entendre sa mère évoquer sa jeunesse. La première fois, s’interrogeant sur le discours rapporté « J’allais à Marcillac à pied dans la neige, en plein hiver ! », son commentaire hésite entre le désir de « retarder la sûre échéance » et le refus du « chemin qui mène vers la béance inconnue » (39), en somme explique les réminiscences de sa mère par un mouvement de recul pareil au sien. La seconde fois, alors que le discours transposé lui semble répéter les « sempiternelles mêmes choses », il se dit qu’en effet « le disque est rayé » (44). Pourquoi ce récit ne lui inspire-t-il en somme que des jugements péjoratifs et des interrogations convenues ? Qu’est-ce qui l’empêche d’y rechercher quand même la joie et la beauté dont il s’estime privé ?
Écrire pour aimer
On se prend alors à rêver l’existence d’un lien entre, d’une part, le principe de répétition qui sous-tend le drame vécu par le fils et par sa mère, et le choix que fait le poète, d’autre part, de donner à quarante et un de ses poèmes en vers libres l’apparence de sonnets. « Jamais, jamais nous n’aurons eu de conversation », écrit-il, incapable de demander à sa mère si elle pense à la mort (59). À force de rabâcher ou de subir les mêmes rengaines — « les journées sont longues » (45, 48, 49, 54), « on est quel jour aujourd’hui ? » (55) —, n’importe qui finirait par oublier que la parole donne aux âmes les moyens d’échanger sur l’essentiel. Rappelons-nous aussi que le sonnet (en cela réside entre autre sa vocation lyrique) est souvent un poème adressé. Or, dans le domaine qu’arpente Lèbre, l’âme peut n’être plus qu’« en déshérence ». Et, de la même manière que le fils n’adresse pas à sa mère la question qui le brûle, dans aucun de ces pseudo-sonnets le sujet lyrique n’apostrophe celle qui « est cette vieille personne / plus que votre mère » (46). Cela ressort d’autant mieux par contraste avec les deux autres parties du recueil, où il tutoie — ici l’ami poète qui a perdu la mémoire — et là une petite fille qui parle aux moineaux.
On comprend alors que le fils écrive au sujet de cette mère qui n’en finit plus de vieillir : « Il faudrait renverser / les choses et faire d’elle l’équivalent d’un enfant » (46). Et l’on se demande par conséquent si la tristesse de ces sonnets ne prend pas sa source dans la difficulté, ou même dans l’impossibilité, d’aimer : « Famille ratée, tout de même », confie Lèbre (59). Si ses sonnets accusent eux aussi gravement le manque, c’est afin de mieux témoigner — comme on y voit se réfléchir les chiffres 14 et 41 — qu’un grand effort d’humanité fut fait pour traverser le miroir.