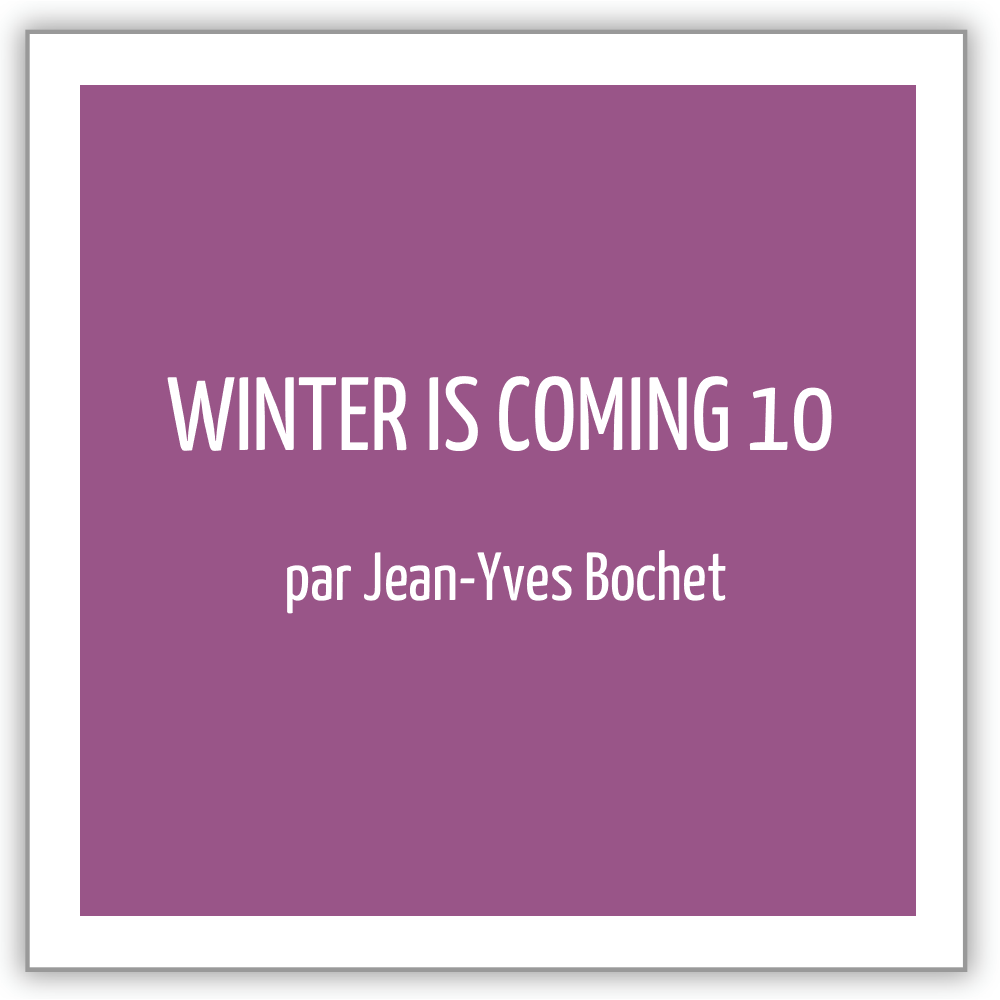WINTER IS COMING 10 par Jean-Yves Bochet
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
REPLAY EN NOIR
Après avoir tenté, depuis quelques années, d’adapter avec plus ou moins de succès les œuvres majeures de la fantasy que sont « Le Trône de fer », « Le Seigneur des anneaux » ou encore « La Roue du temps » ou de leur inventer des « prequels », les chaines et autres plateformes américaines s’intéressent aujourd’hui au roman noir. Trois séries sont apparues sur nos écrans en 2024, tentative pour deux d’entre elles d’illustrer, de réécrire et même d’élargir les univers des deux fondateurs du genre et dernière adaptation en date, pour la troisième, d’un chef d’œuvre noir.
« Monsieur Spade » (en français « Mister Spade » (sic)) est une mini-série, écrite, produite et réalisée par Scott Frank (créateur de « Le Jeu de la dame ») et Tom Fontana (auteur entre autres séries de « Oz »), que l’on peut voir sur Canal +. En six épisodes, « Monsieur Spade » suit les aventures de Sam Spade (Clive Owen), le héros du « Faucon Maltais » de Dashiell Hammett, qui, de nombreuses années après avoir fermé son agence de détective privé à San-Francisco, emmène Teresa, la fille de Brigid O’Shaughnessy, dont les lecteurs d’Hammett se souviendront, dans un petit village du Sud de la France, rencontrer sa grand-mère. Là, Spade trouve l’amour et s’installe, pré retraité heureux. Huit ans plus tard, en 1963, devenu veuf, il profite tranquillement de la quiétude de Bozouls, quand six religieuses du couvent voisin où étudie Teresa sont assassinées. Sam Spade , le détective reprend alors du service.
L’action se situant dans l’Aveyron, quelques comédiens français comme Chiara Mastroianni, Denis Menochet, Jonathan Zaccai , et Louise Bourgoin notamment, accompagnent Clive Owen dans cette aventure. Mêlant roman noir (après tout le héros, même vieillissant s’appelle Sam Spade), roman policier à énigme (Spade jouant un peu les Hercule Poirot dans la campagne française) et espionnage politique (l’époque n’est pas si éloignée de l’Occupation et toute proche de celle de la Guerre d’Algérie), avec parfois des accents ésotériques, la série est complexe et embrouillée et constitue un bel hommage épilogue à l'œuvre de Hammett.
En Avril, Colin Farrell s’est coulé, pour Apple TV+, durant 8 épisodes, dans le rôle de John Sugar, un détective privé à Los Angeles. « Sugar » est une série écrite par le scénariste Mark Protosevich et mise en scène, pour la plupart des épisodes, par Fernando Meirelles, le réalisateur de « La Cité de Dieu ». Au premier abord, « Sugar » est un hommage élégant mais un peu appuyé au roman noir,à Raymond Chandler et son personnage archétypal du détective privé : Philip Marlowe, ainsi qu’à Ross MacDonald et sa remarquable série de romans noirs dans laquelle le détective Lew Archer enquête chez les millionnaires de la Californie des années 50 (que les éditions Gallmeister ont eu l’excellente idée de rééditer depuis quelques années dans de bonnes traductions enfin complètes).
Tout y est : Los Angeles, le détective solitaire, la voix off, les références permanentes au film noir avec des extraits des grandes œuvres du genre que Sugar, cinéphile, adore, l’histoire incompréhensible (comme tous les romans de Chandler que le roman policier n’intéressait pas), les femmes fatales alcooliques qui cachent une grande détresse, les palmiers, le jazz cool, les morts violentes, le cynisme des riches, des criminels abrutis ou très tordus sans oublier la décapotable de collection.
Entre des réminiscences de « La Nuit du chasseur » ou de « Sunset Boulevard » dont le spectateur s’amuse à reconnaître de courts extraits au détour des errances automobiles de Sugar dans un Los Angeles solaire et la recherche obstinée et méthodique de la fille d’un producteur de cinéma, mystérieusement disparue, la série se démarque petit à petit des canons du roman noir car Sugar n’est pas le classique détective privé individualiste, cynique et bagarreur, c‘est au contraire un être bienveillant et contemplatif, qui déteste la violence
La lenteur du récit et la voix off au ton parfois étrange de Sugar, finissent par installer un léger malaise et donner du réel une image un peu floue que le twist du dernier épisode justifiera d’une manière surprenante. Colin Farrell que l’on avait retrouvé au mieux de sa forme dans « Banshees of Inisherin » interprète ici un personnage aussi archétypal qu’énigmatique, tandis que la série mélange les genres avec beaucoup d’élégance.
Au même moment, sur Netflix, débutait « Ripley », une mini-série de 8 épisodes, écrite et réalisée par Steven Zaillian, scénariste de Spielberg ( « La Liste de Schindler »), de Brian de Palma et Martin Scorsese et metteur en scène de quelques films dont : « Les Fous du roi », d’après le chef d’œuvre de Robert Penn Warren.
« Ripley » est la troisième adaptation d’un des romans les plus célèbres de Patricia Highsmith : « Monsieur Ripley » (The Talented Mr Ripley) publié en 1955. Il y eut d’abord « Plein soleil » de René Clément avec Alain Delon, Maurice Ronet et Marie Laforêt, sorti en 1960, puis, en 1999, « Le Talentueux Mr Ripley » d’Anthony Minghella avec Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow et Cate Blanchett.
L’histoire est connue. Tom Ripley, escroc sans envergure vivote à New York de petits trafics, à la fin des années 50, quand il est approché par Herbert Greenleaf, riche entrepreneur, qui croit reconnaître en lui un ancien condisciple de son fils Dickie, en fac. Profitant de l’occasion, Ripley se laisse facilement convaincre d’aller en Italie, tous frais payés, retrouver le fils prodigue qui s’y est exilé, et tenter de le ramener à la maison. Mais là-bas, sur la côte amalfitaine, Dickie vit tranquillement, avec son amie Marge, se prenant pour un artiste et n’ayant aucunement l’intention de revenir à la maison. Ripley, fasciné par la vie facile que mène ce jeune américain, arrive à se rendre indispensable auprès de Dickie, jusqu’à ce que celui-ci commence à se détacher de lui. Alors Ripley, peu enclin à retourner à New York et ses petites magouilles, décide d’agir.
L’action se situant à la fin des années cinquante, Steven Zaillian, pour accentuer le côté noir du roman de Highsmith, a filmé la série dans un magnifique noir et blanc très contrasté. Et, au contraire des deux films qui montrent une Italie de carte postale, toujours ensoleillée, dans « Ripley », le temps est souvent nuageux, voire pluvieux.
L’adaptation est aussi beaucoup plus fidèle au roman que les deux films précédents. Dans « Plein soleil » de René Clément, Maurice Ronet, qui interprète Dickie est un imbécile, imbu de lui-même, qui traite Marge (Marie Laforêt), comme une ravissante idiote. Ce qu’il n’est ni dans le roman ni dans la série où il croit, avec naïveté, en l’art et s’emploie grâce à l’argent paternel à tenter d’être un artiste. D’autre part, la beauté d’Alain Delon, dans le film de Clément, est trop éclatante et il donne l’impression de n’être motivé, dans son approche de Dickie, que par l’appât du gain alors qu’il est évident dans le roman comme dans la série que Ripley est à la fois séduit par la vie que mène le jeune américain et par Dickie lui-même. Quant au film d’Anthony Minghella, il se contente de balader quelques bons acteurs dans l’Italie de « la dolce vita » sans jamais montrer les tourments qui habitent Tom Ripley, sans cesse tiraillé entre son désir de reconnaissance sociale et de vie facile et la tentation perpétuelle d’une plongée dans un gouffre infernal, que la série, elle, prend le temps d’exposer.
Andrew Scott (le professeur Moriarty dans la série « Sherlock ») est fascinant : il interprète un Ripley psychopathe bien sûr, mais aussi sensible à l’art, drôle, manipulateur, torturé, avec parfois des expressions enfantines, un être complexe, que Francis Lacassin dans une réédition de « Monsieur Ripley », qualifiait fort justement de criminel le plus attirant et le plus ambigu de la littérature policière.
Les presque huit heures de la série permettent à Steven Zaillian d’étirer le temps avec délectation en insistant sur la tranquillité de Ripley, se débattant avec une apparente lenteur des liens qui se resserrent, tout en mettant en scène, en de longs plans picturaux, une Italie expressionniste, pleine de longs escaliers de pierre, d’immenses appartements au charme vieillot, de ruelles sombres encombrées de petites voitures en forme de pot de yaourt, de flic au comportement et à la perspicacité dignes de « Columbo » et de tableaux du Caravage, qui apparaît dans la série, tel un lointain ancêtre criminel, fantôme de Ripley.