Laurent Fourcaut, UN MORCEAU DE CIEL (2) par Bertrand Degott
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
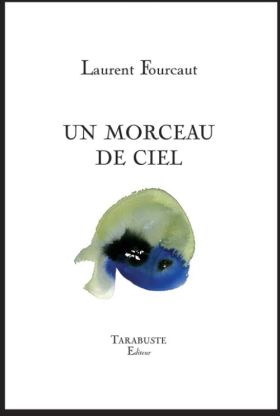
Avec son septième recueil de sonnets (les titres des précédents s’y trouvent parfois rappelés), Laurent Fourcaut persiste à faire la nique à l’essentialisme poétique et au poétiquement correct. Quoi de plus agaçant aussi, pour les détracteurs du compté-rimé — hormis peut-être rondeaux et ballades —, que ces petites machines qui vous obligent deux fois à réunir quatre fois la même rime ! Pourtant, qui accepte d’y grimper se rend compte comme Aragon avait raison d’y voir « une machine à penser ». Mais Fourcaut ne s’arrête pas là. « Tout va bien au Sonnet, renchérit-il avec Baudelaire qu’il cite en exergue, la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique » : la polyphonie et le mélange des tons sont bien dans leur manière à tous les deux. Le seul ordre possible étant par conséquent chronologique, les sonnets se succèdent, comme les pages d’un journal intime, entre juin 2019 et mars 2020.
Partant de cette situation-problème qu’« on a bien du mal à adhérer aux choses / on voudrait que tout fût pareil qu’au cinéma / cohérent, ordonné » (59), le poète risque des solutions : « avec Apo vous décrétez l’automne ma / lade vous complaisant dans votre cinéma / tout vous paraît préférable à ceci se taire (66) ». D’un « cinéma » à l’autre, pourtant, n’est-ce pas chaque fois le désir qui complique les choses ? Ce recueil montre en effet comme il est difficile de déchirer le voile qui nous sépare du monde muet, voile que tissent sans relâche l’égo et toutes ses navettes mentales. Le monde est là, dirait-on cependant, quand le poète observe et note dans « Plante » :
Sur la rose trémière un bouton va s’ouvrir
c’est très lent et joue son jeu avec la lumière
Désireux d’« adhérer aux choses », ne devrait-il pas rester là ? se satisfaire de cet éclat de ciel, trémière à la césure du premier vers appelant lumière au terme du second discordant ? ou bien creuser cette veine ? Mais le sonnettiste, lui, ne l’entend pas ainsi, qui veut sonner et nous dire ce qu’il pense :
… la lumière
qui décide du temps avant que ça mourir
la nature n’est pas une accorte crémière, etc.
Ce faisant, ne sabote-t-il pas — par la syntaxe et par l’allégorie — la sensation première ? Il est vrai que Jaccottet est déjà passé par là, tirant sa propre leçon de la passe-rose, et qu’il n’est pas question de le refaire.
Nombreux sont ici les poèmes qu’on pourrait lire avec les mêmes questions, ceux notamment dont Tristan Hordé dans sa recension écrit qu’ils « commencent par un état de la météo ». Les deux premiers vers énoncent un constat, comme soucieux de préserver l’évidence de l’instant : « La lumière c’est mars est devenue plus claire / encor beaucoup de pluie l’herbe ne pousse pas » (164) ; « Les choses sont posées on dirait transparentes / dans une vide lumière d’après-midi » (165). Alors, se dit-on, pourquoi vouloir y ajouter ? Sans doute est-ce que creuser la veine serait céder à ce que Fourcaut ne cesse d’identifier comme des obstacles : 1°) le lyrisme et « le chant vecteur de l’illusion » (101), et 2°) le « déni du réel » (101, 118, etc.). Il est rare en effet que le chant l’emporte comme à la fin de « Tour de roue » :
Ce soir tout s’alanguit sous le baiser du vent
les roses dodelinent on se sent rêvant
sur le jardin d’interminables crépuscules
où s’étire le temps d’une fine langueur
insensiblement accomplissant la bascule
de nuit d’où le jour sort avec une longueur
d’avance
Pourtant, rejeté après la rime, « d’avance » montre que la phrase est au contraire en retard sur le vers ; l’effet du rejet est donc ironique, comme si le poète nous disait : — Vous vouliez de beaux vers ? en voici ! mais, franchement, je ne vais pas me mettre à écrire comme les symbolistes…
Dans cette conversation familière que permet le sonnet entre vers et prose, Fourcaut cherche la connivence. Ainsi, « Claudel grand poète comique » (73) fait allusion à un lapsus de lecture que le poète cosmique rapporte dans son journal. Et n’est-ce pas un clin d’œil encore que de mettre en regard « Une charogne », parodie baudelairienne dans un sonnet trop long (128), et « À l’étroit », qui parle d’un ficus confiné dans un pot trop petit (129) ? En permanence, le poète semble ainsi nous tirer par la Manche et nous confier : « Je suis tellement intelligent ! » Mais de quelle intelligence parle-t-on ? Se résume-t-elle aux références artistiques égrenées par Hordé ? Et d’ailleurs, faut-il la prendre au sérieux, cette confidence, ou n’y voir qu’une marque d’autodérision ?
Ce recueil, que sous-tend un projet philosophique, politique et moral, donne de l’auteur l’image d’un individu cultivé, dont on croirait qu’il cherche à nous en remontrer s’il ne s’avouait si mesquinement grossophobe (104), maugréant tellement contre les « primates / rivés à leur smartphone » (146), s’indignant à ce point des crottes sur le trottoir (150) qu’on dirait nous. Ce « vous érotomane » (126) qui, écoutant les suites de Bach, fantasme le strip-tease de la violoncelliste (139), le recours au vous de politesse nous invite à nous identifier à lui. « Le grand Pan est mort », écrit Pascal, nous ne pouvons plus que le singer. Et voilà — s’excuse Fourcaut, navré —, c’est ça, l’humanité : ecce homo, voilà l’humain, libre à vous maintenant de le crucifier… Mais libre à vous aussi de reconnaître tout ce qu’à ce titre nous partageons, à commencer par le monde muet qui, dit Ponge, « est notre seule patrie ». Voilà pourquoi les mots pèsent de tout leur poids : en butte à l’éco-anxiété, l’on se terre (98) car la terre est en jeu. Et, comme on ne sait quoi faire d’autre qu’écrire, il ne faut plus se taire. On se retire en poète, on n’a d’autre choix qu’être en même temps solidaire et solitaire, conscience commune et critique à la fois. Il reste à confier au sonnet ce mystère que ce n’est pas en gesticulant, ni en proférant le plus, qu’on sera le plus efficace. En tout état de cause, cette communauté ne se dira bien qu’en sonnets et en « dodéca / syllabes » (53) — formes communes par excellence !
Le sonnet est un temple enfin, pas si éloigné que ça du « morceau de ciel » baudelairien. Dans l’espace qu’il circonscrit du bout de sa lyre ou de son fouet de satirique, le poète comme l’augure se livre à des observations, délivre des prophéties : c’est à peu près le sens de templum en latin. Dans la baie de Saint-Vaast-la-Hougue (Cotentin), que la mer doit inonder pour son centenaire (142), Fourcaut court les marais, suit le vol des hérons, s’émerveille aux « choses ténues » (116), à l’ordinaire, cependant qu’à Paris, lieu hanté par « Micron », il va dans les bistrots, manifeste pour nos retraites et voue aux gémonies « le cancer de l’argent » (127). Il prophétise aussi — on est si nombreux, nous les gens — la catastrophe écologique et la décrète. Plaidoyer en faveur de « la terre mater » (130), son recueil contient aussi un engagement : ce n’est pas au Père-Lachaise que vous reposerez mais dans le cimetière de Brucheville (126). Dans un monde qui « coule » (9, 18, etc.), le vous corseté du poète ne peut rester « étanche » (20). C’est qu’il coule dans ce temple trop de tendresse, endiguée par pudeur… Pour un petit cancéreux, pour les mésanges qu’on nourrit dans le froid, pour les amitiés littéraires. Pour la mère ensevelie durant le confinement, et dont le sonnet final constitue le tombeau. On comprend mieux la profondeur et la beauté du projet de « cohabiter avec la nuit » (102). Et c’est peut-être aussi l’unique prophétie qui vaille.