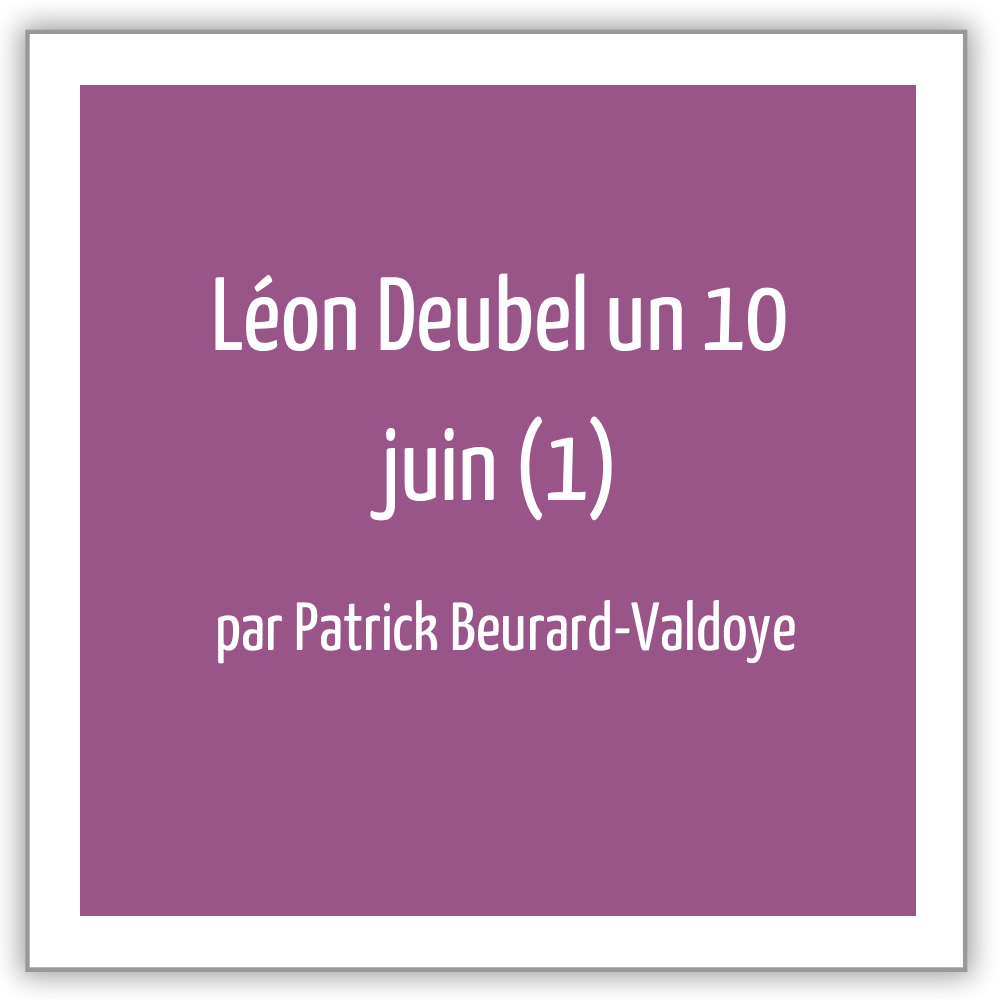Léon Deubel un 10 juin (1) par Patrick Beurard-Valdoye
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Le mort de la poésie et le mort de la philosophie
Les lecteurs de Paris Capitale du XIXème siècle de Walter Benjamin doivent s'étonner de voir – parmi ces exergues d'auteurs de renom (Baudelaire, Nietzsche, Blanqui, Marx et Engels, et même le baron Haussmann) – le nom de Léon Deubel. Un vers de lui introduit le chapitre Louis-Philippe ou l'intérieur : "Je crois ... à mon âme : la Chose". On lit ce vers dans Œuvres de Léon Deubel, ouvrage posthume paru en 1929 au Mercure de France.
C'est qu'à parution de cette anthologie 16 ans après la mort du poète, Walter Benjamin lui rend hommage, et par surcroît en Allemagne.
Si Deubel se contentait de tirages entre 30 et 60 exemplaires, nous dit Benjamin, en voici l'explication : "C'est très simple. Deubel vivait avec ses vers et, il vivait avec eux si intensément, non seulement parce qu'il les tenait pour nécessaires, mais parce qu'eux-mêmes le tenaient pour nécessaire."
Peut-être le vers, intégral cette fois, et le suivant – extraits du poème "J'aime ... Je crois" – illustrent-ils le propos de Benjamin :
Je crois à mon corps : l'Arbre, à mon âme : la Chose,
À mon amour : le Feu, à ma force : le Vent.
Cette recension – disponible sur le site allemand www.textlog.de – mentionne que Léon Deubel "s'est suicidé à l'âge de trente-quatre ans, l'un des derniers à périr de la poésie."
Qui était donc ce Deubel ?
Commençons par la description de son espace de création. Walter Benjamin encore (que je traduis) : "Il s'enferma avec ses activités dans les demeures princières, désormais désertes et étouffantes, de ceux qui l'avaient précédé, notamment de Baudelaire, et les graines de ses images jaillirent en formes de calices, rayonnantes et élancées dans l'herbe. Lui-même ressentait cette imagerie obscène comme le grand danger de sa poésie et, une fois, il écrivit, plutôt maladroitement : "Je ne veux pas être si prodigue en images, ça fatigue le lecteur." Sur ce flanc-là, des plus essentiel, il est apparenté à [Georg] Heym."
C'est donc de la poésie expressionniste que l'on peut rapprocher le poète français. Ce que confirme la plaquette de six poèmes non traduits Ailleurs publiée au début 1912 à Berlin – que Benjamin eut probablement entre les mains – par l'éditeur renommé A. R. Meyer. Lequel dans cette même collection lyrique, fit paraître des poèmes de Franz Wedekind, et les premiers poèmes des expressionnistes, comme Gottfried Benn, Elsa Lasker-Schüller, Paul Zech ou Yvan Goll. Sans compter par la suite, Zone d'Apollinaire.
Voici à présent comment Pierre-Jean Jouve considérait Léon Deubel après son suicide, un 10 juin 1913 : "Il écrivait quand il devait libérer un bonheur dont la vie ne voulait pas. Il écrivait pour se racheter et je peux penser que tous nous sommes aussi purs qu'il le fut. Assis dans une chambre que forçait la rue populeuse, il attendit longtemps ce que le monde juste lui devait en échange de son amour. Ses yeux à mesure se vidèrent de leur foi. Quand il eut complètement compris, il se déroba. [...] Plus de poètes. Je songe à toi, Deubel. Tu as bien compris le problème posé et le dilemme qui le couronne. Coincé entre l'impossibilité de vivre la vie monnayée, et l'inefficacité, l'inutilité même, du plus évident génie – tu acceptas la noble solution." [Revue Les Bandeaux d'or, n°28, été 1913.]
Une détermination sans retour possible, donc. Deubel prétendit vivre en poète, sans autre revenu. Dans les rues de Paris en 1900, on n'a pas droit aux bancs la nuit : une loi l'interdit.
Un pont vu de dessous, ça ressemble – au réveil – à une grande table. Ou bien à un piano droit. Edgar Varèse y dormit aussi, après avoir traité Auguste Rodin, son patron, de "con".
Un répit de quelques mois les rapproche, impulsé par le peintre Émile Bernard, via sa revue la Rénovation esthétique. Léon Deubel en devient le secrétaire, avec salaire ; avec logement dans les locaux de la revue. Un refuge d'une vie de Bohème. "Il n'y a ni art ancien ni art moderne. Il y a l'art, c'est-à-dire la manifestation de l'idéal éternel" affirme l'entête du papier à lettre de la revue. Ça ressemble à du Deubel. Lequel avait déjà codirigé la Revue verlainienne – annoncée en ces termes : "d'art, d'esthétique et de piété verlainienne".
Pleyel de Varèse et poème au palier
Varèse de son côté apporte son canapé, et le "monstre" : un piano. "J'ai fait la connaissance d'un jeune maestro de grand talent qui partage avec moi le local de la rue Furstemberg. Très enthousiaste de mes vers, il les enfarine d'harmonies." [ À Louis Pergaud, sans date, printemps 1905.] Le soir, Varèse, en présence de poètes, de compositeurs, de peintres, d'architectes ou de philosophes, joue Beethoven ou Wagner, puis ses premières compositions – aujourd'hui disparues – parfois sur des poèmes de son hôte : Souvenir, Dédicace ou bien Rhapsodie romane. Ensuite, Deubel portant la lampe sur le palier, du fond de l'ombre donc, profère un de ses sonnets. Parmi les présents, Charles Vildrac, ou bien le lillois Léon Bocquet, lequel témoigne [Léon Deubel, Roi de Chimérie, Grasset, 1930] : "D'une voix grave et singulièrement prenante, le poète psalmodia les quatrains et tercets du sonnet la Musique.
Dans le halo doré des lampes familières
Comme un mort surgirait d'un sépulcre connu,
Pour me solliciter à l'amour du mystère
La Musique m'appelle en tordant ses bras nus."
Un second témoignage confirme les intenses soirées au local de la revue [Roger Allard, la Phalange n°15, 1913] : "Deubel se plaisait à réciter ses vers. Il conduisait avec art une voix naturellement grave et émouvante, et je ne sache point qu'un poète ait été plus parfait héraut de son propre génie. Il exigeait presque toujours que l'on fit l'obscurité dans la pièce, ce pourquoi il avait accoutumé de porter la lampe sur le palier et d'entrefermer la porte. Je ne puis évoquer sans émotion le soir où, dans ces conditions bizarres, il dit la belle prière du Chant des Déroutes :
Seigneur, je suis sans pain, sans rêve et sans demeure,
Les hommes m'ont chassé parce que je suis nu,
Et ces frères en vous ne m'ont pas reconnu
Parce que je suis pâle et parce que je pleure."
Le poème se spatialise autant qu'il s'oralise. Il est mis en voix dans un espace qui – faut-il le souligner – n'et ni salon ni cabaret. Conditions "bizarres" certes, pour l'époque.
Deubel à vingt-six ans.
Les projets s'ébauchent avec son alter ego réfractaire : une association (1901 comme il se doit) "La mansarde" ; des soirées artistiques où seraient données des pièces de Varèse, et dits des poèmes de Deubel. Varèse a trouvé la comtesse mécène, il parle déjà d'un orchestre de cent-vingt musiciens. Ce qu'il réalisera à Berlin puis New York.
Mais les événements de 1905 ruinent le mécène russe de la revue. Elle cesse de paraître sous cette forme, et sans Deubel qui s'est brouillé avec le traditionnaliste Émile Bernard. Locataire toléré encore quelques mois, il est sans revenus. "Après 16 mois de cette vie déprimante [...] me voici tout à fait névrosé et malade, sans force et déjà mort plus qu'à moitié. J'en suis arrivé à prendre de la strychnine et de l'arsenic et des vins toniques" [À Louis Pergaud, 30. 7. 1906.] C'est l'époque de l'impression de son troisième recueil Poésies [Le Beffroi, 1906] dont il ne peut récupérer qu'une trentaine d'exemplaires, puisque l'imprimeur exige le paiement de la revue. Et les trois-quarts de 320 exemplaires de La lumière natale, paru l'année d'avant, ont eux, augmenté le tirage du poêle sans charbon.