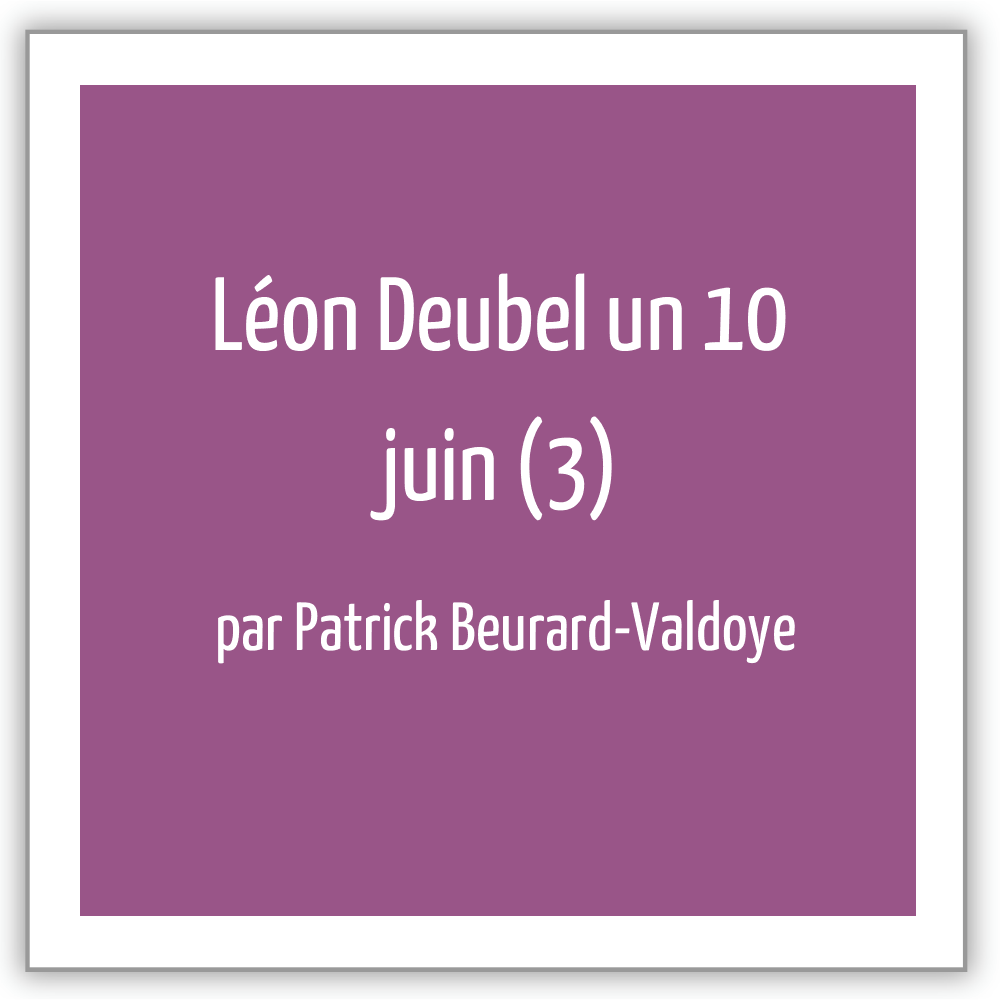Léon Deubel un 10 juin (3) par Patrick Beurard-Valdoye
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Fonction de Littérateur libre
Avec le « sacrifice » de Léon Deubel on vérifiait qu’un poète estimé seulement de quelques pairs ne pouvait espérer bourses ou prix – le jury de la « Bourse nationale de voyage » était visé – quand ces récompenses s’obtenaient – s’obtiennent souvent encore – moins au mérite, qu’à la faveur. On prit la mesure en outre d’une réalité sociale qui réduisait la pratique d’un art à du temps (très) partiel – un hobby dirait-on à présent – à moins d’un privilège financier. Un « Conseil central pour la Défense des littérateurs libres » fut fondé – ou recréé, selon une autre source – dans l’été 1913. Apollinaire en fut membre actif.
Dès l’automne Louis Pergaud fait paraître au Mercure de France un choix significatif préfacé de l’œuvre de son ami : Régner. En 1929, c'est Œuvres évoqué précédemment, préfacé par Georges Duhamel (l’ouvrage fera l’objet d’une nouvelle édition augmentée en 1939). Quelques hommages suivent, tant que les poètes considèrent activement Deubel comme une figure incontournable du début XXème siècle. Citons par exemple le dossier Deubel dans une livraison de Critique 38, dirigée par Max Philippe Delatte – une grande figure de la librairie littéraire indépendante après 1950.
Sa correspondance est réunie en 1930 : Lettres de Léon Deubel (1897-1912), avec introduction et notes de son ami de collège et lycée Eugène Chatot (éditions Le Rouge et le Noir). Seuls deux poètes souscrivent : Jules Supervielle, et Henri-Martin Barzun, figure tutélaire – avec Georges Duhamel et Charles Vildrac – de la communauté littéraire de l’Abbaye (le phalanstère « groupe Fraternel d’Artistes »), qu’a fréquentée Deubel.
Les Berlinois ne sont pas en reste, puisque paraît dès 1913, chez l'éditeur Paul Knorr, un livre intitulé In Memoriam Léon Deubel. Puis en 1914, chez E. W. Tieffenbach, c'est Die Rotdurchrasten Nächte, contenant huit sonnets de Léon Deubel, traduits par l'expressionniste Paul Zech, illustrés de lithographies érotiques de Waldemar Roesler (un peintre de la Sécession berlinoise qui se suicida en 1916).
Après 1945, ses poèmes ne sont toutefois plus guère d’actualité. Encore en 1960 une livraison du Pont de L’épée consacrée au « suicide des poètes » (Varonca, Deubel, Trakl, Ravese). Mais la chaîne de mémoire finit par se rompre. Les quatorze vers du Tombeau du poète n’ont pas suffi à sauver l’œuvre de l’oubli. Hormis les habitants d’une place à Paris, et les résidents d’une rue belfortaine, seuls – ou presque – les bibliophiles en quête de poètes maudits, les « amis de Louis Pergaud », les connaisseurs de Varèse enfin, situaient le nom de Deubel avant 2013. Réjouissons-nous qu’il y ait désormais à Belfort une bibliothèque Léon-Deubel, riche d’un fonds impulsé par son ancienne directrice Agathe Bischoff-Moralès. En outre, Régner a été réédité en début 2023 à l’initiative d’Irène de Palacio.
Signalons quelques commémorations plus intimes. Un quatrain de Léon Deubel est gravé sur la tombe de Michel Dreyfus-Schmidt – vice-président du Sénat, avocat, ardent défenseur des libertés individuelles – décédé à Belfort en 2008. Dans La gloire des petites choses [Grasset, 2022 ; merci à Jean-Marc Baillieu de m’avoir signalé cet hommage], Denis Grozdanovitch raconte comment il demande à de jeunes parisiens dînant sur la place Léon-Deubel, s’ils savent qui est ce Deubel, puis s’empresse de fournir de généreuses explications, reçues avec gratitude : « L’un de nos derniers poètes maudits ».
Or il serait temps d’abandonner cette mythologie du dernier – ou de l’un des derniers – poète maudit, aussi obsolète que la révolution industrielle qui l’a fait naître. Le « progrès », ni l’ère postmoderne n’auront œuvré bien sûr, pour en proscrire la réalité. Ils furent légion au XXème siècle à lancer en vers, ou en prose poétique, des cris d’alertes qui ont laissé l’époque indifférente. Pierre Seghers en présenta treize, puis quinze. [Poètes maudits d’aujourd’hui, Seghers, 1977.]
Et que dire des « maudites », à l’instar de Danielle Collobert, Agnès Rouzier, ou la « petite poyetesse » Mireille Havet. Quant à Hélène Bessette (avec son gang poétique), qui revient de loin, demi-vivante mais auteure, elle n’a heureusement pas suivi dans la Seine son amoureuse de vingt ans : « Croyais-tu que j’allais te suivre ? / La file indienne des Ophélies / allait-elle encombrer l’eau noire / de sa faible lumière / et de ses robes du Soir ? » [Élégie pour une jeune fille en noir, Nous, 2011.]
« À bientôt des poèmes sonores et fiers. »
Deux ans avant l’épisode Varèse, Deubel avait expédié une carte postale de Neuchâtel, se terminant par : « À bientôt des poèmes sonores et fiers. » [À Eugène Chatot, 24.9.1903.] Certainement pour la première fois, l’appellation « poème sonore » est en usage, laquelle va faire florès – soixante ans plus tard – sous la houlette notamment du poète « sonore » Bernard Heidsieck pour qui, justement, Edgard Varèse était un phare. Si l’on doutait encore de l’importance que Deubel accorde à l’oralité du poème, il faudrait lire la « dédicace » dans Poésies :
Ne cherchez pas, chère âme, en écoutant ces vers
Près du feu qui sourit de son sourire clair
Si la Vie a blessé la voix qui les récite
D’ailleurs dans une lettre de l’année suivante, Léon Deubel sollicite auprès de Roger Frêne, pour la revue Argonautes en préparation, « le plus puissant et le plus sonore de [ses] poèmes. »
Nous avons enfin l’émouvant témoignage de Georges Duhamel, rendant visite à Deubel dans sa chambre d’hôtel miteuse, équipée seulement d’un lit, d’une cuvette, d’une chaise, d’une table et, « sur le sol aux carreaux fêlés, un bout de tapis galeux ». Deubel, sans lumière et sans feu, pour qui « la poésie était le seul souci », allumait alors une lampe. « Il se levait et, serrant à deux mains le dossier de sa chaise, bien droit, vraiment très respectable et très noble avec son allure d’officiant ou d’adorateur, il me récitait quelque poème de Verlaine, de Baudelaire ou de Mallarmé. La voix était belle, très grave, et je ne crois pas que l’on puisse dire les vers avec plus de délicatesse et de chaude intelligence. » [Préface de Poèmes 1898-1912, Mercure de France, 1939.]
Envisager les conditions du Dire du mieux le poème était donc davantage qu’une préoccupation de circonstance, au moment où la poésie française – quand elle n’était pas d’essence muette – ne trouvait guère sa voix. Six mois après la disparition de Deubel, les « Archives de la parole » offraient l’opportunité à René Ghil notamment, de graver sur cire son Chant dans l’espace – étrange chant-parlé en tremolo – et à Apollinaire son Pont Mirabeau – diction emphatique d’une voix de tête forcée. Le Flamand Émile Verhaeren – qui aurait été l'un des rares poètes au Panthéon, sans l’opposition de sa famille – s’en tira un peu mieux.
Nationalité : poète. Retour à la recension de Benjamin
Walter Benjamin rédige un paragraphe quasi prophétique, autant du point de vue de ses travaux – la tempête victorieuse ; la grande ville – que du cours de sa propre vie (qui s’achève comme on sait, par son suicide à Portbou en septembre 1940) : « Ses images ondoyantes, flamboyantes et cliquetantes étaient des standards, sous lesquels la poésie se préparait pour une dernière tempête victorieuse sur la grande ville. Deubel n’aimait pas la ville. Ce n’était pour lui qu’une station sur la voie de la souffrance, la cataracte noire, qu’il invoquait dans un beau poème pour faire passer en toute sécurité le cours de sa vie [Lebensschiff]. Sa volonté n’a pas été accomplie. »
Benjamin a certainement à l’esprit son jeune ami de Fribourg-en-Brisgau, qui s'était suicidé un an plus tard, en juillet 1914 : le poète Fritz Heinle.
Parmi d’autres poètes morts de la poésie, Paul Celan et Ghérasim Luca ont aussi rejoint le flux noir des ondes. Coïncidence ophélienne troublante en passant : en 1938-39 Luca, poète né à Bucarest (mais pas Roumain) fréquenta presque quotidiennement, en voisin, son ami Victor Brauner – au 14 Cité Falguière – lequel prit la suite du sculpteur Takata qui, en 1935, avait réalisé la commande du buste de Léon Deubel.
Walter Benjamin – qui lui-même a écrit son soixante-treizième et dernier sonnet quatre ans auparavant – conclut en forme d’allégorie : « Avec vingt ou trente de ses plus beaux vers, Deubel devrait se voir attribuer des droits de propriété dans la meilleure de toutes les républiques allemandes, l'ancien État libre de leurs traductions. »
La première pierre à cet édifice benjaminien fut peut-être la thèse de Günther Mauntz, soutenue à l'Université de Bonn en 1932, sur l'œuvre et la vie de Léon Deubel.