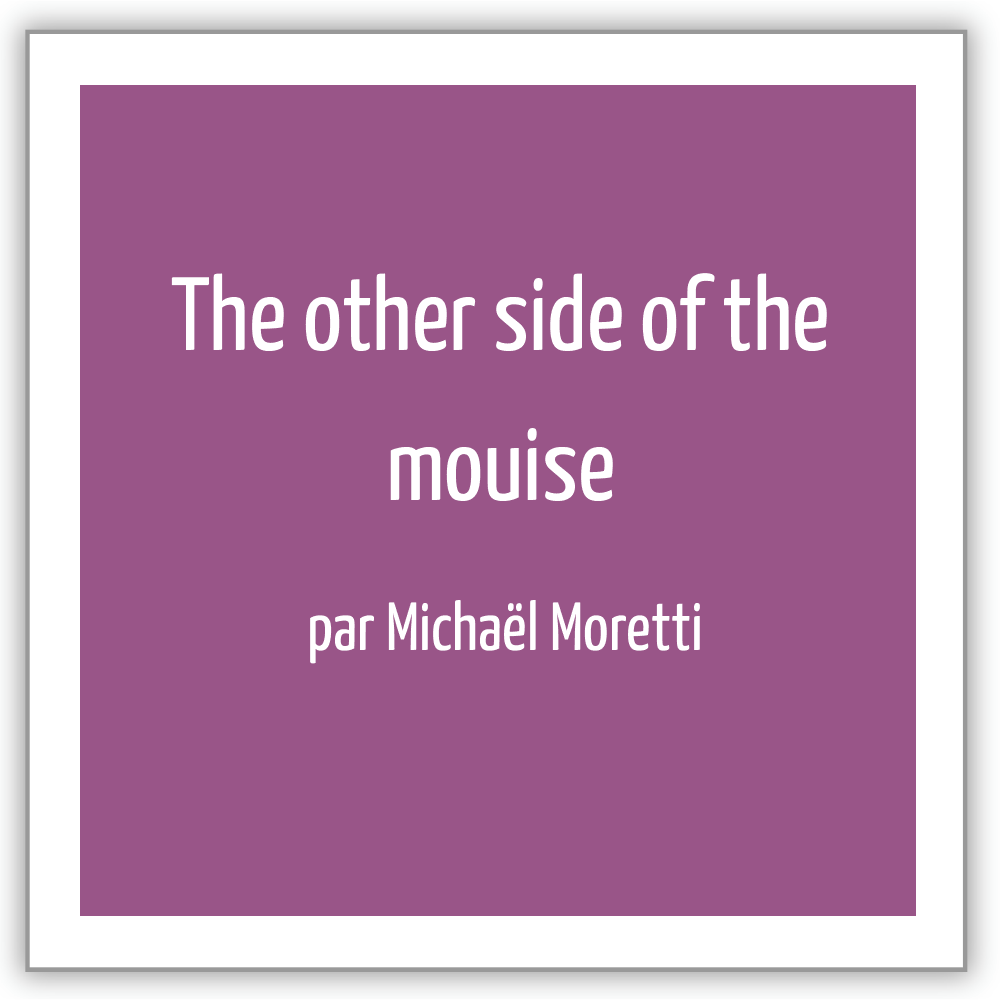The other side of the mouise par Michaël Moretti
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Rocambolesque
Vérités et mensonges (F for Fake, 1973) augurait fort mal de la suite. Oja Kodar, sculptrice d’origine croate, la compagne d’Orson, jouait déjà, montrée sous toutes les coutures. La suite, c’est un projet écrit en 1950, tourné entre 1970 et 1976 puis bloqué par un financier, beau-frère du Shah d’Iran, puis par un conflit entre Kodar et la fille cadette du metteur en scène, Béatrice, Jeanne Moreau aussi, paraît-il. Résultat : 1 000 bobines de rushs, soit des centaines d'heures, restaient conservées dans un dépôt de Bagnolet sans être exploitées ; Welles, échaudé, avait heureusement sauvé 42 mn qu’il a ramené aux Etats-Unis. Stone et Lucas s’y sont ensuite cassé les dents. En 2015, trois producteurs - louons leur travail -, Frank Marshall, qui a produit Spielberg, Jens Koethner Kaul, Filip Jan Rymsza, directeur de Royal Road Entertainment et réalisateur de deux films (Dustclouds, 2007, Sandcastles, 2004) - ce dernier était présent à la présentation, d’ailleurs indigente, où Frémaux déclare l’avoir pris au début pour un charlatan-, firent appel au monteur Bob Murawski pour le montage titanesque (2 ans) vu la variété du matériel (super 8, image tv, 16mm, 35mm, images d’archives, etc.). Frémaux, qui, d’un revers de main, ne reconnaissait pas officiellement la faible représentation des réalisatrices au Festival de Cannes en 2017 avant de récupérer le mouvement #metoo suite au scandale Weinstein, bien que la défense de la projection sur écrans de cinéma soit légitime et nécessaire, a loupé le coche à Cannes 2018, malgré les suppliques de la fille cadette de Welles. Netflix a finalement présenté The other side of the wind à la Mostra de Venise, festival créé sous et par Mussolini, rappelons-le, qui a damé le pion à tous les niveaux cette année au festival français (Lion d’or à Roma de Cuaròn qui ne devrait malheureusement pas sortir sur les écrans alors qu’il a été tourné en 65 mm pour le cinéma).
Daube de taureau
La séance du Festival Lumière 2018 commence mal malgré la présence dans la salle, soulignée par Frémaux, de Claire Denis et de Schatzberg, pote de Tavernier présent chaque année – même Chardère, le fondateur de l’Institut Lumière et de Positif est là, nombre de spectateurs sont sur les marches : Peter Bogdanovich, acteur principal du film, ami d’Orson Welles qu’il a interviewé (Moi, Orson Welles : entretiens avec Peter Bogdanovich, 1993, This is Orson, 1992, 1998), obligé moralement de terminer le film à cause d’une promesse, n’est pas présent (j’apprends ensuite qu’il sera absent pour sa master class car il vient de rentrer à l’hôpital : il a chu) ; le film lancé en 35mm est … This Other Eden (1959) de Muriel Box où le point commun serait vaguement l’Irlande ; Frémaux, cabotine en disant que c’est une blague ; enfin il remercie Netflix, ce qui ne manque pas de piquant.
Le film commence par un accident, image statique qui ne laissera pas de souvenir comme dans Les choses de la vie (Claude Sautet, 1970 d’après un roman éponyme de Paul Guimard) mais les moyens diffèrent, il est vrai. A retenir le principe du flash-back global comme dans Citizen Kane (1941). Nous voyons dans The other side of the wind, une Oja Kodar souvent nue, comme si le voyeur et exhibi (« Je prépare un film cochon » avait-il déclaré à Bogda), l’obèse ourson et vieux Orson, était content de présenter sa jeune et jolie conquête (Pocahontas), néanmoins co-scénariste, en pâture au spectateur dans des scènes opportunément hippies et beat-nique, avec scène de baise dans la bagnole sous un orage violent où elle chevauche le John/Bob, sur une musique originale psyché rendant la bande-son jazz 2018 de Michel Legrand (« Le sujet du film me touche : l'idée du passage du temps, le renouvellement de l'inspiration» ; il est question dans le film de jazz et de nains), qui travailla sur l’indigent Vérités et mensonges (F for Fake, 1973), omniprésente et obsolète. Le voyeur spectateur se rince l’œil - pourquoi pas. « Plusieurs voix raconteront l’histoire, expliquait le réalisateur dans son livre de mémoires écrit avec Peter Bogdanovich qui lui insuffla l’idée du film. On entendra des conversations enregistrées, sous forme d’interviews, on verra des scènes très diverses qui se déroulent simultanément. Il y aura des gens qui écrivent un livre sur lui. Des documentaires. Des photos, des films. Plein de témoignages. Le film sera un assemblage de tout ce matériau brut. ». Malheureusement, nous sommes loin d’un Joyce, Dos Passos ou A. Schmidt au cinéma : la simultanéité n’est que successions, aucun split screen (L'affaire Thomas Crown, The Thomas Crown Affair, Norman Jewison et L'étrangleur de Boston,The Boston Strangler, Richard Fleischer, 1968 par exemple), alors que cette pratique existe depuis le muet, ou autre ; bref, aucune recherche formelle originale.
Dans une longue fête goyesque à la Arkadin (Dossier secret, Mr. Arkadin, 1955) Welles propose un montage effréné (y a-t-il au total plus de plans que dans Othello,The Tragedy of Othello : The Moor of Venice, 1951 ?) , voire fatigant, où alternent les scènes en noir et blanc et en couleur – ce qui ne gêne pas pour les films muets mais qui sont ici plus que contrariants, où se succèdent une multitude de personnages (Peter Bogdanovich, Mercedes McCambridge, Edmond O'Brien, Lilli Palmer, Dennis Hopper, qui n’a pas besoin de forcer pour avoir les yeux exorbités par la came, la Strasberg, Claude Chabrol, symbole d’une nouvelle vague ici mal comprise, qui fait une saillie drôle, Stéphane Audran, Norman Foster, Gary Graver, Curtis Harrington, Paul Mazursky, etc.) qui s'invectivent, se questionnent, s'agressent à coup d'aphorismes souvent hilarants (« On a dit de lui qu'il était le Murnau américain ! Mais j'ai oublié qui était Murnau»). L’humour est aussi léger que dans Falstaff (Campanadas a medianoche, 1965), d’ailleurs il est encore question de Shakespeare mais comme un cheveu sur la soupe, sur fond de flamenco car Orson est amateur de tauromachie en Espagne – le personnage principal, joué fort peu légèrement par John Huston incarnant un porc velu aux propos antisémites et homophobes, lorgnant sur une petite fille et terrorisant son entourage, n’est-il pas présenté ici comme le Hemingway du ciné ? C’est qu’Orson se venge d’Hollywood avec ses réalisateurs, leurs petites cours, les producteurs à l’ancienne, le fixeur, les critiques, pour nous servir du taureau … en daube ! La charge est plombée. La machine bavarde tourne à vide, la scène d’anniversaire en ciné-vérité, sous alcool ou drogue, est interminable. Dans une lourde mise en abyme, des séquences du film en question, entre série B à la Corman (bikers et femmes dénudées) et Zabriskie Point (Antonioni, 1970, dont les parodies sont décidément nulles, si nous tenons compte de Twentynine Palms, 2003, de Bruno Dumont ; ici, des perles qui tombent ridiculement sur le corps nu d’Oja Kodar que nous aurons décidément vu sous tous les angles) et sont projetées par intermittence entre des coupures de courant, dans un drive-in, avec des nains qui lancent des feux d’artifices mais malheureusement nous sommes loin de la Dolce vita (1960) ou 8 ½ (1963) de Fellini. La charge est vulgaire (dans le sens où Le loup de Wall Street, The Wolf of Wall Street, M. Scorsese, 2013 à force de dénoncer cette vulgarité permanente finissait par le devenir lui-même) : en voulant être dans le mouvement de l’époque, il rate sa confrontation avec Antonioni, Fellini et Godard des années 70, où Welles serait plutôt ici à bout de souffle malgré une forte énergie inutile, mais aussi avec le nouvel Hollywood (Hopper, De Palma, le critique McBride, jouant son propre rôle ici, déclarant hors champ « Si l'on veut savoir à quoi ressemblait l'ambiance à Hollywood pendant l'ère ‘Easy Rider’, quand la nouvelle génération a bousculé les vieux réalisateurs, il suffit de visionner ‘The Other side of the Wind’. », Monty Hellman, etc.) que représente le « magnétophone vivant » Peter Bogdanovich, excellent réalisateur quoique parfois trop référencé (les excellents La dernière séance, The last picture show, 1971, La barbe à papa, Paper moon , 1973, sentent Les raisins de la colère, The grape of wrath, J. Ford, 1940. Bogda était perçu comme un pasticheur, comme Tarantino aujourd’hui). Deux scènes à sauver : une poursuite, esthétisante, laissant songer à la fin de La dame de Shanghai (The lady from Shanghai, 1947) ; la fin du film dans le drive-in où l’image sur l’écran s’efface progressivement. L’allusion à la bombe laisse penser au début de La soif du mal (Touch of evil, 1958), de même lorsqu’un personnage se vautre dans une flaque d’eau.
*
A la fin, une fois que tout le monde est parti, les gens n’en pouvant plus de ce gloubi-boulga, Orson nous gratifie en voix off d’un « cut », probablement rajouté postérieurement. Gageons que la critique française criera au génie et nous assommera avec des articles pseudo-savants. Franchement, si ce n’était pas d’Orson Welles, personne ne s’y intéresserait ! Il restera à se reporter au documentaire, diffusé uniquement malheureusement sur Netflix, de Neville, They’ll love me when i’m dead (2018), phrase que confessait Welles à Bogdanovich. Reste à savoir si Netflix confirmera sa tentative de légitimation dans la profession cinématographique et auprès des cinéphiles par une sortie de The other side of the wind prévue en salle. Chacun.e pourra ainsi se forger sa propre opinion.