Jean Daive, Tour de ficelle par Pierre Vinclair
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
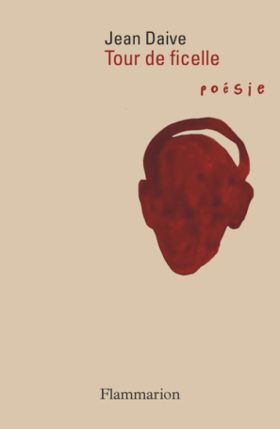
Les livres de Jean Daive donnent à penser. Dès leur titre, ici Tour de ficelle. D’une certaine manière, bien sûr, il n’y a rien là d’énigmatique : nulle obscurité, pas même une métaphore. On peut se demander « qu’est-ce qu’un clair de terre ? » ou « qu’est-ce qu’une fleur du mal ? » Mais un tour de ficelle est, et n’est qu’un tour de ficelle. Pourtant, si l’on ajoute (si j’ose dire) un tour de ficelle, « tour de ficelle » est un titre parfaitement énigmatique, au moins pour un livre de poésie. Comment en effet une expression si littérale, qualifiant un objet (ou un phénomène) si trivial qu’un tour de ficelle, pourrait-elle introduire à une activité, une manière de parler, qui en est a priori si éloignée ? Il doit y avoir un sens figuré, mais on ne sait pas où. L’énigme tient donc à l’invisibilité de l’énigme.
(Ouvrez plutôt le livre.) Qu’est-ce qu’un tour de ficelle ? Sans doute le mécanisme le plus simple, et le plus efficace, pour produire du mouvement : parce qu’une contrainte (ou une pression) disparaît, la ficelle enroulée se déroule telle une bobine de film. Le poème se déploie alors en un long plan d’immanence accueillant tous les êtres, toutes les images et tous les enchaînements. Par un tour de ficelle qui retient et soudain relâche, la mémoire fait lever ses histoires, Jean Daive l’écrit : « Il y a un cinéma de la parole / Il y a possibilité de feindre / Et le film du temps » (p. 220). Ce mécanisme simplissime n’est pas exempt d’une forme élémentaire de magie : on peut dire qu’un tour de ficelle est un tour de magie avec des bouts de ficelle. Mais qu’est-ce encore qu’une ficelle ? « Une corde mince, dit le dictionnaire, faite de fils apprêtés et retordus dont on se sert pour lier, pour attacher. » Je ne l’invente pas, la ficelle est faite de « fils », un mot (je ne l’invente pas non plus) qu’on peut aussi prononcer « fice » comme dans « ficelle » ; de sorte que si le mot « ficelle » était lui-même une « ficelle », elle aurait pour un fil le mot « fils », et sans doute pour un autre fil, le mot « elle ». Ficelle = fils, elle. Qui ça, elle ? « Celle »-là : la « fi(ce)lle ». La « fille », sœur de « ce » « fils ».
Jean Daive s’est beaucoup intéressé à Lacan et à la psychiatrie. Le livre est comme un film, mais le film est comme une séance de psychanalyse, ou un rêve. Il tourne, telle une ficelle, autour de quelque chose qui n’est rien : il tourne autour de lui-même. Et ce rien est pourtant quelque chose : le négatif est au travail. Vers la fin du livre, Jean Daive écrit : « Mon traumatisme je n’en connais / pas la nature / Mon secret je n’en connais pas la nature / Ma sœur je n’en connais pas la nature » (p. 297-298). Ce tour de magie (le poème) fait de bouts de ficelle, relâchant comme un cinéma minimal la bobine du langage, replonge dans cette matière — la mémoire de l’enfance, et l’inceste avec la sœur, qui en est l’événement au sens inépuisable — déjà travaillée non seulement dans les cinq livres du cycle de l’Alphabet de l’enfant (Flammarion, 2009-2022, 5 vol.) dont Tour de ficelle est le « codicille » (comme le dit la 4ème de couverture), mais aussi dans le roman initiatique La Condition d’infini (P.O.L., 1995-1997, 4 vol.) qui racontait la naissance d’une vocation. On en retrouve ici des épisodes et des figures obsédantes : le « jardin » qui fait songer au paradis et au péché, les crocus qui annoncent le printemps, et bien sûr, « elle ». Tour de ficelle est à la fois la partie émergée de l’œuvre de Jean Daive, et une sorte d’épure : le langage s’y réduit à son expression la plus directe (« en relisant j’ai laissé le jaillissement pour privilégier la dynamique du jet », précise une note p. 305), de sorte que la poésie qui s’y donne est à l’os. Rustique, puissante comme cette ficelle nerveuse prête à lâcher son tour, et libérer le film de la mémoire.
On peut regarder ce film, emporté par le flot de langage qui doit négocier en permanence son rapport entre l’horizontalité radicale des mots tous égaux, et la verticalité infinie de l’événement traumatique dont ils essaient de faire le tour et qui travaille en négatif — tour et trou. Mais on peut aussi faire un « arrêt sur image », par exemple sur ces deux vers situés à peu près au milieu du volume : « La pensée est le rêve / d’un parleur éveillé » (p. 135) Vers tout simples, qui ne paient pas de mine. Ils disent pourtant quelque chose d’intéressant : que la pensée ne s’oppose pas au rêve, qu’elle est plutôt un type de rêve. Ils disent aussi que quelqu’un qui ne dort pas, rêve pourtant. Et que ce rêve se fait à voix haute, qu’il est une parole (un poème ?) Le parleur éveillé l’ignore, mais il rêve. Et cela se passe à chaque fois qu’il pense. Or cette idée étant elle-même une pensée, donc — si on l’écoute — une sorte de rêve, on ne sait pas s’il faut la prendre au pied de la lettre : nous voilà donc en train de rêver à l’intérieur d’un rêve. Et ce rêve est peut-être lui-même un élément d’un autre rêve. On ne connaît jamais le nombre de tours de ficelle.