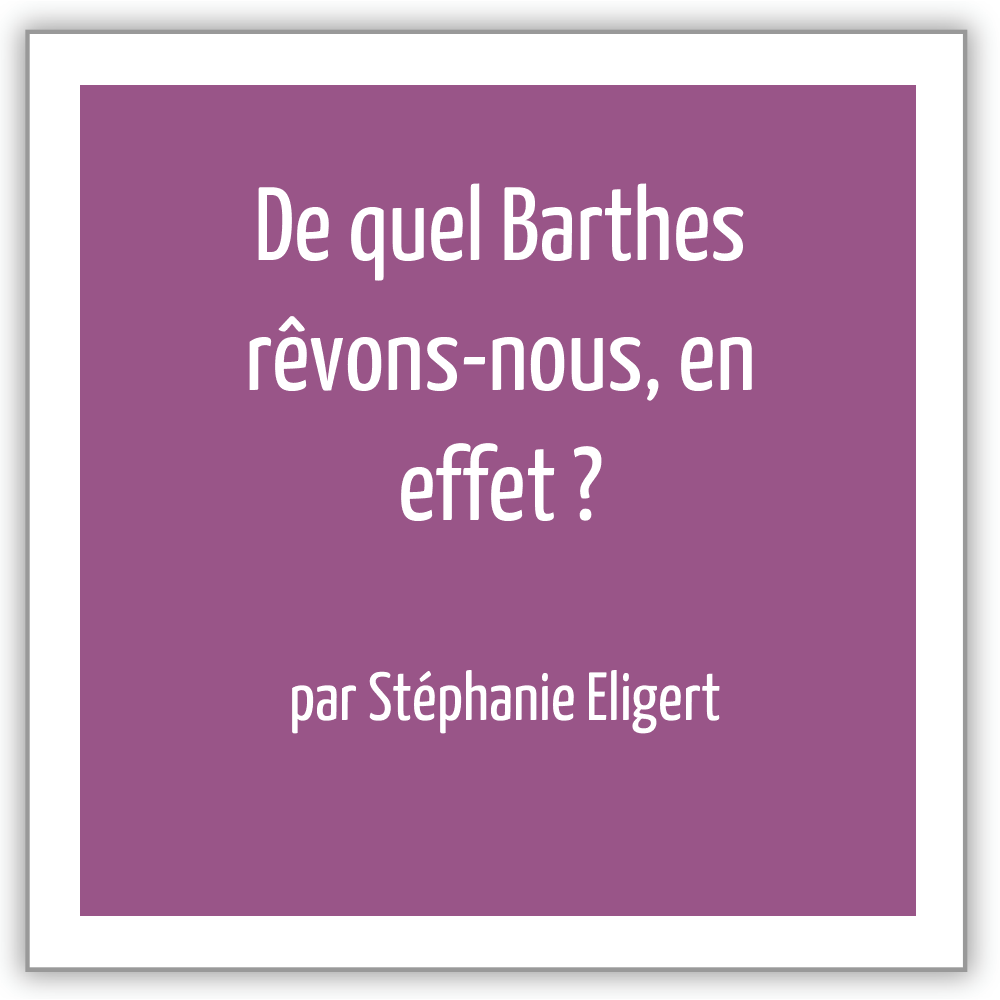19 mai
2009
De quel Barthes rêvons-nous, en effet ? par Stéphanie Eligert
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Je vous remercie beaucoup, Isabelle Baladine Howald, pour votre lecture du Journal de deuil de Barthes, et le contrechamp utile que vous ajoutez ainsi à ma propre perception de ce texte, dont aujourd'hui, il est vrai, je m'aperçois qu'elle était peut-être un peu sévère et injuste.
Néanmoins, il y avait alors quelque chose que je ne pouvais pas taire dans une chronique sur ce livre : l'effondrement que me causait sa lecture ; même aujourd'hui, posé parmi d'autres sur un rang de ma bibliothèque, ce texte continue à diffuser sa peur. Pourquoi ? Vous comprenez que ceci n'est pas d'abord pas un reproche, mais une stupéfaction d'ordre phénoménal : pourquoi cette langue, si généralement apaisante, provoque-t-elle ici une telle souffrance ? J'ai trop lu Barthes pour savoir que l'effet d'un texte (son « noème », comme il disait à la fin, dans le séminaire sur le roman) dépend principalement de ce texte, et pas vraiment de son lecteur. Dès lors, je pensais (en me trompant, votre lecture le prouve) que cette crise d'angoisse formait une qualité objective du Journal de deuil, et que c'est au milieu de cette donnée étouffante qu'il fallait réfléchir.
J'ai donc tenté de dégager des indices pour élucider cela. Pour autant, en vous relisant, je comprends qu'il s'y glissait aussi quelque chose de bêtement enfantin. Car d'une certaine manière, vous avez raison, il y a une vague atmosphère de « reproche » et même de colère : je suis comme une petite fille faisant un caprice parce qu'elle ne supporte pas que son « maître » intellectuel n'arrive pas à « résoudre par l'écriture de ces fiches, l'angoisse ». D'où l'intransigeance et à certains moments, la mauvaise foi (comme avec le sublime Plaisir du texte).
Tout se passe comme si je ne comprenais pas, comme vous l'écrivez, que « Barthes est de par la mort de sa mère projeté en face de la sienne propre », qu'il « fait l'expérience de l'anesthésie à toute autre sensation que celle de la douleur provoquée par le deuil » et qu'il « souffre davantage de vivre sans sa mère que de l'avoir vue morte ». Il n'est pas un de ces syntagmes qui ne soient d'une torturante réalité et en cela, « la lente énumération des états de Barthes, endeuillé, orphelin, déprimé » forme un des documentaires les plus fins que l'on puisse trouver sur cette douleur ...
Le problème, pour moi (cf. cette question de Nietzsche que RB adorait : « qu'est-ce que cela pour moi ? »), le problème est qu'il ne survive pas à ce deuil et se suicide subtilement. Lorsque, après avoir détaillé certains des aspects les plus cruels de tout cela, vous vous demandez, peut-être en y acquiescant : « pourquoi rester en vie ? » De mon côté, je proteste et me demande : pourquoi ne pas rester en vie ? Il ne s'agit pas d'incriminer ce désir d'arrêt de mort, de le réprimer (en niant qu'il soit une « vraie liberté ») ; et encore moins de mettre ce livre au ban de la littérature parce qu'il diffuse de l'angoisse. Mais c'est simplement, je le répète, qu'il y a ce fait, physique : les interstices de ce livre entraînent à la mort. On consent à cela, ou pas - pour moi, c'est impossible.
« De quel Barthes rêvons-nous », en effet ? Cette question est belle car tout est là. Pour ma part, la réponse est duelle. D'un côté, je ne rêve à rien : je me réfère à un corpus qui existe, disséminé, et pour la mise en constellation duquel il eût suffi d'éditer et d'agencer autrement l'ensemble des textes de cette époque (cf. ma note ) où un deuil différent, dialectique se lit à peu près partout. Mais d'un autre côté, j'en conviens, je rêve, ou plutôt je fantasme. La lecture de ce Journal a été si éprouvante qu'il fallait immédiatement lui opposer une réception seconde, peut-être iconoclaste et inégalement fondée, mais douée des mêmes fonctions qu'un masque à oxygène.
Il s'agissait en fait d'élaborer un fantasme de survie - un fantasme capable d'éviter la mort, laquelle, n'étant rien d'autre que « l'interruption définitive de toute activité sensuelle » (cf. Brillat-Savarin, La Physiologie du goût), prive Barthes et ses amateurs de leur seule richesse : la jouissance (du texte).
Néanmoins, il y avait alors quelque chose que je ne pouvais pas taire dans une chronique sur ce livre : l'effondrement que me causait sa lecture ; même aujourd'hui, posé parmi d'autres sur un rang de ma bibliothèque, ce texte continue à diffuser sa peur. Pourquoi ? Vous comprenez que ceci n'est pas d'abord pas un reproche, mais une stupéfaction d'ordre phénoménal : pourquoi cette langue, si généralement apaisante, provoque-t-elle ici une telle souffrance ? J'ai trop lu Barthes pour savoir que l'effet d'un texte (son « noème », comme il disait à la fin, dans le séminaire sur le roman) dépend principalement de ce texte, et pas vraiment de son lecteur. Dès lors, je pensais (en me trompant, votre lecture le prouve) que cette crise d'angoisse formait une qualité objective du Journal de deuil, et que c'est au milieu de cette donnée étouffante qu'il fallait réfléchir.
J'ai donc tenté de dégager des indices pour élucider cela. Pour autant, en vous relisant, je comprends qu'il s'y glissait aussi quelque chose de bêtement enfantin. Car d'une certaine manière, vous avez raison, il y a une vague atmosphère de « reproche » et même de colère : je suis comme une petite fille faisant un caprice parce qu'elle ne supporte pas que son « maître » intellectuel n'arrive pas à « résoudre par l'écriture de ces fiches, l'angoisse ». D'où l'intransigeance et à certains moments, la mauvaise foi (comme avec le sublime Plaisir du texte).
Tout se passe comme si je ne comprenais pas, comme vous l'écrivez, que « Barthes est de par la mort de sa mère projeté en face de la sienne propre », qu'il « fait l'expérience de l'anesthésie à toute autre sensation que celle de la douleur provoquée par le deuil » et qu'il « souffre davantage de vivre sans sa mère que de l'avoir vue morte ». Il n'est pas un de ces syntagmes qui ne soient d'une torturante réalité et en cela, « la lente énumération des états de Barthes, endeuillé, orphelin, déprimé » forme un des documentaires les plus fins que l'on puisse trouver sur cette douleur ...
Le problème, pour moi (cf. cette question de Nietzsche que RB adorait : « qu'est-ce que cela pour moi ? »), le problème est qu'il ne survive pas à ce deuil et se suicide subtilement. Lorsque, après avoir détaillé certains des aspects les plus cruels de tout cela, vous vous demandez, peut-être en y acquiescant : « pourquoi rester en vie ? » De mon côté, je proteste et me demande : pourquoi ne pas rester en vie ? Il ne s'agit pas d'incriminer ce désir d'arrêt de mort, de le réprimer (en niant qu'il soit une « vraie liberté ») ; et encore moins de mettre ce livre au ban de la littérature parce qu'il diffuse de l'angoisse. Mais c'est simplement, je le répète, qu'il y a ce fait, physique : les interstices de ce livre entraînent à la mort. On consent à cela, ou pas - pour moi, c'est impossible.
« De quel Barthes rêvons-nous », en effet ? Cette question est belle car tout est là. Pour ma part, la réponse est duelle. D'un côté, je ne rêve à rien : je me réfère à un corpus qui existe, disséminé, et pour la mise en constellation duquel il eût suffi d'éditer et d'agencer autrement l'ensemble des textes de cette époque (cf. ma note ) où un deuil différent, dialectique se lit à peu près partout. Mais d'un autre côté, j'en conviens, je rêve, ou plutôt je fantasme. La lecture de ce Journal a été si éprouvante qu'il fallait immédiatement lui opposer une réception seconde, peut-être iconoclaste et inégalement fondée, mais douée des mêmes fonctions qu'un masque à oxygène.
Il s'agissait en fait d'élaborer un fantasme de survie - un fantasme capable d'éviter la mort, laquelle, n'étant rien d'autre que « l'interruption définitive de toute activité sensuelle » (cf. Brillat-Savarin, La Physiologie du goût), prive Barthes et ses amateurs de leur seule richesse : la jouissance (du texte).