Christophe Manon, SIGNES DES TEMPS par Jean-Claude Pinson
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
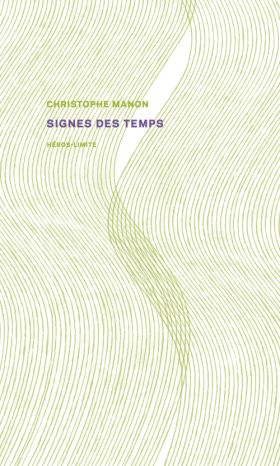
Jouant du registre autobiographique, le précédent livre de Christophe Manon, Porte du soleil (Verdier, 2022), long poème écrit en prose coupée, avait pour trame le récit d’un voyage en Italie qui était aussi, scandé à coup d’ekphrasis des tableaux partout là-bas rencontrés, un voyage dans le temps. « La sauvage douleur d’être homme » s’y disait sous une lumière tout à fait « caravagesque » (tel est le qualificatif que j’avais cru pouvoir utiliser dans la recension que j’avais faite ici-même de ce livre).
Signes des temps propose cette fois une « autobiographie collective ». Si la tonalité y est toujours prosaïque et le registre fortement narratif, très différente en est la prosodie : une suite de 25 séquences en prose, toutes de même dimension (un peu plus de deux pages). La composition, usant de la technique du montage, juxtapose des énoncés où abondent, souvent nominales, des phrases courtes où trouve à se dire sans épanchements ni fioritures « la belligérante stupeur de vivre».
Là où le discours du philosophe, enclin aux abstractions, nous parle de l’homme en général, le récit autobiographique s’attache lui à la singularité d’une existence. L’expression d’« autobiographie collective » pourrait donc sembler tout à fait paradoxale, si le genre en question n’était pas des plus flexibles (comme en témoigne par exemple cette étonnante Autobiographie de mon père publiée en 1987 par Pierre Pachet, autobiographie où se dédoublent le sujet de l’énonciation et le sujet qui fait l’objet du récit).
Mais c’est précisément cette collision du singulier et du général, leur intime métissage dans le texte, qui fait tout l’intérêt d’un livre où la voix propre du narrateur s’altère en se dépersonnalisant. Car, loin que son existence singulière soit érigée en exemplum, les signes dispersés qui pourraient sembler n’appartenir en propre qu’à l’auteur dessinent tout un territoire commun, tout un « partage du sensible », où pourra se reconnaître toute une génération née, comme l’auteur, au début des années 70.
Mais ce n’est pas tant un cadre historique, celui d’une époque venant au terme d’un « siècle de décombres, de cendres et de gravats », qui est ainsi brossé. À travers ce qu’on pourrait appeler, reprenant un néologisme de Barthes, des « biographèmes » historiques, c’est la tonalité d’une période, le fond de l’air de toute une époque, les signes et les bruits d’un temps, en leur diversité chaotique, qui sont donnés à sentir. Pas de récit ordonné des événements, juste des dates, égrenées comme un chapelet, sans commentaire, au fil des chapitres : « 1983 et 1984 et 1985 ». Ainsi se trouve donnée à lire et à se remémorer la vie ordinaire de ces années-là (le vécu par exemple d’une enfance comme les autres : « Et des bulles de savon. Et les westerns à la télévision. »). Non sans que, trouant le tissu de l’évocation, le jaillissement de notations épiphaniques, intensifiant les « biographèmes », restitue au plus vif le sans-pareil de toute existence, la brûlure singulière, subjective, tapie dans les replis de son apparente banalité : « À fumer des pétards à la sortie du lycée et traîner dans les bars jusqu’au petit matin et prendre la voiture en direction de l’océan éblouis par le soleil levant et dormir dans les dunes, à la fin presque totalement recouverts par le sable. »
Dans la culture populaire, l’expérience commune se sédimente sous forme de sentences et proverbes. Dans ce Signes des temps, nombreuses sont les formules toutes faites qui témoignent de ce registre : « donner sa langue au chat », « sucrer les fraises », « Un dernier pour la route », « Et les vaches seront bien gardées », « Ma main à couper », « Le bon Dieu sans confession », « Qu’il faut bien que jeunesse se passe », etc. High and low, leur allure éminemment plébéienne, contrastant fortement avec le recours à des aphorismes de tonalité plus savante et distante (« Hombres que nous sommes, poussière d’atomes balayée par les vents »), contribue à la conduite très inventive de ce qui est beaucoup plus qu’une narration.
Si c’est dans une époque vécue collectivement que le livre d’abord nous plonge, c’est aussi un milieu social et son langage qu’il nous donne à entendre : « Mais tout cela n’est qu’une question de classe ». Cependant, adepte d’une ligne claire, la poétique de Christophe Manon, si elle fait indéniablement bouger l’idée qu’on peut se faire de la poésie, ne cherche pas à y parvenir en bousculant à toute force la syntaxe ou le lexique de la langue standard. Au-delà d’une éventuelle approche en termes de sociolinguistique, c’est une analyse esthétique qui peut être ici davantage éclairante. Le recours aux formules toutes faites dans l’usage populaire du langage peut être vu alors comme une façon de s’assurer d’un monde commun, de se rassurer, quand on est du côté des dominés, face aux aléas d’une existence exposée à mille dangers et déboires.
Articulant le plus général et le plus personnel d’un vécu, l’usage de la liste est récurrent dans ce long poème de Christophe Manon. Loin d’être procédé mécanique, il opère selon plusieurs logiques. Telle liste pourra ainsi incarner immédiatement, sans métaphore, la saveur propre d’une époque, ce en quoi elle constitue un bien commun, une collection de « ressentis » collectifs. Par exemple, une liste des groupes de musique pop ou punk. Ou encore, à travers une liste de toponymes surgira, avec son effet d’immédiate contingence, la singularité de lieux précisément (géographiquement) situés, lieux que toute une communauté (en ses différentes strates : familiale, communale, départementale…) a en partage : « Cercoux, Mirambeau, Bassolais, Maransin, Pochut, Chanias, Bayas, La Grande Clotte, Les Motets, Le Bouscat. ».
Parfois aussi, plus erratique, la liste surgit impromptue, et, comme une lame, lacère l’ombrelle protectrice de ce flux de langage familier et bien ordonné où nous cherchons quotidiennement abri*: « Un avion. Un chien. Un baiser. Un tracteur. De vieilles carcasses rouillées au bout des rangs de vignes. Un baiser. Un kilo de patates. Un dimanche. Un trèfle à quatre feuilles. » Bien qu’étroitement insérée dans le puzzle du poème en prose, l’abrupte rupture qu’introduit une telle liste dans la continuité du ressassement verbal ouvre soudain l’espace d’un ailleurs affranchi de toute pesanteur textuelle. Ainsi trouve à se dire, à la faveur d’une série nominale sans apparente logique, toute l’étrangeté et tout le chaos du monde – de l’expérience d’être au monde.
Telle autre cependant, simple liste-inventaire, suffira à suggérer, en son goût d’éternité, le vécu d’une enfance à la fois commune et singulière : « Et des tartines de confiture pour le goûter ou bien un grand bol de chocolat. Et les batailles de polochon. » « L’effet de liste, notait naguère Jean-Christophe Bailly, est comme une enfance du langage ». Elle nous conduit un instant sur le « versant adamique du langage ». Mais si la liste est le « paradis du nom », elle est, ajoute-t-il, « un paradis dont il faut accepter de tomber pour phraser » et ainsi entrer dans une danse du monde qui est par bien des côtés chaotique.
« Paradis et cloaque », tels étaient selon Zanzotto les deux pôles, impossibles à disjoindre, de la poésie en son battement fondamental. C’est bien un semblable mouvement, me semble-t-il, qui emporte la prose de Christophe Manon et en fait toute la vigueur et saveur. « En ces temps-là, la grève était une joie partagée, un rêve collectif ». Certes ces temps sont bien passés. Mais si, comme dit la chanson, avec le temps tout s’en va, pourtant il reste à dire, à se souvenir, et tout n’est pas fini, nous dit aussi ce livre.
Et si ces Signes des temps rendent un son si prenant, c’est parce que le lecteur y perçoit d’emblée la force prégnante d’un rythme ostinato. Reposant sur la succession de phrases courtes, la prosodie du livre, son rythme cardiaque, paraît venir de la vie corporelle en ses dimensions les plus physiologiques. Mais l’esthétique n’est-elle pas, comme le soulignait le préhistorien André Leroi-Gourhan, enfouie au plus profond de la « sensibilité viscérale » ?
* Je pense ici à une formule de Deleuze où , reprenant une métaphore de Lawrence, il faisait du poète celui qui « pratique une fente dans l’ombrelle » que les hommes ne cessent de fabriquer pour se protéger. À travers la fente ainsi pratiquée, débarrassé des clichés de l’opinion, un regard neuf peut alors être porté sur le monde et l’existence.