Nouveaux courants de Philippe Jaffeux, 2 par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
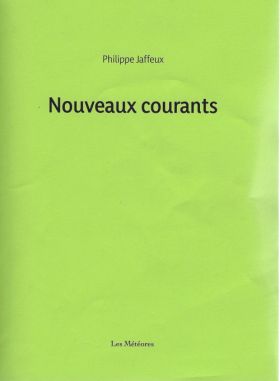
Comme un alphabet par page, 26 lignes, phrases ou vers, affirmations paradoxales où, le plus souvent, l’infinitif fait fonction d’impératif, sont à lire comme un oiseau tresse son nid. Aucune progression, aucun déroulement : le temps s’est arrêté dès l’incipit : « Le temps se cogne contre la musique lorsqu’il a enfin le courage de s’arrêter (p.1). De la musique avant toute chose ? Oui, avant : antérieure à tout. « Nous avons chanté avant de savoir parler parce que la musique nous a précédés (p.57), de même que l’air, l’eau, la terre, le feu, le soleil, la lumière. Le temps « prend un sens lorsqu’il est exclusivement au service de la musique » (p.2).
>nbsp;
Ce livre pourrait être le premier de Philippe Jaffeux et chaque phrase la première d’un livre des recommencements, qui vient « se perdre dans ses renaissances pour finir ce que nous n’avons jamais débuté » (p.23), et « clôturer les fins avec des débuts qui accueillent l’extinction d’une origine inexistante » (p.31). De même que « le cosmos raconte l’histoire d’un tohu-bohu de retours en perpétuel renouvellement » (p.55). Des parenthèses s’y ouvrent, s’y ferment : « L’intervalle entre notre naissance et notre mort contient ce qui nous sépare du temps » (p.66), qui est « peut-être une matière qui solidifie notre incapacité à le définir » (p.23). Semblables aux paroles qui « tombent des pages parce qu’elles sont plus lourdes que l’air » (p.30), les pierres « se transforment en tombeau parce qu’elles ignorent le poids du temps » (p.30). Le sens n’est pas orienté comme celui d’une flèche, mais immobile, rythmique : « La pulsation d’un sens immobile rythme la fabrication d’un mouvement destructeur » (p.15). Ainsi, « le présent remplace le passé depuis que le temps n’a aucun avenir » (p.64). À chacun (à chaque ligne, à chaque livre) de « renaître en soi-même pour oublier une humanité en voie de disparition » (p.41). De « continuer à recommencer ce qui a été trouvé lorsque nous n’avions rien débuté » (p.47). Autrement dit, de « se perdre dans ses renaissances pour finir ce que nous n’avons jamais débuté » (p.23). Circularité ? « Les aiguilles tournent dans des cercles pour mesurer un temps dépassé par l’infini » (p.16). Mais « commencer par la musique », c’est « poursuivre ce qui ne s’arrêtera jamais » (p.25).
Si l’aphorisme de Char est une pierre qui vaut son pesant de sens, de sérieux, celui de Jaffeux est la fronde qui projette chaque ligne dans le vide des interlignes. « Séparer des mots avec des trous qui transforment une page en une passoire » (p.2), trous qui communiquent entre eux, où les « courants » circulent, c’est avec humour faire comme « les oiseaux » qui « s’élèvent au-dessus de nos têtes pour plumer notre intelligence » (p.2). Humour radicalement noir : « Mourir sans arrêt pour augmenter ses chances de se reposer sans interruption » (p.3). Et « nos tombes se retourneront si nous mourrons pour enterrer la terre sous nos cadavres » (p.15). Il faut « conserver son cadavre dans son corps pour être sûr de mourir avant d’être momifié » (p.21). « Les arbres entretiennent leur racine pour consumer des cercueils en bois » (p.55). Radicalement noir et absurde : « La cruauté d’un fond absurde essaye de blaguer avec l’humour noir des lettres » (p.18). Si le temps est un mur, « les murs qui se cognent contre les têtes trouvent l’issue d’un sens absurde » (p.38).
Contre toute autorité, même celle du soleil (« Les pierres se moquent du soleil pour être respectées par l’humour des plantes », p.4), l’humour est un cri : « Traduire une réaction du silence avec un cri sourd à l’autorité d’un discours » (p.6). Et « imaginer la parole d’une langue qui sait traduire des cris avec des lettres » (p.7). L’ego n’est pas la moindre des autorités à déloger : « Le monde se dévoile sous toutes ses facettes dès qu’il prend notre place » (p.7). Le meilleur moyen de « se révolter contre nos identités pour que notre colère ignore notre personne » p.8), c’est de « parler avec tout le monde pour s’adresser à chacune de nos identités » (p.6). Et de « se cacher derrière son miroir pour s’exposer à un reflet indirect de son absence » (p.29). Dès lors, « le rire ne nous appartient plus dès que nous savons nous moquer de nous-mêmes » (p.49), et savons que « la mort joue avec notre joie car nous existons à l’intérieur d’une blague » (p.49). Mais « s’ouvrir à tous les possibles » permet de « s’enfermer à l’extérieur de nous-mêmes » (p.50). L’ego à déloger peut être colonial : « Notre civilisation s’engloutit dans des villes construites par notre barbarie » (p.35). National : « Un sol est étranger à l’autonomie du monde dès qu’il est affilié à une nation » (p.34). Racial : « Nos peaux s’adaptent à chaque couleur car le soleil brille pour tout le monde » (p.42).
Contrairement à Char qui, comme beaucoup d’autres, écrit avec des mots, Jaffeux écrit avec des pages (comme la peinture), avec des intervalles (comme la musique), avec des noirs et des blancs, des pleins et des vides : avec des lettres. Elles « brillent comme des étoiles pour réduire notre gloire en poussière » (p.15). « L’encre donne le jour à des lettres plongées dans un regard de la nuit » (p.3). Par bonds, « un mélange de noir et de blanc chevauche le plastique d’une page zébrée » (p.7). « Converser avec les nuages » nous permet de « suspendre nos voix à des trouées de lumière » (p.8). Si « l’encre est noire », c’est « parce que tout ce que nous écrivons émane de notre sommeil » (p.26). Et « les lettres épèlent des paroles qui sont écrites pour être écoutées par notre silence » (p.29). Elles « sont des images si la lecture ne s’oppose plus à l’écriture et vice versa » (p.48). À la fois « divines », quand elles « conservent les vibrations lisibles d’un analphabète endiablé » (p.52) et atomiques : « Chaque lettre renferme un atome qui matérialise une libération de notre énergie » (p.66). Il s’agit donc d’ « ajuster la précision explosive de chaque lettre avec l’unité spirituelle du vide » (p.60). Elles ouvrent « les jeux de nos interprétations » (p.12), de même que « la musique s’incarne dans l’innocence d’un jeu qui interprète le hasart divin » (p.23). Elles « couronnent notre enfance pour destituer l’écriture des adultes » (p.62). Elles lisent et écrivent des bandes dessinées : « Encadrer une bande de phrases avec un dessin qui légende l’animation d’une case » (p.18). Elles vont au cinéma, là où « les films sont vus dans le noir car ils sont réalisés avec la lumière de nos rêves » (p.22), et attisent « le feu de notre imagination » (p.23). Là où « un film fait écran à l’internet pour mettre en scène la sensibilité d’une toile » (p.48).
« Éloigner nos yeux de notre voix » ouvre « des passages vers notre odorat » (p.20). Et « goûter aux sensations de sa langue » aide à « muscler l’organe de son mutisme » (p.57). Le chimisme des sensations arrête le temps : « Un corps vieillit pour raconter l’histoire inaltérable d’une réaction chimique » (p.56). Si « les livres séquestrent nos solitudes pour libérer chacune de nos imaginations » (p.54), les réactions que libèrent les « nouveaux courants » se traduisent en équations chimiques, lisibles « à la lettre et dans tous les sens ».