On n’arrêtait jamais de vivre de Noémie Parant par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
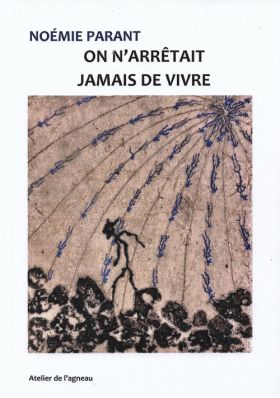
« Ah ! que la vie est quotidienne ! » (Jules Laforgue). Mais la mort ? Le deuil ? L’écriture ? La réponse de Noémie Parant tient dans son titre : « On n’arrêtait jamais de vivre ». Ce n’est pas un hommage funèbre à son père, à l’artiste et à l’auteur abordés dans Les mots et les mains. Essai sur Jean-Luc Parant (Corlevour, 2013), mais le portrait d’un vivant, de sa vie même, portrait tout en instantanés, dans le bougé de ses gestes les plus anodins, pris sur le vif dans l’atelier, dans le jardin, et avec eux d’ « une manière particulière de s’amuser de tout ». Elle « ne veut rien voir de lui mourant ». Il n’y a rien à voir, elle « ferme les yeux » comme il a fermé les siens, et ne parle qu’intérieurement, de « peur de paraître trop solennelle et dramatique ». Rien ne prédisposait les ultimes détails à être ultimes. Ni les derniers mots : « elle les oublie déjà, alors qu’ils ont été à la pointe de tous ceux qui les ont précédés. Elle n’aurait jamais cru qu’ils seraient les derniers, si banals, elle croit se souvenir, si peu marquants en apparence ».
Le plus banal peut devenir le plus précieux. Noémie Parant semble, dans ce récit, répondre pratiquement à la question qu’elle posait théoriquement dans son article paru dans Alter, 19 / 2011 : « Mettre en mots les choses elles-mêmes : le difficile passage de l’expérience à l’expression ». Cette expérience ressemble à celle de l’absurde. Citons un autre titre de Noémie Parant, en collaboration avec Natalie Depraz : L’écriture et la lecture : des phénomènes miroir ? L’exemple de Sartre (PURH, octobre 2011). On peut, en effet, penser à La Nausée en lisant : « Elle regarde le goudron par terre, les délimitations blanches du passage piéton : ça lui fait l’effet de quelque chose d’absolument inutile et déplacé ». Ou : « Il ne lui semble pas que la nuit soit pourtant venue, qu’il lui faille se coucher, dormir et tout le tintouin quotidien, c’est idiot tout ça, sert à quoi : la vie humaine, au bout de cette journée, lui tombe décidément des mains ». Le mot « idiot » rappelle aussi Clément Rosset : le tragique de et dans la légèreté. Citons encore : « Elle reste devant cette vallée pendant que les autres font leurs achats, avec peu de choses en tête, vraiment peu de choses : la vie ne fait franchement plus d’effet ». Et : « Il aurait été possible de reconnaître une bonne fois que la vie, décidément, n’a pas de sens ».
L’instant confine au néant et à l’éternité : « Tout est donné, ses bras sur les accoudoirs, ses pieds sur le sol cimenté, sa façon de se tenir toujours un peu courbé et même une sorte d’éternité flottant par-dessus, aussi près du ciel que l’on voit pourtant à peine ». Le ciel « ne cesse pas d’être identique, tu le vois n’est-ce pas, ses franges d’automne et l’avenir absolu qu’il laisse ouvert ». Et « lui-même » est « tel qu’elle l’a toujours vu, assis, debout, marchant, sans importance, mais pas figé, ni dans un souvenir ni même sur une photo qu’on retrouve ». À chaque instant, il porte « sa vie entière, sa vie entière dans sa tête et cette mémoire avec lui des années qui furent, les nuits, les jours et la nuit maintenant ». Elle lui dit : « dans ce petit coin à toi, la vie est éternelle, les saisons se poursuivent sans nulle idée de la mort, ni de jour ni de nuit, la vie est trop belle pour cela, été comme hiver, on vit, on ne pense pas mourir, ni soi ni aucun des autres ».
Autour de l’instant, c’est l’habitude le rituel, qui tisse l’éternité : « Il vit là-bas », entre fauteuil, bibliothèque, table de la salle à manger, et « Il écrit ici, sous ce ciel et au fond de ces forêts ». De ces lieux, de ces objets, « tout est intact, même la manière dont tu écris, le stylo tenu mais aussi le crayon rouge et bleu ». Il est « quelque chose du paysage, immergé dans le paysage (…) Mais il vit et sa vie déborde sur cet ensemble (…) et lui-même se dépliant, ses paroles, ses manières, tous ses mouvements : voilà comment il fait alors partie de cette tranche du monde ». Et « en ce monde », il reste « malgré tout », quand il se change en rêve. Alors, « rien de l’oubli » ne peut l’atteindre.
En ce monde où il reste, comme nous, immergé, car il n’en est pas d’autre, « tu n’auras plus de ciel », lui dit-elle, « ou bien tu auras tous les cieux, tu auras tout ça contre ton visage et ton corps disparaissant, à jamais, je te dis à jamais et voilà ». À rapprocher de : « je tiens beaucoup à cette image de toi riant et vivant à jamais », un « à jamais » qui confine au « plus jamais » car « les années passeront sans lui, à jamais sans lui, éternellement comme on dit ». Mais est-elle si sûre « qu’il soit sérieusement mort » ? Vie, mort, « tout lui devient égal ». Elle-même cède à l’habitude : « Elle se laisse vivre, elle ne se voit pas faire autrement, c’est désormais le pli habituel », sous la boule solaire « vivant d’une certaine façon, autant par sa lumière que par son feu ».
Quand elle écrit : « t’avoir vu vivant et ne pas te savoir mort, pas complètement, juste un peu et s’accommoder de cette ignorance et même survivre grâce à elle », Noémie Parant rejoint Épicure : « tant que nous existons, la mort n’est pas, et quand la mort existe, nous ne sommes plus » (Lettre à Ménécée). Mais ses pensées « ne sont pas exactement des pensées, pas des mots, pas des images les surmontant, l’impression seulement ». Proustien, le terme désigne aussi le texte imprimé : « il se dit riche de tout cela, infiniment riche de toutes ces pages imprimées. Il croira toujours en cette richesse, il y croira jusqu’au bout ». Elle aussi et, lisant ce texte, nous avec elle.