Ginseng, la racine de vie de Mikhaïl Prichvine par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
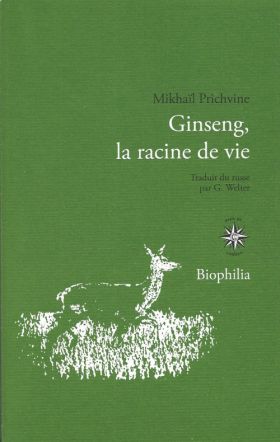
« Virgile russe et cyrillique Thoreau », c’est ainsi qu’Éric Dussert, dans sa postface, présente Mikhaïl Prichvine (1873-1954) dont « on mesure mal l’immense popularité » en Russie. Il le compare aussi à Jack London (Ginseng est « un récit d’exploration » de la Taïga) et au Kipling du Livre de la Jungle, avec une dimension « poème en prose », « description d’une expérience spirituelle », et « conte ». À l’opposé de toute « autonomisation du champ » ou autre bourdieuserie, cet agronome « a choisi la littérature et a toujours pratiqué l’une sans oublier l’autre ». Maxime Gorki lui écrivait en 1926 : « votre amitié pour l’homme découle si logiquement et si simplement de votre amour de la Terre, de votre "géophilie", de votre "géo optimisme" » ;
Écouter la Terre, pour le géologue, c’est écouter le Temps. « Le son mesuré » de la mer lui « parle des grandes époques de la vie de la planète », dont « le flux est comme le pendule ». Au vernien « voyage au centre de la terre » via le « babil souterrain » d’un « ruisseau sans nom », Prichvine joint le « c’est dans mon cœur » de Proust : « Peut-être n’était-ce ni la mer ni la pierre, mais moi-même qui étais balancé au battement de mon propre cœur ». En profonde empathie avec les animaux, Prichvine éprouve « la surprise du tigre d’apercevoir sa trace sur la neige », l’étonnement de la biche qui se fige pour étudier l’homme qui l’observe, et se demande s’il est une pierre ou s’il peut remuer, la crainte des cerfs qui se cachent dans les buissons « pour éviter à leurs bois encore sensibles tout contact malheureux », et le tourment du rut qui réduit leur existence « à un mugissement douloureux ». C’est par déduction que le chasseur, suivant la trace des bêtes, devine leurs intentions. Le narrateur, « chimiste », est « un pisteur beaucoup plus fort ». Sa « patrie est partout », tous les êtres y « sont identiques ». Participant à la musique des grillons et des cigales, il perçoit à travers elle « un véritable et extraordinaire silence, plein de vie et d’activité créatrice ».
Eros fut le premier titre de Ginseng : le désir est « la racine de vie », mais aussi « la tige et la fleur ». « Quelle richesse en friche, quelle inépuisable réserve (…) source de la force, du courage, de la joie, du bonheur », que beaucoup ne savent « découvrir en eux », et qui peut « métamorphoser en princesse chaque fleur, chaque cygne, chaque biche », en conférant « à l’homme jeunesse et beauté éternelle », sans poudre magique, sans méphistophélique marché de dupe. C’est la sensation qui nous unit au monde. Le corps partage avec « la nature entière, dépouillée de ses vêtements », la « fraîcheur matinale » qui le fait frissonner. Et à travers la sensation, c’est de la réminiscence que sourd la fontaine de jouvence. « À mesure que vous vous replongez dans le passé, vous commencez inconsciemment à pardonner, votre âme est plus légère, et finalement la rencontre attendue a lieu sous la pression de la joie de vie retrouvée, les deux amis redeviennent l’un pour l’autre aussi jeunes qu’ils l’étaient autrefois. C’est ainsi que je comprends l’action du ginseng ».
S’efforçant « de libérer et d’épurer la légende de la racine de vie des superstitions périmées », le narrateur refuse tout passéisme : « la racine de vie a passé de la nature primitive à notre nature créatrice », et « dans notre taïga d’art, de science et d’activité utile, ceux qui cherchent la véritable racine de vie sont plus près du but que ceux qui cherchent une plante préhistorique dans la taïga primitive ». Ainsi, « je cherche chaque jour toute occasion d’unir les méthodes de la science contemporaine avec la puissance de sympathie que j’ai héritée de Louven », le vieil ami chinois, à la fois le tout proche et le tout autre.
La réminiscence est renouvellement, le « temps retrouvé » crée le « temps perdu » à l’instant même où il le franchit, s’en affranchit, « dépouille le vieil homme », dirait Paul. Quand « tout le passé réapparaît avec toute sa douleur (…), je rejette loin de moi tout ce que j’ai fait, comme le cerf rejette ses bois, puis je reviens à mon laboratoire ». La connexion toute physique, sensorielle, de l’homme avec son animalité, est d’autant plus précieuse qu’elle s’établit sur fond d’altérité radicale, que creuse l’étude. La réminiscence olfactive provoquée par « une odeur de champignon particulièrement forte » s’accompagne d’une réminiscence auditive : le chant du ruisseau éveille l’orchestre et le chœur de « tous les êtres vivants ». La racine du ginseng représente « un homme nu », et c’est en humaniste que Prichvine, « avec (ses) collaborateurs inconnus ou célèbres », pénètre « peu à peu dans cette aube qui annonce pour les hommes une vie nouvelle, meilleure », sans ignorer qu’il est « tombé dans le pays de la révolution perpétuelle, où le soleil printanier provoque pendant la journée le mouvement de la sève dans les arbres, mais où, le soir, la sève dupée gèle, et l’arbre entier, de bas en haut, se fend sous l’action du froid ». La glaciation dure. La sève non dupe est patiente.