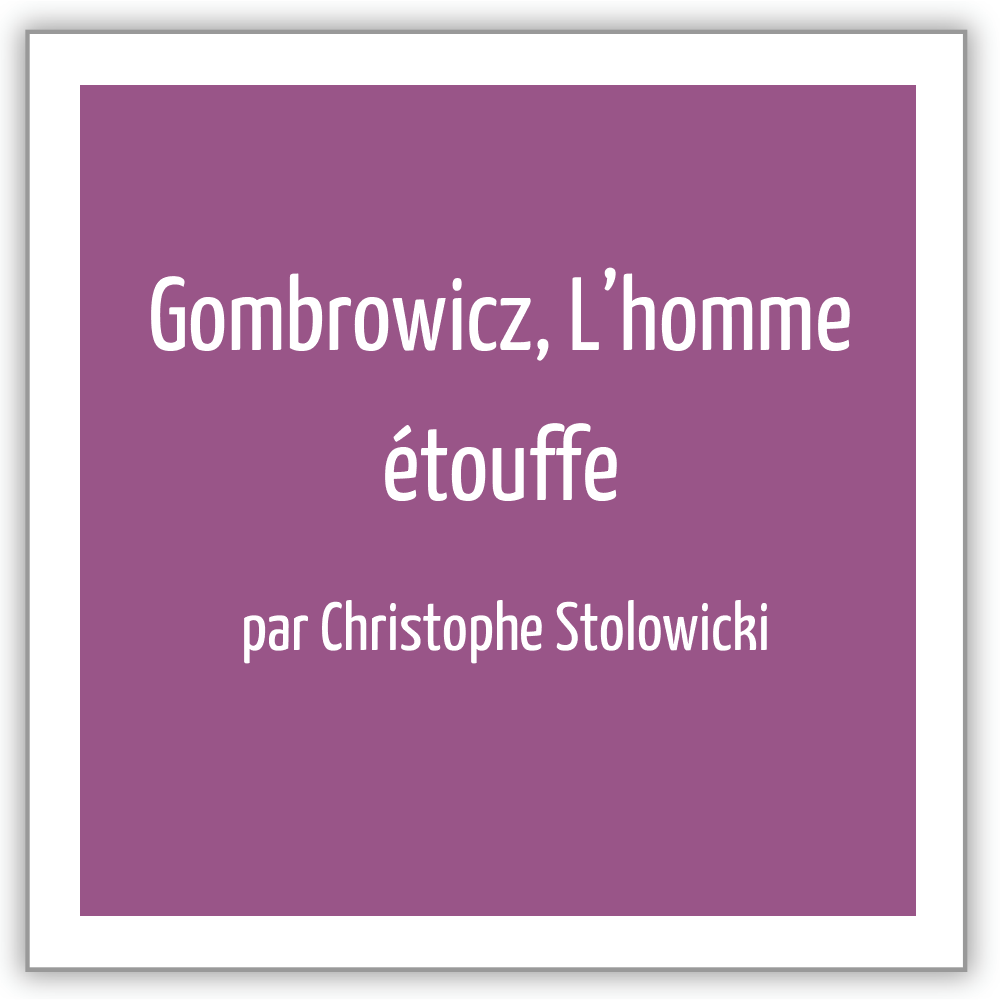Gombrowicz, L’homme étouffe par Christophe Stolowicki
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Witold Gombrowicz (1904 – 1969), écrivain phare du pays où je suis né, celui dont je n’ai qu’amertume en mémoire, resté antisémite sans Juifs, mais dont la langue en fond de bouche m’est nutricielle. Witold Gombrowicz, aux Polonais ce que sont Shakespeare aux Anglais, Dante aux Italiens, Goethe ou Nietzsche aux Allemands, Joyce aux Irlandais. Gombrowicz, le dernier grand génie national. Ayant, déjà connu, passé le plus gros de sa vie en exil (son plus célèbre prédécesseur, le poète Norwid, mort en France), il incarne d’autant mieux la Pologne, nation dont l’heure de gloire est ancienne, longtemps dépecée sous différentes bottes, à qui l’exil est consubstantiel.
C’est surtout un trait de lui sur lequel je voudrais m’étendre, d’une actualité brûlante qui nous laisse désemparés, sots, cois, prêts à rendre l’âme de notre humanité – ou de préférence hérissés ou lissés dans la dénégation –, sa conscience aiguë de notre surnombre, de la surpopulation que Nietzsche le premier a dénoncée en la personne des Uberflüssigen les superflus, et qui dans les années soixante était déjà un objet de scandale pour les éthologues du monde libre (expériences célèbres, que depuis par lâcheté l’on minimise, de John Calhoun en 1958 sur des rats en cage, abondamment nourris et chez qui apparaissent des comportements qualifiés sans anthropomorphisme de criminels et de schizophrènes).
Mais en Gombrowicz, qui à ma connaissance ne se réfère ni à Nietzsche ni à l’éthologie, cette lucidité est viscérale, touche à l’essence même de ce qui fait l’homme et ses arts. En cela, sinon notre contemporain capital, notre parent premier.
Je rouvre son Journal à l’année 1962, où « les pis lourds et sales du ciel pendent au-dessus de cette masse enchevêtrée qui fonce et bouillonne, au-dessus du cauchemar inconcevable que constituent ces millions d’hommes ». Et croyez-moi, la traduction a beau être excellente, en polonais c’est encore plus intense et violent. Il est impossible de rendre en français, langue policée prompte à la litote, la rudesse charnue de celle de Gombrowicz, aristocratique et familière comme celle que Proust prête au duc de Guermantes.
Cela à une époque où, écrivain de nouveau reconnu, au plus creux de son malheur d’exilé errant d’hacienda en hacienda d’accueil, sa petite valise à la main contenant un manuscrit en cours, il lâche la bride à sa langue de diariste, vomit wymiotowal, vomit wymiotowal, et wymiotowal une troisième fois en sortant du train de plus en plus bondé où la proximité d’un visage et de ses défauts corporels, la rétention des regards qui suspendent leur fonction sont une insulte à sa dignité d’homme, rendue par cette triple, et bientôt quadruple redondance dans l’abject.
À chaque homme dans l’Histoire devrait être associée sa quantité de contemporains, écrit-il, donnant des chiffres à tout hasard (internet n’existait pas), de « Démocrite, écrivons 400.000 » à « Gombrowicz 2.500.000.000 ». Il n’est pas indifférent qu’il se trompe lourdement en minimisant l’horreur, à un tiers de la vérité de 1962, multipliant par trois notre indice d’épaisseur personnelle d’hirondelles sur le fil du rasoir séculaire.
Chaque homme a sa densité osseuse, sa densité démographique importe tout autant. Notre indice démographique ne cesse de décroître. Notre indice osseux, pisseux, nerveux, dénervé. « Pour moi, il ne suffit pas qu’Homère ou Zola aient célébré, décrit la masse ; ni que Marx l’ait analysée ; j’aurais voulu que dans leur voix même transparaisse quelque chose qui m’aurait permis de deviner que l’un était un individu parmi des milliers, et l’autre parmi des millions. J’aurais voulu les voir pénétrés de quantité jusqu’à la moelle. »
Il a pitié d’une servante que ses hôtes, vivant à bonne distance de Buenos Aires, gardent par charité malgré sa paranoïa diagnostiquée par un psychiatre (« il n’est pas impossible qu’elle se saisisse d’un couteau ») – « mais quelque chose vient se mettre en travers… Mille milliards de mille démons ! milliards de vaches ! […] Lorsque je prends conscience d’une quantité, je tombe dans un certain nombre d’états étranges parmi lesquels le dégoût et la répulsion ne viennent qu’en seconde ligne. Il y a l’indifférence olympienne qu’implique l’interchangeabilité d’une femme contre une autre, d’une paranoïa contre une autre. À quoi encore vient s’ajouter l’ennui… […] Et vous pouvez me croire ou non, mon âme me fait bien rire […] La pitié elle aussi prolifère […] Je me lève. Je sors. Dans la nuit tombante on voit de la route un brouillard blanchâtre, électrique, monter à l’horizon, presque imperceptible, mais pénible, confus, comme né de l’irréalité… une réalité terrible qui m’oppresse… qui me piétine. » Cela en très grande banlieue protégée de Buenos Aires.
« L’inscription infamante sur le front de l’homme contemporain : un parmi beaucoup d’autres ». En peinture comme en d’autres arts (« le pire est que beaucoup sont bons », remarque son hôtesse, peintre d’art abstrait qui ne demande pas trop de technique), le nombre est l’ennemi de la création. – Faut-il appliquer cela à notre poésie ?
« Le nombre, c’est le triomphe de la mathématique. » Il a deviné en prophète ce qui nous attendait : le règne de l’ordinateur, seul à pouvoir y obvier, la mécanisation des esprits.
« NEC HERCULES CONTRA PLURES. »