Le crime d'une nuit suivi de Bécon-les-Bruyères d'Emmanuel Bove par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
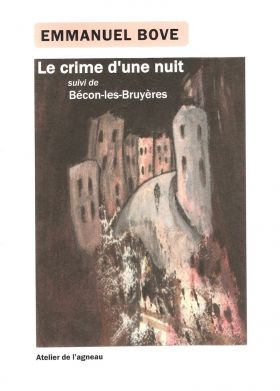
Emmanuel Bove ou le contraire de la « littérature à l’estomac », de la posture, du cabotinage, de l’histrionisme, de l’infatuation. Découvert par Colette, estimé par Rilke, admiré par Soupault, Gide, Max Jacob, recommandé par Beckett, plus récemment traduit par Peter Handke, il a voulu que ses écrits tinssent par leur seule force, libres de toute biographie, bien que les nourrisse indirectement, à travers le filtre de subtiles transpositions, la vie peu ordinaire d’un fils d’immigrés russes qui a connu très tôt des situations très contrastées, luxe en Angleterre et misère en France, puis les expériences de métiers divers qui ont précédé les succès littéraires, les années d’oubli après la seconde guerre mondiale, la mort dans le dénuement. Bove s’est tenu à l’écart des partis politiques, même quand il écrivait dans des publications antiracistes ou proches du front populaire, et à l’écart des coteries littéraires : s’il a connu quelques surréalistes, ils ne l’ont aucunement influencé. Le lisant, on songerait plutôt à un existentialisme précoce, à un univers kafkaïen. Henri Duchemin, dans Le crime d’une nuit (1922), n’est pas un raisonneur du genre Antoine Roquentin dans La Nausée. Il serait plus proche du Meursault de L’Étranger (1942). On peut même se demander si la nouvelle nocturne de Bove n’a pas inspiré le roman solaire de Camus.
La couverture de Gérard Jaulin nous plonge dans une ambiance expressionniste à la Munch, avec un rose vineux entre le noir et les gris, comme pour rapprocher le « crime d’une nuit » de ces « vins d’une nuit », d’un rouge léger, obtenu après une rapide macération de raisins noirs. Du crime commis par Henri Duchemin ou par Meursault, on peut dire qu’il « n’imprime pas », ne prend pas le temps de macérer dans une conscience vouée à la sensation et à l’émotion immédiates, envahie par la réalité qui, paradoxalement, est perçue comme irréelle, Bove semant avec art quelques ferments d’invraisemblance parmi des détails hyperréalistes. Comme Hitchcock l’angoisse, il distille goutte à goutte le sentiment d’étrangeté. Ainsi, Duchemin perd la trace de l’inconnu qui, le soir de Noël, lui avait promis la richesse en échange d’un meurtre, et l’avait amené à sa victime. Imagine-t-on Faust lâché par Méphisto ? Fortune en poche, Duchemin ne dépense pas un sou. Pris d’une bouffée de fraternité, d’une bouffée amoureuse, il jette quelques billets autour de lui, s’enfuit quand il comprend qu’il n’est pas aimé, reprend une errance que la rencontre d’un vieillard mystique n’interrompra pas, et reporte la belle vie à de vagues lendemains, compromis par l’habitude rapidement prise de se vanter partout de sa richesse. Le crime lui-même est commis « à l’aveugle ». Pas plus que Meursault ébloui dans L’Étranger, Duchemin ne voit celui qu’il tue en un instant qui ne « prend » pas dans la durée, instant blanc chez Camus, noir chez Bove, point aveugle dans le temps.
Le style est-il, lui aussi, blanc chez l’un, noir chez l’autre ? Bove écrira au kilomètre et à grande vitesse, pour subsister, des romans « populaires » dont il faut séparer radicalement ses œuvres « littéraires », extrêmement exigeantes et soignées. Il n’en joue pas moins sur les clichés du roman noir. Loin de la Méditerranée de Camus, l’atmosphère de la nouvelle rappellerait plutôt les brumes et les crachins du Londres de Mac Orlan (Bove songe-t-il au Dickens des contes de Noël ?) ou du Paris de Bruant. Le mot « surin » n’y est pas, mais il y a du « bouge » et du « taudis ». L’acuité des sensations crève le décor : « Une femme, dont la fourrure était encore mouillée, buvait un lait que le rouge de ses lèvres devait sucrer. Lourds de fard, ses yeux restaient continuellement ouverts, comme ceux d’une poupée ». Ou : « En passant devant un café, il perçut la musique perlée, mi-ferraille mi-cristal, d’un piano mécanique ». Le réalisme confine au fantastique : « Les meubles, doublés de leur ombre, semblaient se toucher ». Ou : « Comme l’homme sans nom l’avait dit, la lumière de la lune éclairait la chambre. C’était une lumière d’insomnie, une lumière pour des yeux malades ». Le monde entier semble frappé d’étrangeté, à moins que « l’étranger » ne soit Duchemin lui-même ? Son procès, s’il avait lieu, rappellerait celui du Meursault de Camus. S’être aventuré, un jour, à la Cour d’Assises, où les pieds des avocats, « sous la robe, semblaient si grands », le dissuade de se rendre : « Il valait mieux qu’il conservât sa liberté, car ces gens sans cœur ne comprendraient jamais les raisons du crime. D’ailleurs, personne ne les comprendrait ». La dernière phrase de la nouvelle ne dit pas autre chose : « Mais cela ne le concernait pas, puisqu’il n’avait jamais fait de mal à personne ». Ni Lafcadio ni Raskolnikov, Duchemin est bien le frère nocturne de Meursault, qu’il préfigure.
Un semblable sentiment d’irréalité transpire, sur le mode humoristique le plus efficace, celui qui ne se signale pas comme tel, d’un texte publié cinq ans plus tard, en 1927, dans une collection sur les villes et régions de France, Bécon-les-Bruyères. C’est d’abord le décalage entre le monde imaginaire du nom et la réalité d’une ville sans qualité qui provoque ce sentiment, si différent de la déception du narrateur proustien rencontrant un lieu, Balbec par exemple, étranger aux rêves qu’éveillait son « nom de pays ». À l’inverse de ce Balbec réel qui existe trop, « Bécon-les-Bruyères existe à peine », mais ce peu d’existence suffit à dissuader les rieurs titillés par le nom : « on est saisi, en arrivant à Bécon-les-Bruyères, de ce sentiment qui veut que, du moment que les choses existent, elles cessent d’être amusantes. Bécon-les-Bruyères tant de fois prononcé, tant de fois sujet de plaisanteries apparaît tout à coup aussi grave que Belfort ». Les variations sur les ventes de flans et de gants, les habitudes des forains, les cartes et horaires des trains, l’argumentaire d’une agence de location d’appartements, confirment l’impression que, situation géographique mise à part, il n’y a rien à dire de Bécon-les-Bruyères, rien à signaler, rien de particulier, rien qui ne pourrait être dit d’une autre ville. Bove rejoint, en amont, Guilhem de Poitiers, « Ferai un vers de dret nien » (Je ferai vers de pur néant), et en aval notre espace mondialisé où les zones industrielles et commerciales, gares, aéroports et voies, les équipements, les villes, campagnes et banlieues, les passants eux-mêmes, se ressemblent de plus en plus. Sous-jacente, la grandiloquence euphorique du mythe du Progrès apparente parfois le guide dont Bove joue (et compose) ici le rôle, au Monsieur Homais de Flaubert, et l’ironie de ce texte aux gags d’un Tati, à ces irréductibles grains de sable que les objets, les animaux et les enfants jettent sur les rouages du meilleur des mondes, si sécurisant (Bécon-les-Bruyères est décrite par Bove comme l’antidote à toutes les révolutions : « Tout y est honnête et égal. Tous vivent paisiblement »), comme le réel sur ceux du discours.