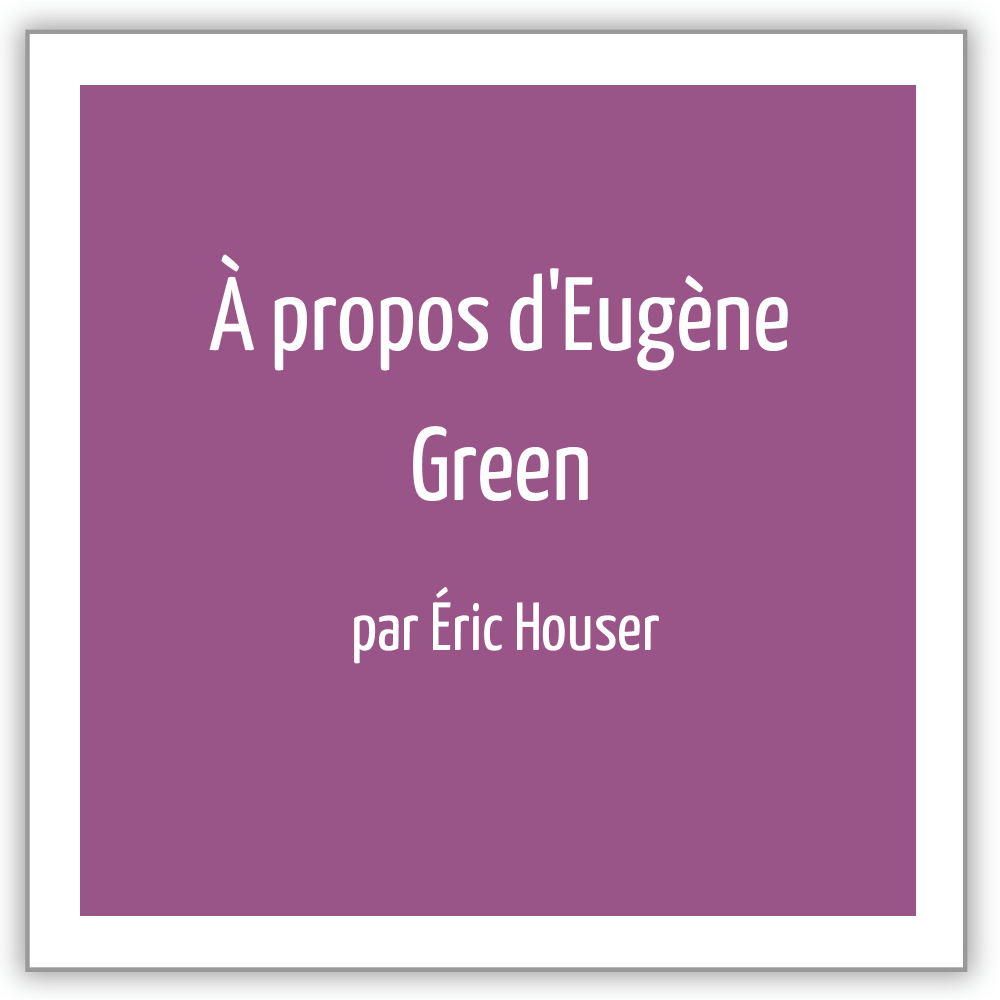À propos d'Eugène Green par Éric Houser
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
La sortie du film La Sapienza a été l’occasion pour moi de vérifier que le cinéma d’Eugène Green ne m’intéresse pas, et qu’Eugène Green n’est pas (selon moi) un véritable cinéaste. J’aimerais le démontrer, et pour cela je dois d’abord dire ce que c’est pour moi qu’un véritable cinéaste. Le problème, c’est que je n’ai aucune légitimité pour le faire, mais seulement une culture impressionniste et lacunaire (surtout lacunaire). Est-ce une raison suffisante pour renoncer ? Je ne crois pas. Un véritable cinéaste, selon moi, c’est quelqu’un qui apporte quelque chose d’inédit dans le cinéma, quelque chose qu’avant lui on n’avait pas vu. Ce quelque chose peut éventuellement faire penser à d’autres films d’autres cinéastes, mais il n’est pas réductible à une influence, une filiation. Ensuite, c’est quelqu’un qui, sur tous les paramètres du film, manifeste une inventivité, un travail, un plaisir de penser qui n’appartiennent qu’à lui mais qu’il a envie de partager avec ses spectateurs. Enfin, c’est quelqu’un qui manifeste une certaine ouverture, dans son medium propre, à d’autres arts (la musique, la peinture, la littérature). C’est peut-être un peu minimaliste comme définition, mais pour moi c’est suffisant.
Or, en voyant La Sapienza, qu’est-ce qui se passe ? Sur aucun de ces différents points je ne trouve de réponse positive : je ne peux cocher aucune case « oui » ! Eugène Green à mon avis (en tous cas dans ce film, mais j’ai eu toujours cette impression-là dans les autres films que j’ai vus de lui), n’apporte rien d’inédit dans le cinéma, aucune chose qu’avant lui on n’avait pas vue. Ce qui est délicat, c’est qu’il a pourtant l’air de le faire, mais je pense que ce n’est pas vrai. Son cinéma (et ce film en particulier) me semble relever surtout d’une attitude réactionnelle. Il fait un cinéma contre ce qu’il présente comme le repoussoir absolu, le cinéma américain récent (je suppose, tout confondu, du blockbuster à gros budget au film indépendant, sans parler des séries). Il a une position phobique par rapport à ce bloc-là (qu’il imagine comme un bloc tout d’une pièce), qu’il rejette absolument comme l’incarnation du Mal (il dit que les Américains, ce sont les Barbares, et pour parler d’un american movie, il préfère dire un bougeant barbare). Il a le droit bien sûr, mais c’est un mauvais départ, à mon avis, parce que ça montre une fermeture d’esprit qui n’est pas propice à l’invention du nouveau. Est-ce que c’est inédit, comme attitude ? Sûrement pas. On peut dire qu’on fait toujours plus ou moins son art « contre » un certain état de cet art, tout simplement parce qu’il le faut pour respirer, se dégager d’un joug etc., mais cela devient suspect lorsque ce contre quoi on fait son cinéma englobe autant de films et de productions différents (ce que revendique Eugène Green, et tout dans ses films le transpire). Je trouve que ça relève de la posture idéologique, de la phobie irrationnelle, et que ça ne va pas bien loin. L’attitude de Manoel de Oliveira était très différente, beaucoup plus subtile. Je cite Oliveira car j’imagine qu’il doit être un des cinéastes contemporains dont Eugène Green peut se sentir proche.
Par ailleurs, l’aspect réactionnel se montre dans le cinéma d’Eugène Green, d’une manière vraiment très triviale et naïve (qui touche souvent pour moi, je dois le dire, au ridicule). Le cinéma américain est « bougeant », agité, alors faisons des longs plans méditatifs, composons une belle image symétrique. On dira, pour ce film : mais c’est parce qu’il s’agit de symétrie aussi, avec l’architecture, et avec Borromini. Le problème c’est qu’alors que le Baroque questionne ces questions de symétrie, joue avec, joue avec les limites, il n’y a rien de tel dans les plans d’Eugène Green ! C’est tellement fade, tellement plat, que ça endort le spectateur (c’est ce qui m’est arrivé à plusieurs reprises). Même chose pour le jeu des acteurs, la diction. Alors que dans le cinéma de Bresson ou de Straub et Huillet, il y a un véritable travail vocal, d’intonation, de diction, qui introduit une vie nouvelle (pensons pour ne citer que cela à la voix et à la diction de Danièle Huillet dans Cézanne), qui peut produire des inventions heureuses, des sens nouveaux, dans les films d’Eugène Green il n’y a rien de tel. Ce qui domine dans le traitement qu’il fait, c’est cette attitude réactionnelle, encore. D’où l’impression (pour moi) de quelque chose de mort (inanimé), sans plus aucune vibration. On dirait que tout est cadavérisé, et c’est insupportable. La diction avec toutes les liaisons entre les mots (il m’a semblé quand même que c’était un peu moins caricatural dans ce film-ci que dans les précédents), n’est pas en soi condamnable, mais le problème encore c’est qu’on ne voit pas (on n’entend pas) ce qu’elle apporte de vivant et de neuf sur ce chapitre.
Sur le dernier point (ouverture à d’autres arts), là aussi c’est complètement raté à mon sens. Qu’est-ce que ça peut me faire de voir un long plan (même pas un plan séquence, un montage plutôt qui évoque des riches heures de Connaissance du monde) sur les architectures, le tout sur le fond de la musique de Monteverdi (magnifique), comme si Eugène Green nous disait « inclinez-vous » devant cette beauté que je vous montre. Il n’y a aucune ouverture à l’architecture, parce que ce n’est pas du tout comme ça qu’on peut ni montrer l’architecture, ni même en parler. Ici, ce n’est qu’un alibi prétentieux pour une posture. Et la musique, n’en parlons même pas : comment un cinéaste ose-t-il encore traiter la musique comme une simple musique de fond, alors qu’en même temps il prétend faire quelque chose d’authentique, « à la bougie » (il y a des plans avec des bougies dans le film). Je trouve ça confondant de niaiserie, de manque d’inventivité et de prétention, toutes déterminations qui vont d’ailleurs bien ensemble.